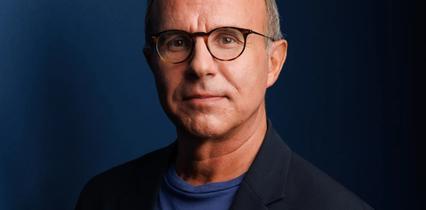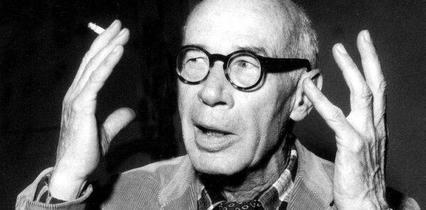Loin de l’exaltation furieuse et dionysiaque d’un Ernst Jünger, impavide sous les balles et jubilant dans la mêlée, Charles Vildrac raconte une guerre plus humaine et plus cruelle dans ses Souvenirs militaires de la Grande Guerre publié aux Éditions Claire Paulhan. Son témoignage permet de battre en brèche la gangue d’images autour de l’épopée sanglante et héroïque qu’aurait pu être la Première Guerre mondiale. Ce récit de Vildrac est ponctué d’éclats poétiques et de réflexions tragi-comiques où l’horreur et l’absurde s’enlacent sans repos.
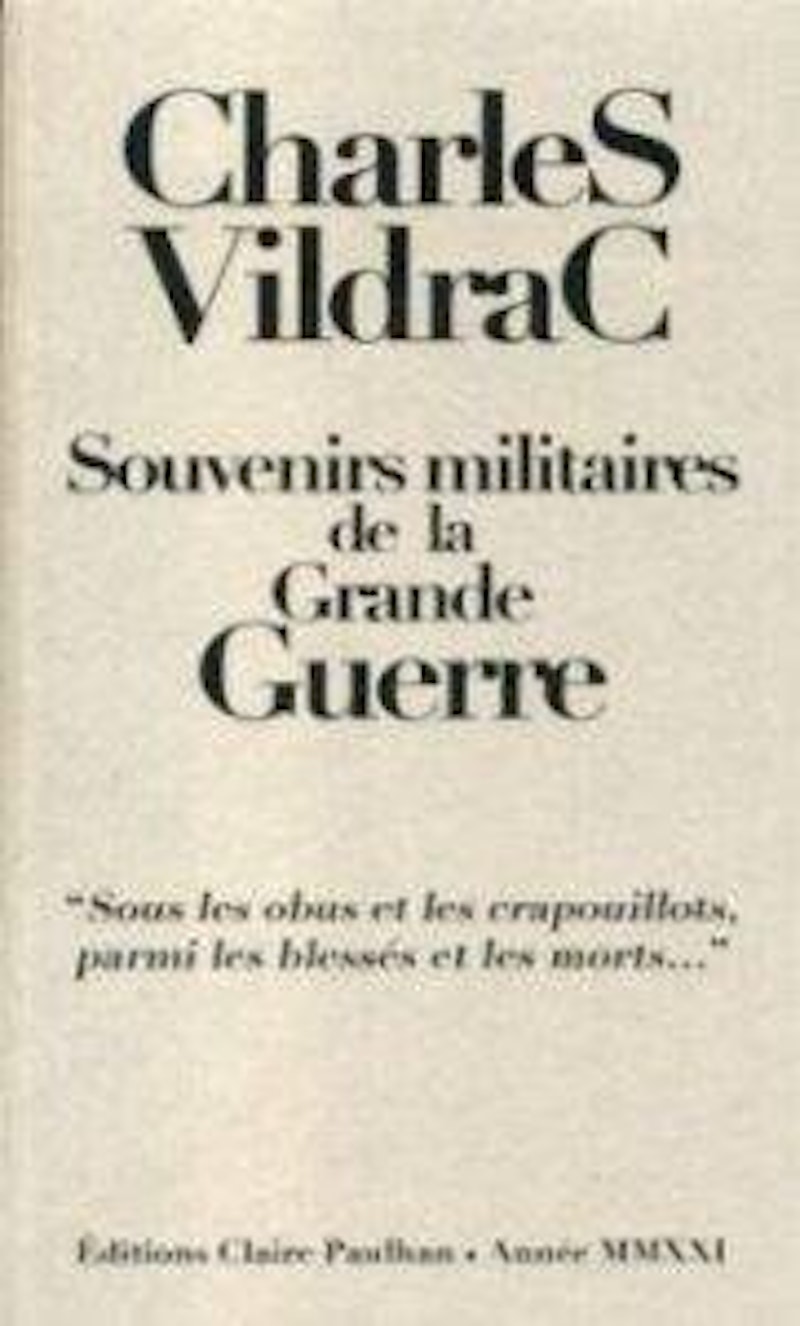
“On ne dénoncera jamais assez le mensonge et l’imposture des éternels glorificateurs de la guerre qui affublent d’un héroïsme individuel toute victime d’un asservissement collectif » Charles Vildrac.
Rendons d’abord hommage au merveilleux travail éditorial accompli une fois encore par les Éditions Claire Paulhan. L’introduction, les nombreux documents iconographiques qui accompagnent le texte réunis par George Monnet et les notes souvent éclairantes permettent de mieux suivre le parcours du soldat Vildrac dans le chaos de ce carnage européen.
Tout le récit de Vildrac est une charge contre l’image du soldat héroïque et il n’a de cesse de dénoncer l’incurie du commandement militaire. Le récit s’ouvre d’ailleurs par une anecdote tout à fait éloquente : un colonel est amputé d’une jambe à la suite d’une blessure sans gravité car il a refusé de se faire panser par un simple adjudant et non un médecin militaire. Vildrac remarque avec ironie et horreur la façon dont les hauts gradés réduisent les soldats à du matériel humain : « Combien y en avait-il déjà, depuis la veille, de morts comme celui-là, victimes de la prodigalité sanglante d’un général résolu à s’offrir un brillant communiqué sans regarder à la dépense ? » L’homme devient un chiffre, une valeur comptable et quantifiable. Une offensive se traduit par un calcul sommaire et la gloire des officiers supérieurs semble se mesurer aux chiffres de leurs pertes. Face à cette abstraction qui caractérise le commandement militaire, les mots de Vildrac tentent de restituer toute la matérialité du conflit dans son horreur et sa cruauté proprement absurde.
La fin de l’héroïsme : les morts minuscules
Contrairement aux formules rituelles, aux dessins du Petit Journal ou aux récits donnés à lire aux enfants, la guerre est une loterie infernale où les qualités individuelles importent peu face à l’orage d’acier. À plusieurs reprises, Charles Vildrac raconte les instants où il a été frôlé par la mort. Ainsi, un soldat lui demande une cigarette : « Je lui tendis ma blague en caoutchouc et mon papier. À peine venait-il de s’en saisir qu’une balle claqua sur le mur, près de lui, et qu’une autre l’atteignit à la tête. Il s’écroula sans une plainte ». Quelques jours plus tard, un soldat est décapité par un éclat d’obus à côté de lui alors que les deux compères se soulageaient contre un mur. Le récit est émaillé de ces épisodes tragiques et dérisoires, de ces morts minuscules, ces soldats à la fois précieux et insignifiants fauchés au milieu d’une conversation ou d’un geste de la vie quotidienne. Dans Ceux de 14, Genevoix se faisait déjà l’écho de ces drames ordinaires, notamment à travers la décapitation d’un soldat de sa compagnie au moment où il se faisait raser couper les cheveux : « Et Lardin qu’était là, son blaireau d’une main, son rasoir de l’autre ; et rien du tout, pas ça…Et Fauvette qu’était mort sur sa chaise, avec sa serviette au menton…On n’dira pas qu’y a des drôles de choses qui arrivent ? ». Ces morts ponctuent le récit et mettent à mal toute idée d’héroïsme puisque la fatalité se substitue aux compétences guerrières.
Au-delà des images d’Épinal
Le récit de Vildrac est l’occasion de construire un contre-récit qui n’est plus celui des fiers poilus mais plutôt d’hommes menés tambour battant à l’abattoir
Le récit de Vildrac est aussi l’occasion de construire un contre-récit qui n’est plus celui des fiers poilus mais plutôt d’hommes menés tambour battant à l’abattoir. Dès le début du récit, s’il relève les fanfaronnades de quelques téméraires, il remarque également : « les silencieux, les renfrognés qu’au départ leur jeune femme avait embrassé en pleurant ». Ainsi, Vildrac ne souscrit pas au passage presque obligé de la fleur au fusil. Il s’en prend aussi aux rossignols des carnages, à tous ceux qui n’ont de cesse d’invectiver les soldats à reprendre les armes. Lors d’une permission, il s’emporte comme les poèmes de guerre écrits par Claudel dont l’enthousiasme n’a d’égal que sa méconnaissance du front. Les paroles rituelles prononcées à chaque enterrement de soldats : « Mourir pour la patrie / C’est le sort le plus beau / Le plus digne d’envie » écœurent Vildrac tant elles paraissent vides de sens.
La guerre est nourrie par un imaginaire fait de livres d’histoires, de charges héroïques et de tableaux romantiques. Ces représentations hantent jusqu’aux équipements des soldats : la baïonnette, symbole de la fierté française, héritage de la Révolution, est pourtant bien inutile dans les tranchées : « Dans l’esprit de nos chefs, l’arme blanche était appelée à jouer son rôle légendaire, comme dans les tableaux d’Alphonse de Neuville, où le zouave embroche le Prussien. Je n’ai rencontré, durant toute la guerre, qu’un seul combattant qui avait fait usage de sa baïonnette. » Enfin, le mythe de la mort paisible du soldat est contrecarré par les récits de corps démembrés et par la cohabitation forcée entre les cadavres et les vivants. Cette réflexion a été également été menée par Claude Simon dans L’Acacia où le narrateur revient sur le récit de la mort de son père, tombé au champ d’honneur, selon la formule consacrée et dont la mort est enjolivée : « selon un poncif imprimé dans leur imagination par les illustrations des manuels d’histoire ou les tableaux représentants la mort d’hommes de guerre plus ou moins légendaires, agonisant presque toujours à demi étendus dans l’herbe, la tête et le buste plus ou moins appuyé contre le tronc d’un arbre. »
Échapper à la guerre : le pacifisme
Devant l’horrible et l’absurde monotonie de la guerre, Vildrac fait une profession de foi pacifiste. Il refuse toute promotion : « « Accepter un grade, c’eût été m’engager à exécuter ou à faire exécuter des ordres absurdes ou révoltants pour la conscience comme pour le sens commun », et réussit à changer d’escouade pour devenir brancardier. À ce titre, il note avec fierté que son fusil ni sa baïonnette n’a jamais visé aucun homme. Son expérience en tant que brancardier lui permet d’observer au plus près les stratégies de fuite des soldats qui espèrent tous ce que Genevoix nomme : « la fine blessure » et ce que Vildrac appelle : « la blessure-filon », cette fameuse blessure non mortelle mais qui entraînerait l’évacuation, le séjour à l’hôpital puis le congé de convalescence et, pour les plus chanceux, la fin du conflit.
L’ironie mordante de Vildrac démasque les ordres iniques des officiers.
Vildrac a également le malheur d’assister à l’exécution d’un soldat condamné à mort par le Conseil de guerre pour lâcheté devant l’ennemi. Il décrit l’événement comme « le spectacle le plus atroce » qu’il n’ait jamais vu et qualifie la cérémonie de « parade barbare ». Le condamné lui-même ne croit pas à la réalité de son exécution tant qu’il n’est pas conduit au peloton, et passe une dernière nuit en compagnie de ses camarades à évoquer le sort de ses enfants et de sa femme à l’arrière. L’ironie mordante de Vildrac démasque les ordres iniques des officiers qui, incapables de gagner du terrain ou de remporter une victoire, se déchargent parfois sur leurs hommes. Ainsi, l’un des divertissements de Vildrac pour se soustraire à la monotonie des tranchées consiste à composer des textes parodiques et irrévérencieux, destinés à se moquer de ses supérieurs hiérarchiques.
Grâce à l’intervention de sa femme, Vildrac est affecté en 1916 à la Section de camouflage ce qui lui permet d’être éloigné du Front. Dans ses Chants du désespéré, un quatrain semble faire écho à cette situation : « Et tant mieux pour ce qui a pu / Entre leurs doigts glisser et fuir / Et tant mieux pour ce que le vent / Dans son jeu brusque a pu sauver ».
Le témoignage de Vildrac permet de prendre la mesure de la guerre dans sa quotidienneté. Il emploie volontiers l’argot des tranchées, côtoie des hommes issus des quatre coins de la France et partage avec eux les tâches les plus ingrates. Au début de son récit, après quelques mois passés au Front, Vildrac affirme constater chez lui : « une anesthésie de la sensibilité, un dépassement de l’épouvante ». Pourtant, son texte comporte de rares et doux moments d’accalmie où il déploie un langage plus poétique pour rendre compte de la grâce du moment : « J’ai aimé des bords de rivière, et de la tranchée même, de beaux ciels crépusculaires ou criblés d’étoiles. » Si Vildrac n’a pas le style de Genevoix, il en a assurément l’humanité.