
Zone Critique revient aujourd’hui sur le dernier ouvrage de Jean-Christophe Bailly, Café Neon et autres îles, paru aux éditions Arléa. L’ouvrage se présente comme une série de journaux de voyages écrits entre 1974 et 2016, qui entrecroisent des descriptions de paysages, des souvenirs, des réflexions et des notes bien plus intimes.
Retour aux lieux
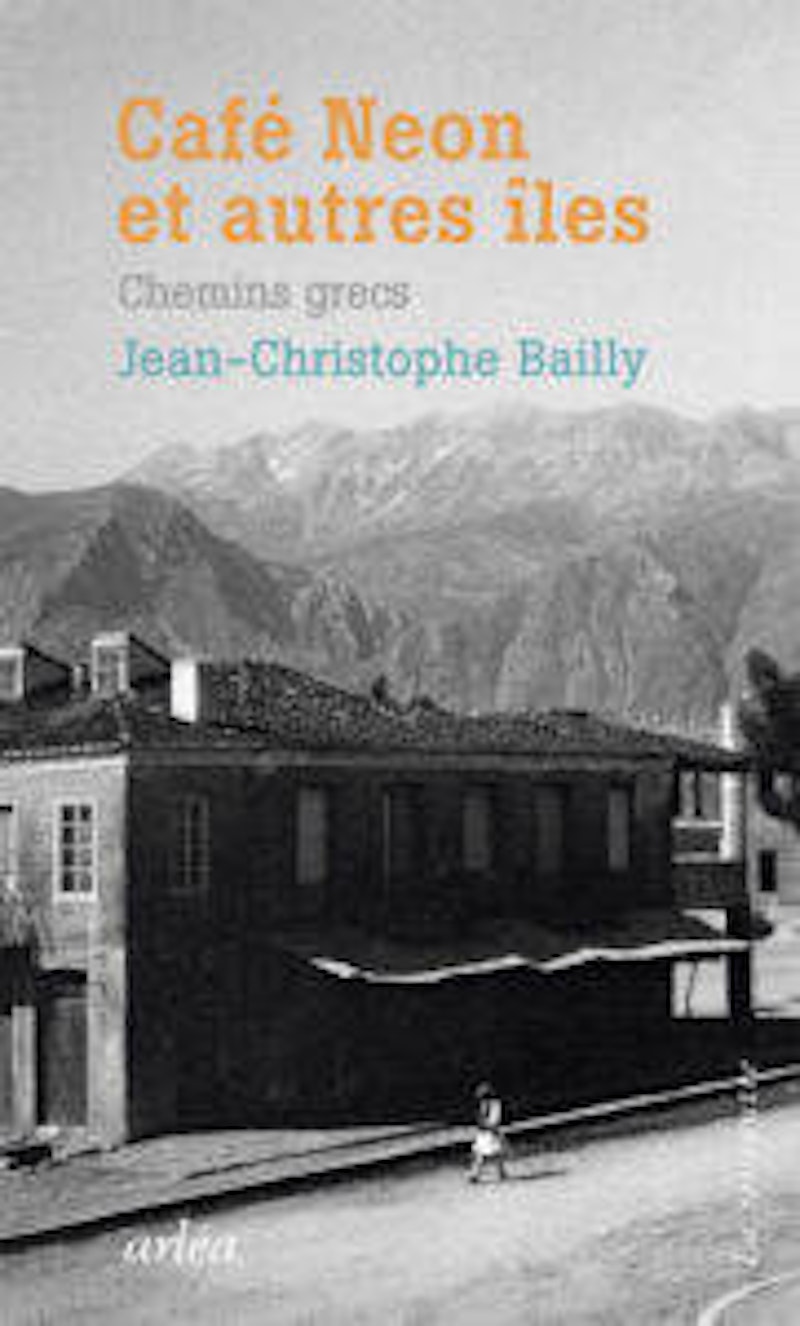
« Entre les impressions, telles qu’un journal de bord parfois tenu hâtivement est apte à les capter, et les souvenirs, tels qu’un texte écrit après coup et plus réflexif les déplie, les écarts, s’ils existent, tiennent aux modes de relations établis avec le matériau initial ».
Et l’auteur nous plonge à loisir dans ses déambulations, dans la mémoire qui sommeille au creux des lieux où il revient, vestige d’un temps intime et d’un temps historique :
« Que de ce pays-là il y ait nostalgie, c’est incontestable, mais ceux qui l’ont connu savent bien qu’il ne se confondait aucunement avec un paradis : la misère était là, encadrée par de tristes sires. Mais tout de même, quitte à verser dans l’imagerie, je ne peux pas oublier ce moment de pur don relevant d’un autre âge : sur un sentier partant dans les collines, une femme qui ne nous connaissait pas, nous tendant en signe de bienvenue, à moi et à ma compagne d’alors, une magnifique grappe de raisin. »
Cette géographie temporelle dessine les contours d’un pays inouï, chante sa beauté, là où “[la] terre encense l’espace. » Puis, plus loin : « Il faut lire un pays par ses chemins. Ici chemins de pierre dans les montagnes, vues changeantes, sentiment de l’île, toit du monde, naufrage. » Il faut se promener, se perdre même. Et là alors la lecture nous embarque dans ces notes, dans ces pérégrinations, expérience du lecteur, expérience du voyageur aussi. De cette manière peut-on lire la délicate note suivante : « Lagada à la tombée de la nuit. Force et beauté, silence. Les pierres luisent dans le soir quand on redescend le chemin. Bonheur de l’ascension récompensée par le cadeau du village à mi-pente. Un chat dort sous la table. »
Cette géographie temporelle dessine les contours d’un pays inouï, chante sa beauté, là où “[la] terre encense l’espace. »
Dès l’arrivée à Amorgos, Bailly est frappé : « Luxe (simple !), calme et volupté sont donc donnés ici, et pour rien. Grande émotion des souvenirs d’il y a treize ou onze ans, les périodes de ma vie glissent les unes sur les autres – tout comme la terrasse qui, du fait du mouvement lancinant du bateau inscrit dans le corps, semble avancer sur la terre. »
Frappé, happé, ravi par les visions, ce qu’elles suscitent. En dehors même de toute fiction et avec une pudeur sensible, l’auteur place son lecteur dans un face à face tragique et heureux. Tragique pour ce qu’il marque du constat du temps, du fini. Heureux pour la douceur des images, pour leur chaleur. Et Bailly semble d’ailleurs s’aventurer vers une approche principalement heureuse, sans déploration. Les seuls regrets sans doute que compte le texte sont ceux qui condamnent la destruction du territoire par les intérêts financiers d’un certain tourisme.
« Tout le temps qui s’est écoulé ne compte pas pour rien, il n’en est peut-être que plus perceptible, mais dans la mesure même où il semble un instant annulé : par la mer, par la forme d’une odeur, par un âne ou un chemin. L’oubli est le contenant de la mémoire, il est comme l’espace où elle respire, nous habitons l’oubli pour nous souvenir. Ce qui tombe dans l’oubli se souvient, s’éloigne dans les choses et nous y attend. »
Des pouvoirs du contemplé
Voyager c’est ouvrir l’œil, s’offrir à la contemplation du monde, lire sur ces images – comme des « paymages »– le passage du temps, l’histoire, et parfois croiser la sienne propre.
« Hauteur des masses désertes qui tombent, silence de ce désert, frange d’eau turquoise puis soudain bleu sombre, qui descend très vite. J’avais pensé il y a treize ans que c’était là un extrait du paradis. Aujourd’hui le car y descend presque, mais rien encore de balnéaire, il s’en faut de beaucoup. Mon dos me tire et je me baigne deux fois dans l’eau irrésistible. Il y a une semaine j’arrivais à Athènes, tout va si vite, même là où tout est lent. »
Ou s’abandonner à la pure contemplation jouissive et heureuse : « Une jolie femme, ou peut-être seulement un joli sourire, passe. Hier c’étaient, dans le bus, de jolies épaules que les secousses de la route faisaient se découvrir peu à peu. Je vois cela, et ma pensée reste immobile. »
Déguster au quai l’étendu de l’océan qui arrime à chaque instant au port, vie de marin, voyageur sans cesse rejoué par le flux des éléments : « Réveillé par le bateau je le regarde arriver dans le port, en fumant une cigarette. Ces moments en terrasse, on ne peut les raconter, tout en eux est séduit. »
L’image, sa fixité et l’évolution de ses contours, de ce qu’elle porte en elle-même ne cesse de témoigner du mouvement de l’histoire, danse temporelle pour le voyageur qui, à chaque retour – Ulysse sans lieu fixe – contemple à l’envi le battement des paysages : « Tout passe, les ans, les êtres, mais le temps seul demeure. Les contenus du temps se déroulent dans le temps qui les contient, illimité, immobile. Et le sens de certains lieux, comme cette île, et de la solitude, est de s’ouvrir à cette dimension immobile et sans pesanteur qui est une tombe et qui tient la vie, l’accueillant et l’abandonnant telle une résistance légère et peut-être importune. »
Bailly invite à lire les lieux, à les ressentir, avec toute la puissance de l’intuition et la fugacité du sentiment.
Ces lieux marquent la chaleur du vécu, conservent pour chacun la délicatesse de la demeure, le poids qui nous enracine et façonne des habitudes qui nous enveloppent. Bailly invite à lire les lieux, à les ressentir, avec toute la puissance de l’intuition et la fugacité du sentiment.
« Chaque soir le pouvoir de ce lieu augmente et je sais que je ne parviendrai pas à le décrire. Mais pourquoi la plus simple route est-elle déjà la grand-route, et pourquoi l’épicerie la plus démunie de l’île a-t-elle les allures d’une mystérieuse caverne aux trésors sortie de l’enfance, et pourquoi les arbres qui sont là et qui ne sont ni comme ceux d’un bois, ni comme ceux d’un parc et encore moins comme ceux d’une avenue encadrent-ils avec tant de perfection cette petite scène magique ? »
Le décor est celui d’une succession de cartes postales intimistes et personnelles, une série de photographies qui rejouent l’imagement cher à Bailly. Alors on peut voir – pose cinématographique – « [une] pompe à essence devant un café peint en bleu. Une cour avec quelques arbustes, quelques tables. »
Et c’est toujours « La ville qui vient avec ces images, c’est la ville même – autrement dit un collectif réel et jamais réuni, une dissémination infinie des lieux et des êtres. Habiter une ville et a fortiori une capitale, c’est habiter cette dissémination, sans jamais la connaître, c’est sauter d’un point à un autre, comme sur les dessins que font les enfants en joignant les pointillés d’une silhouette. »
Le pouvoir de l’image serait bien celui de nous happer, nous embarquant dans son flot de littérature, là où les mots pourtant abdiquent, peinent à rendre compte : « Et tout ceci plus indescriptible que le ciel encore. Décrire est pourtant le but. » C’est un peu plus loin que revient une telle idée, en filigrane dans l’ensemble du livre : « Décrire un paysage est une gageuse. En retenir des anges est possible. Suites d’esquisses où passent en surface les impressions, où s’arrêtent un instant les voyageuses du corps et de l’esprit. » Il faut donc bien goûter à l’intuition des lieux, admirer une beauté de voyageur, dans la mélancolie de ce qui défile, puis « aimer la gare de Corinthe », par exemple. Et se situer encore, s’inscrire dans une géographie.
« Ce qui fait que selon cette levée d’images, une ville naît et vient à notre rencontre, telle qu’en elle-même mais éclatée en mille points de vue singuliers correspondant chacun, non seulement à une localisation précise, mais aussi à une forme de vie qui s’est installée en son sein. »
Et en notre sein persiste une mémoire de cette ville, un croisement de l’espace extérieur et de l’espace intérieur où vivre revient à habiter les lieux, marquer ça ou là ses racines ; et ces villes alors qui scintillent pour ce qu’elles révèlent de notre manière de les habiter, et plus encore de l’intimité qu’elles construisent en nous.
Bibliographie :
Bailly, Jean-Christophe, Café Neon et autres îles, éditions Arléa, 2021.

















