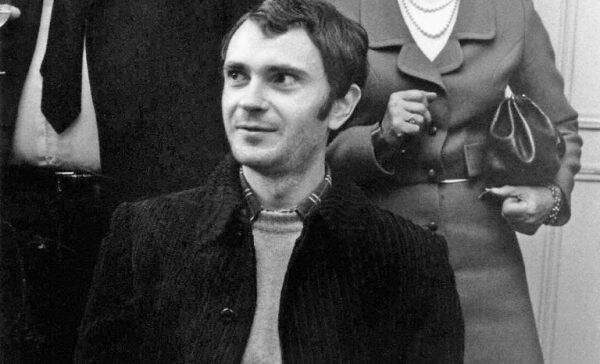Zone Critique poursuit son exploration des écritures des homosexualités masculines par un entretien l’écrivain Gilles Sebhan, à qui l’on doit notamment Tony Duvert, l’enfant silencieux (Denoël, 2010) et Retour à Duvert (Le Dilettante, 2015). Son prochain roman, Tigre obscur, paraîtra au Rouergue en février 2022.

Rodolphe Perez : En guise de préambule, comment présenteriez-vous Duvert, sa place dans les lettres françaises ?
Gilles Sebhan – La place de Duvert me semble unique, un peu comme celle de Sade avant lui, auquel il se réfère maintes fois dans ses livres. Il s’avance sur un territoire interdit et en rapporte une matière noire et irradiante, belle et difficile. C’est pourquoi sa place est à la marge, surtout aujourd’hui. Sa théorisation de la pédophilie était transgressive dans les années 1970, à notre époque elle devient inaudible.
R.P : L’œuvre de Duvert semble marquée par une volonté de dévoiler la parade hypocrite du bourgeois, projet finalement très XVIIémiste, dont, d’ailleurs, il reprend bien des codes : un esprit pessimiste empreint de baroque par moment, un scepticisme certain, une rhétorique du fragment (Abécédaire, notamment)… Bref, un homme qui appartient aussi à une histoire de la littérature, qu’il porte et avec laquelle il joue. D’emblée : la réception coince, on ne peut pas le bannir.
G.S : Duvert était extrêmement sensible aux moralistes du XVIIème siècle ainsi qu’à la prose lumineuse de certains auteurs du XVIIIème. On retrouve l’influence de Rousseau par exemple dans l’un de ses plus beaux textes, Journal d’un innocent. Il avait un grand attachement à une francité classique et aimait beaucoup la campagne tourangelle. Cet attachement au passé de la France allait de pair avec une haine de la société de son temps, petite, mesquine, où tout lui semblait concourir à l’asservissement des enfants.
R.P :Pensez-vous que l’on puisse parler d’une forme de militantisme, dans la situation sur la scène politique de Duvert, notamment dans la critique de ce qu’il nomme « l’hétérocratie » ?
G.S : Il y avait une grande volonté chez Duvert d’intervenir dans le champ de la morale. Il s’agissait pour lui de dénoncer la comédie sociale qui nuit à tous ceux qui sont dans la marge, les enfants, les homosexuels, les fous. Il n’avait pas de mots assez durs pour l’hétérocratie dont il voyait la marque partout. Un de ses amis raconte qu’un soir, place de la République, il a vu Duvert se mettre dans une rage folle parce qu’une femme était en panne et lui demandait de l’aide. Pour lui, c’était d’une ironie terrible car il voyait dans cette femme tout ce qui le condamnait habituellement et à présent elle le transformait en chevalier servant. Inutile de dire que la pauvre femme n’a pas été dépannée! Duvert est parti furieux et vitupérant.
Mais si Duvert a écrit de nombreux essais et articles et qu’il a réellement cru dans un changement des mentalités concernant la sexualité des enfants, il n’a jamais été du côté du militantisme qui suppose qu’on soit plusieurs à agir dans la même direction. Duvert détestait l’idée de groupe. Même ceux qui partageaient ses idées, il finissait par éprouver une rage contre eux. C’était un être fondamentalement asocial et au fil du temps les choses se sont aggravées, jusqu’à la fin qu’on sait, dans la plus complète solitude.
R. P :Il y a, chez Duvert, une forme de réversibilité baroque, d’envers du décor, que l’écriture viendrait démasquer, avec humour ou ironie. Quelque chose parfois d’un théâtre à la Genet. Dans les fictions, la vie est une sorte de théâtre où chacun joue socialement un rôle ou théâtralise sa vie, comme s’il se savait personnage. Seriez-vous d’accord avec ce point de vue et en quoi participe-t-il d’une vision singulière du réel, de son époque ?
G.S : Duvert aimait beaucoup Genet. Et sans doute davantage le Genet des romans que des pièces de théâtre, mais en effet il avait un goût violent pour la vérité. Et une puissance d’analyse hors norme qui le rendait extrêmement sensible à tous les faux-semblants. Dans L’Île atlantique, il décrit particulièrement bien comment toutes les classes sociales jouent une comédie ridicule et insupportable, parfois mortelle. Même les enfants ne sont pas épargnés, car le masque vient très tôt et pour lui, seul un enfant «à la tête dure», différent des autres, représente un homme qui ne s’est pas renié. Il y a donc une grande radicalité dans cette vision de la réalité, une sorte d’hallucination de vérité où les personnages caricaturés sont digne des Caprices de Goya.
R.P : Les personnages donc, assez souvent, initient des scènes. Dans Paysage de fantaisie par exemple, les enfants jouent pour s’autoriser une cruauté infinie : la scène, comme dans les contes finalement, lèvent les interdits moraux, puisque tout se joue dans un monde alternatif, et interroge les valeurs de notre propre contemporanéité. Peut-on – face à ces multiplications de scènes – considérer que Duvert n’aime viscéralement pas son époque ? Qu’est-ce qui – quand on voit, par exemple, comment le malheureux a fini – participe de ce rejet ? Est-ce que Duvert déteste l’époque parce que l’époque le rejette ? Est-ce que pour d’autres raisons ? Comment, au final, pourriez-vous qualifier le rapport de Duvert à sa propre contemporanéité ? Marquée pourtant, au moins sur la question de l’homosexualité, par des avancées sociales et sociétales.
G.S : À quinze ans, Duvert n’aime pas son époque parce que l’école l’a viré pour conduite immorale – il a couché avec un camarade et ses parents l’envoie se faire soigner chez le docteur Eck. Il en ressortira tellement traumatisé qu’il fuguera et fera une tentative de suicide. A vingt-trois ans, Duvert n’aime pas son époque car mai 68 ne l’exalte pas et qu’il commence à comprendre que sa pédophilie le transforme en monstre aux yeux du monde. Il vivra l’illusion que l’homosexualité et la pédophilie sont un même combat jusqu’au début des années 80 où la dépénalisation de l’homosexualité séparera les deux causes et rendra inaudible sa parole. Ensuite, il ne fera que détester davantage l’époque puisqu’elle le condamne au silence et à la pauvreté. Son rapport à l’époque est donc celui d’un amoureux misanthrope. Jusqu’au moment où il renonce tout à fait à intervenir et préfère le silence.
Quant aux jeux dans Paysage de fantaisie, ils me semblent profondément sadiens. Ils sont d’abord des jeux d’écriture, un agencement perpétuellement renouvelé de la sexualité dans la phrase, une tentative de transgression permanente qui permet, à travers une fantaisie, une imagination, d’atteindre une vérité plus pure. Il y a sans doute chez Duvert, au moment de ce livre, l’idée que l’écriture doit s’apparenter à un jeu de massacre. Tout détruire pour que tout recommence autrement. Tout écrire pour que quelque chose enfin soit possible.
R.P :Dans un autre registre, les mises en scène viennent ouvrir aussi à l’exploration d’une sexualité théâtralisée, comme dans Un anneau d’argent à l’oreille par exemple, où Gabriel joue toujours des nouveaux personnages pour coucher avec son amant. Le jouissance érotique se double toujours d’une jouissance de la dramaturgie. Pensez-vous que l’on puisse y voir une constante esthétique et si oui, qu’est-ce qu’elle dit de l’écriture duvertienne ? (mais aussi, sans doute, de toute une tradition underground du travestissement, du masque)
L’écriture assume, finalement, très souvent une sorte de parodie. On le voit avec Stendhal par exemple, dans Un anneau d’argent. Mais comme pour démasquer la parodie de bienséance qui préoccupe tellement la bourgeoisie. C’est un véritable jeu littéraire qui s’ouvre aussi. Qu’est-ce qui explique cela selon vous ? Juste un plaisir d’écriture ou c’est au-delà de cela ? Parce qu’il y a – sans aller jusqu’à parler de paradoxe – un écart assez jouissif et jouisseur entre une maîtrise assumée et réflexive d’une littérature classique – et une dramaturgie très subversive. Il me semble d’ailleurs que l’écriture – le style disons – de Duvert est très classique, il assume une maîtrise sans faille de la langue et l’élaboration d’une transgression ne concerne jamais la langue ou la forme.
G. S :Un anneau d’argent à l’oreille est un roman que j’aime beaucoup mais qui n’a pas très bonne réputation auprès des familiers de l’oeuvre de Duvert. Ainsi, à son propos, René Schérer parle d’une simple «amusette». Il est vrai que c’est sans doute le texte dans lequel Duvert pousse le plus loin le jeu sur les masques, et l’on pense parfois au Balcon de Genet, notamment avec le personnage de l’archevêque. Le dessin de Michel Longuet qui illustre la couverture, avec ses personnages caricaturaux, renforce encore cette impression de parodie. Il s’agit d’un jeu jouissif en effet mais aussi un peu suicidaire de la part de Tony Duvert, dans la mesure où il reprend son univers, ses personnages, et semblent les parodier. C’est très drôle mais on ne peut s’empêcher d’y voir un ricanement de l’auteur face à lui-même. Comme si sa foi en la littérature s’essoufflait. C’est d’ailleurs son dernier roman.
R.P :Toutefois, Duvert a ceci de singulier, qu’à côté des fictions d’auteurs qui, comme lui, donnent très librement court à l’écriture d’un désir homosexuel – et plus largement subversif – qu’il écrit des textes que l’on pourrait qualifier de théoriques. Alors quoi ? Il y a faillite de la fiction ? Elle n’est que ludique et érotique ? On sent bien que la fiction tend à – d’une certaine façon – appliquer la scène du discours théorique.
G.S : Non, je ne crois qu’il y ait chez Duvert l’idée d’une faillite de la fiction, les essais et les romans sont absolument contemporains. Pour lui, il s’agit vraiment d’utiliser toutes les armes possibles pour mener sa guerre contre la société. D’ailleurs, à bien y regarder, le discours argumentatif n’est pas du tout absent des écrits les plus intimes. Ainsi dans Journal d’un innocent où Duvert évoque ses aventures amoureuses au Maroc, il développe une utopie dans laquelle il imagine que la norme serait l’homosexualité et la marge l’hétérosexualité. Cette inversion systématisée produit des effets très drôles mais c’est aussi un texte qui propose une véritable réflexion.
R.P :Ce qui trouble, au sein même de ce propos théorique de Duvert, c’est qu’il s’inscrit dans le même temps – là encore – au sein d’une tradition critique du scepticisme dont la rhétorique tend à montrer cette réversibilité et cette subjectivité des valeurs et des interdits moraux. Dans quelle mesure peut-on prendre cela au sérieux ? D’ailleurs, à quel point Duvert croit-il lui-même à certains propos qu’il défend ?
G.S : Il faut vraiment prendre Duvert au sérieux. Bien sûr, il use de mauvaise foi. Mais fondamentalement ses observations viennent d’une intense réflexion. On ne peut pas imaginer que ses théories sur la pédophilie et sur le fonctionnement de la société en général aient quoi que ce soit d’insincère. Ce n’est pas une posture, pas une provocation. C’est la vérité intrépide d’un écrivain qui croit toujours qu’il va réussir à se faire entendre et à convaincre. Le moment où il comprendra que c’est impossible sera comme une chute dont il ne se relèvera pas.
R.P :Si l’on s’en tient tout simplement au premier paragraphe du roman Un anneau d’argent à l’oreille :
« Marc n’a pas joué à l’enterrement, cet après-midi, malgré le beau temps. Il aime faire le mort, parce qu’on le promène dans une brouette comme un roi fainéant, on pleure et on rit, on lui tire les cheveux, on le pince. » Il y a déjà le goût de l’aventure – et le roman est aussi un peu l’aventure de Marc – qui déplace le subversif dans le monde de l’enfance et a ceci d’exaltant comme de dangereux qu’il se situe avant la morale, avant la construction culturelle – voire cultuelle – de la morale. Comment résoudre alors le problème suivant : si la théorie vise à renverser l’ordre et à promouvoir une liberté du désir, comment exciter le désir de l’aventure, la jouissance du transgressif ? Comment les deux peuvent-ils cohabiter chez Duvert ? Sauf à croire qu’il ne croit pas à son discours théorique. Ou qu’il le dramatise par provocation ?
G. S : C’est toute la question de l’homosexuel qui cherche sans cesse à être accepté au risque d’être assimilé. En quittant la marge il risque de perdre son identité. La question est insoluble. Il n’y a pas de transgression sans loi et peut-être pas d’érotisme sans transgression. Mais dans le cas des enfants chez Duvert, je ne pense pas qu’ils existent avant la morale, avant la culture. L’enfant duvertien, le personnage de Marc par exemple, n’est pas un enfant comme les autres, c’est l’enfant homosexuel – c’est ce que symbolise cette anneau d’argent à l’oreille. C’est lui et lui seul qui représente l’écrivain et qui est le ferment subversif de tout un monde.
R.P :Ne peut-on pas aussi songer à une sorte de nostalgie de l’impossible ? De regret de ne pas être né à la bonne époque ? Une forme de mal du siècle ? Par exemple : « Lorsange se leva et secoue son bras engourdi. Il vit sa belle gueule dans un reflet de fenêtre : la nuit était tombée. Il soupira. Il fallait crever, le monde n’existerait jamais. » Quelque chose du monde est défaillant. Alors quoi ? L’humour comme façon de survivre et de se secourir, malgré un profond pessimisme ? Ou rien de tout cela ?
G. S : Je crois surtout qu’il faut voir en Duvert un profond idéaliste qui se désespère que le monde ne corresponde pas à ses voeux, sans doute dans une douleur assez puérile, comme s’il était resté un enfant que la contrariété de son désir dévaste. «Le monde n’existerait jamais» est une assertion bouleversante. C’est le constat amer que la vie est ratée. C’est pourquoi Un anneau d’argent à l’oreille a du mal à cacher son désespoir derrière le sarcasme.
R.P : Finalement, pour vous, quel rapport Duvert entretient-il avec l’homosexualité ? Dans son écriture, elle n’apparaît pas comme marginale. Ou plutôt, elle autorise une série de marginalité qui en fréquente bien d’autres, comme un nivellement – « normalisation » – des marginalités.
G.S : Pour répondre, sans doute faut-il revenir à son premier livre, Récidive, dans lequel il met en scène le jeune homosexuel qu’il a été. Le titre, comme celui du livre suivant, Interdit de séjour, indique assez bien que l’expérience d’écriture de Duvert se situe dans ce rapport à la loi. Son expérience des marges, et comment s’en étonner, se construit dans les descentes de flics aux Tuileries, dans le mépris des passants, dans les courants d’air gelé d’une ville difficile. Il n’a pas droit de cité, cela il le découvre très tôt, et c’est dans cette interdiction majeure que son écriture se forge.
R.P : Et aujourd’hui ? Le puritanisme que critiquait Duvert aurait-il gagné ? Si je prends, par exemple, l’entrée « conformisme » de L’Abécédaire: « Un homme est conformiste pour dissimuler qu’il n’est même pas un homme. »Qu’est-ce qu’il peut demeurer de la force subversive de ces textes, sans que l’on sombre dans la critique émotive et la mise à l’index, incapable de déceler la littérarité de l’œuvre ? Quelle place pour Duvert aujourd’hui ?
G.S : Je crois que Duvert n’aurait pas pu imaginer le puritanisme qui nous frappe aujourd’hui. Qui l’aurait pu? Car c’est un puritanisme qui ne vient pas seulement des hétérosexuels mais qui s��’exprime au sein même de la communauté homosexuelle. Et qui va de pair avec une sorte de révisionnisme culturel. On ne retient que ce qui arrange cette nouvelle morale. Dans ce contexte, il n’y a aucune place pour Duvert aujourd’hui. Ses livres sont très peu présents dans les librairies. La publication de l’Enfant silencieux, puis de Retour à Duvert, a permis une remise en lumière. Mais de courte durée. Nous en sommes à présent réduits à devoir expliquer pourquoi Duvert est un écrivain important, quelles que soient ses positions sur les questions sexuelles, et aussi pour cette raison même, car sa voix est unique. On voudrait jeter ses livres aux chiens ou qu’ils n’aient jamais existé. Et on compte, à raison, sur l’oublieuse postérité. Pourtant, Duvert a aussi ce côté culte qui lui permettra peut-être de résister à l’effacement.
Pour moi, l’auteur le plus important et le plus radical avec Genet.
R.P :Puis enfin, par pure gourmandise intime : pourquoi votre travail sur Duvert ? Qu’est-ce qui, chez cet auteur, a su vous embarquer ? Puisqu’on en vient rarement à travailler sur un écrivain au hasard, même si cela n’apparaît qu’après-coup.
G.S : La question que vous posez nécessiterait une longue réponse. A vrai dire, j’ai en partie répondu dans l’Enfant silencieux. Je dois la découverte de Duvert, quand j’avais un peu plus de vingt ans, à un ami et mentor. J’ai tout de suite beaucoup aimé son oeuvre, par ses thèmes transgressifs, par son écriture lumineuse. J’y ai reconnu une des grandes voix de la littérature homosexuelle (même si ce concept est très discutable, je l’utilise par commodité). Pour moi, l’auteur le plus important et le plus radical avec Genet. Or, quand je l’ai découvert, il avait déjà un peu disparu et j’attendais avec impatience qu’un nouveau livre de lui sorte mais le silence se prolongeait. J’ai tenté de me renseigner, en vain. Même son éditeur, Jérôme Lindon, ne parvenait plus à le joindre. Quand Tony Duvert est mort, en 2008, ça a été un choc. Il fallait donc sa mort pour avoir enfin de ses nouvelles. J’ai tout de suite senti que si personne ne faisait rien, le silence engloutirait son oeuvre. A l’époque on ne savait rien de Duvert, on n’était même pas sûr que son nom ne soit pas un pseudonyme. Voilà ce qui m’a poussé à travailler sur Duvert. Je souhaitais lutter contre l’oubli en découvrant l’homme qu’il avait été.
- Gilles Sebhan, Tigre Obscur, éditions du Rouergue, février 2022.