Paru en 2022 aux éditions Arléa dans la belle collection « La rencontre », Fils de prolétaire est le premier roman – récit autobiographique – de l’artiste Philippe Herbet : un texte d’une délicatesse bienvenue, qui présente l’enfance comme une série d’images diapositives pour mieux mettre en lumière le retour à soi de l’auteur ; un récit fin et tendre sur le regard de l’enfant.
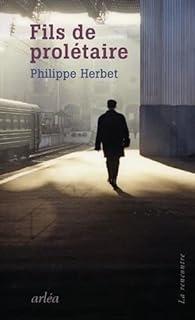
Peinture d’une enfance 1970-1980, que d’aucuns portent au pilori aujourd’hui comme période oh combien coupable d’un présent-catastrophe dont on a tôt fait d’oublier la beauté et les éclats, ce roman autobiographique déploie une lecture photographique – à l’image de la délicate pratique qu’en a son auteur – de cette période, dans une écriture fine et sans vindicte : un texte réconfortant où les images fugaces de l’enfance nous renvoient à nos propres besoins d’émancipation et à l’intemporalité du regard différencié de l’enfant sur ses parents.
Photographies parentales
« Je me suis souvent demandé si mon père était mon père et ma mère ma mère, si je n’étais pas un enfant adopté. » Ainsi s’ouvre le texte de Philippe Herbet. Question essentielle et si banale de la contingence de l’être au monde, si banale précisément qu’elle résonne en nous avec l’acuité de l’évidence. Loin d’une exploration contrariée du rapport aux parents, le récit autobiographique cumule les portraits singuliers et réalistes pour mieux cerner les coutures du sentiment, parfois, d’étrangeté à son propre milieu. Nul besoin ici de changer d’insultes ou de hargne, de culpabilisation outrancière, tout est histoire, contexte, pour sûr, car le milieu explique autant qu’il élève mais aucune colère ne nous empêtre dans une lecture cacophonique. Au contraire, Philippe Herbet s’attache, par touches, à faire défiler les diapositives de la mémoire, dans l’authenticité de l’image, parfois avec tendresse, toujours avec finesse : « Ma mère est une jolie feuille de houx, un gentil lieu commun, une guimauve sentimentale. Ses humeurs filent comme feuille morte au vent d’automne. » Et nous-mêmes guimauves n’ignorons pas parfois le plaisir si rassurant du lieu commun, carrefour aussi de l’imaginaire collectif. Le père, pour sa part, « ne fréquente que des personnes comme lui, humbles et subalternes, qui ont aussi ces qualités qui promettent peu de succès : l’obéissance et la patience, l’abnégation et le renoncement.
Mon père est peu habitué aux caresses, aux manifestations de tendresse, lorsque celui lui arrive, il baisse la tête comme un chien craintif, il se retire, le visage en biais, il se rebiffe, détourne le regard. Il ne pleure jamais, il retient ses émotions, elles lui rongent le coeur. »
L’œil de l’enfant à qui revient l’image, surgissement de l’instantané, transpose dans l’écriture ce regard étranger à la scène. Aussi, Philippe Herbet lie-t-il au regard déculturé de l’enfant – qui ignore la portée de ce qu’il peut voir – celui de l’adulte qui a digéré le temps passé : « Avant d’accomplir son « devoir conjugal », ma mère dit à mon père : Dépêche-toi !
Mon père n’a jamais offert de fleurs à ma mère. Nulle attention, nulle délicatesse, pas de cadeau, pas de signe d’affection. »
Et plus loin : « Fausse couche de ma mère. Ton frère Yves est mort, me dit-elle. Son arrivée est un « accident » ; sa disparition, une fatalité. Puis un secret.
J’entends ce terme horrible : curetage. Le chirurgien manipule un grattoir dans le ventre de ma mère, il évacue un mort, mon frère. Il y a sûrement du sang partout. »
Photographies de l’enfant
Une écriture qui évite la ferveur du pathos sans se refuser à la sensibilité, aboutissant à un équilibre bienvenu dans le roman contemporain.
Ce regard de l’enfant fantomatique qui vit à nouveau l’histoire comme spectateur, s’il n’enlève rien à la violence de certaines scènes de vie, violence en soi, désamorce la dimension traumatique dans écriture qui évite la ferveur du pathos sans se refuser à la sensibilité, aboutissant à un équilibre bienvenu dans le roman contemporain. Il permet par la succession des images de dessiner le décor d’une époque, pointant à l’envi la subjectivité du regard où émerge le sentiment d’étrangeté de l’enfant, attaché ou sans attache.
Car en effet au fil du récit apparaissent ces promesses artistiques qu’a embrassées désormais Philippe Herbet : la photographie bien entendu qui irrigue l’écriture dans la démarche stylistique mais également les lettres. Le goût de la lecture et l’éducation par la culture populaire de l’époque se rejoignent à la faveur du portrait d’une enfance dans le siècle giscardien, et informent surtout le rapport aux autres, et l’exposition de ce qu’il appelle « ma laideur ». Les lunettes, le regard oblique, alors même que c’est le regard du monde qui est bancal, biaisé.
L’enfant fragile, physiquement, trouve la ressource dans le mot, la compagnie de la lecture, car encore c’est « au collège que je découvre que je suis fils de prolétaires, cette épithète savante et peu flatteuse me met peu à l’aise. Me voilà classé en bas de l’échelle sociale. […] Je me sens bien quand je lis ou marche seul dans les rues aux heures creuses de l’après-midi, le monde relâche sa tension. Je respire, happe un peu de cet oxygène qui me manque le reste du temps. Une professeure de français, une demoiselle bossue dont tout le monde se moque ouvertement, m’ouvre l’océan de la littérature. Je m’identifie à Silbermann, au Sagouin et au Grand Meaulnes. »
Jamais la parole ne se déclare comme politique et pourtant l’écriture affirme par sa forme, les regards qu’elle déploie et les imaginaires qu’elle sollicite, que la culture, son accès, sa défense et son usage, sont les dénominateurs les plus manifestes d’une position sociale. « Les envies, les désirs de mes parents sont dictés par les slogans, la mode, le goût des voisins, un grégarisme de classe modeste. » Et plus tard, malgré les rêves aux antipodes – car il faut parfois rêver envers et contre pour mieux trouver l’équilibre d’adoption de son devenir, admettre la simplicité de son propre désir : « Finalement, je ne suis qu’un type assez banal et discret qui aime les horizons dégagés, lire allongé sur un divan, faire l’amour l’après-midi et les longs crépuscules bleutés du temps de Pâques. » Et quels plaisirs.
Le texte se fait saisie photographique d’instants de vie, nous transforme en spectateurs étourdis d’une enfance qui défile et revient dans ces images, si elle n’est pas la nôtre, elle nous est d’une familiarité confondante. Ode à la littérature et à la lecture, mais aussi à la paix avec l’histoire, le roman rappelle la force identificatoire, les espaces inouïes de possibilités et d’imagination qu’elle soulève, éveille en nous.
- Philippe Herbet, Fils de Prolétaire, Arléa 2022.

















