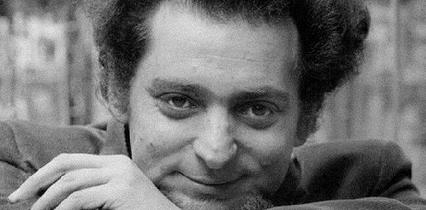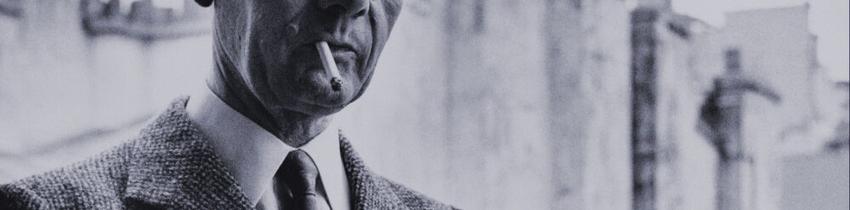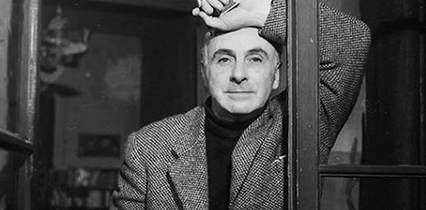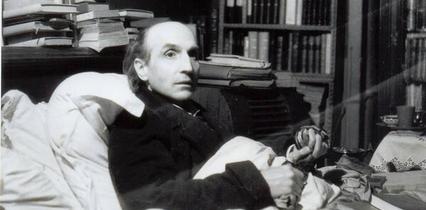Rends ta couronne d’Agathe Saint-Maur, publié au Castor Astral, se déploie à partir d’une rupture amoureuse mais dépasse ce moment singulier pour finalement embrasser toutes les modalités de l’amouret pour interroger notre rapport au langage et au réel. Agathe Saint-Maur y explore la tension entre le besoin de structurer l’expérience et la résistance du réel à toute mise en ordre. Entre humour, ironie et précision critique, elle pose une question essentielle : que peut la littérature face à la désillusion amoureuse ?Un recueil à la fois drôle, exigeant et sensible.
Après avoir écrit De sel et de fumée (Gallimard, 2021), tu signes un recueil au Castor Astral à la forme très libre.Pourquoi passer du roman à la poésie ? Est-ce que l’on peut finalement y dire plus de choses grâce à la liberté formelle qu’elle permet ? Ton recueil témoigne en tout cas d’un rêve d’une forme pure et circulaire, qui obéit à la nécessité de l’instant et à la logique du souvenir.
Agathe Saint-Maur : C’est drôle, on dit « j’avais envie de tirer un trait », sur telle histoire, sur tel lien. C’est, au sens littéral, ce qu’il s’est passé pour moi avec ce texte. Je me sentais alors dans un état de grande confusion, personnelle et artistique. J’avais envie d’en finir avec un garçon qui se comportait de manière malsaine et j’essayais en même temps d’écrire un deuxième roman. Et les deux se sont confondus. J’essayais de comprendre ce qui m’est arrivé avec ce garçon à travers le roman, qui est un des moyens dont je dispose pour comprendre le monde. Le truc, c’est qu’alors que j’essayais de tirer un trait, c’est-à-dire de tracer sur une feuille ce qui m’était arrivé avec ce garçon pour me le figurer, le comprendre dans le temps et dans l’espace, j’ai constaté que ça ne collait pas avec les exigences du roman. Le roman exige une autre sorte de trait. Un fil, si possible linéaire, en tout cas une narration, avec un impératif autonome qui ne se recoupe pas, en tout cas pas totalement, avec celui du réel. Et ce qui m’importait le plus, à ce moment-là, et je crois qu’on le comprend à travers le martèlement obsessionnel de ce mot à travers mon recueil « Rends ta couronne », c’était le réel. Le réel. Pas le roman. Alors j’ai essayé de comprendre le réel dans un autre endroit. Puisque le tracé de la vie dépassait du roman. Que la vie n’était pas assez raisonnable et lisible pour le roman. La poésie, c’était une autre tentative d’esquisse. Et alors là – c’est incroyable – j’ai découvert que c’était le trait de la vie qui était trop rigide pour la poésie, qui dit quelque chose de vrai sur la fluidité. La poésie, c’était encore une autre façon de tirer des traits, discontinue, souple, saccadée.
La poésie, c’était encore une autre façon de tirer des traits, discontinue, souple, saccadée.
Le rapport entre la poésie et le roman, je me le figure comme une mise en scène de théâtre. Parfois, c’est une grosse production, avec beaucoup d’acteurs, des danseurs, des décors pastels, de la musique. Parfois c’est de l’opéra en costume illustré par de grands tableaux baroques. Et puis parfois c’est juste un monologue, une meuf toute seule debout, les poings dans les poches. Pour moi, le roman, c’est une plus grosse production que la poésie. Dans un cas, je tire un trait debout, les poings dans les poches (pas les mains quand même – il faut travailler un peu), dans l’autre, j’aide Kamel Ouali à fabriquer un soleil en carton-pâte. Dans les deux cas, il y aura du langage.
Dans tes poèmes, et dans tes textes en général, notamment ou dans ton premier roman – tu évoques les relations amoureuses. Est-ce pour toi une source d’inspiration essentielle dans ton écriture ?
Agathe Saint-Maur : Plus le temps passe plus je constate qu’il y a trois choses qui m’intéressent dans la vie, enfin il y a plein de choses qui m’intéressent, mais trois pôles, comme trois grand pôles. Avant, dans un texte, que je n’ai pas mis dans le recueil, j’aurais dit: les hommes, l’art, la religion ; et finalement, maintenant je dis – et ça les englobe tous – la politique, l’amour, et la morale – enfin l’éthique, parce qu’on dit l’éthique quand on est de gauche. Et ces trois pôles, évidemment, interagissent, se frottent, s’adossent l’un à l’autre. Le plus intéressant c’est les frottements des trois. Et donc, la politique, ça emmerde tout le monde, et en ce moment surtout ça donne envie de se tirer une balle – pour paraphraser : tout le monde. L’éthique, moi-même je n’y comprends rien, j’ai l’impression de ne pas avoir encore touché le fond avec le pied. L’amour non plus tu me diras, mais c’est moins grave, je trouve, de raconter n’importe quoi au sujet de l’amour. Alors l’amour, oui.
C’est très banal ce que je vais dire, mais plus qu’une source d’écriture, c’est une source de vie, l’amour. C’est vraiment ce qui me meut, mais pas pour avoir l’air d’être quelqu’un de bien, juste parce que c’est la chose la plus intéressante. Mais j’entends l’amour, et je le dis dans le recueil, de façon particulièrement vaste, c’est-à-dire, peut-être, comme une forme d’attention et de compréhension portée à l’autre. On est plus proche de la charité chrétienne : je te vois, j’essaie de te comprendre complètement. Dans la ville, je suis souvent emplie de beaucoup d’amour pour les corps. Au café, sur les boulevards. C’est pour ça que j’aime tant le travail de Milène Tournier, qui est une poétesse et autrice de théâtre que j’admire, qui a écrit plusieurs recueils sur ce que lui a soufflé la ville (c’est le titre de son recueil, ce que m’a soufflé la ville) et qui fait toucher du doigt comment, quand on parvient à être attentif, vraiment très attentif, il y a une joie gigantesque à aimer la façon dont les corps décident de faire l’expérience de cette existence.
L’une des forces de ce recueil, c’est ton humour, qui déconstruit la syntaxe et dynamite le sens : “Quand Colin n’est pas là / Colin c’est mon mec / l’officiel / mon mari comme au seizième / ou dans le / Quand Colin n’est pas là / Je vois pas Colin (bac + 10 pas volé) ce qui est déjà complètement déprimant”. C’est assez rare d’écrire des poèmes qui soient drôles, tristes et qui embrassent aussi la colère. Pourquoi ce mélange des genres ?
Agathe Saint-Maur : C’est très banal mais à un certain point, si on ne rit pas, on meurt – ou on angoisse à mort. Cet alliage d’éléments négatifs et du rire je l’ai beaucoup vu, par exemple, dans le monde du stand-up : Norma qui a fait un stand-up très drôle, Normale, sur l’inceste qu’elle a subi quand elle était enfant, Tahnee qui évoque l’homophobie et le racisme dont elle a pu être victime en tant que femme lesbienne noire. Mais on le voit aussi en littérature. Par exemple, dans L’Hospitalité au démon, de Constantin Alexandrakis, texte très drôle dans lequel l’auteur revient pourtant sur les violences sexuelles qu’il a subies enfant.
À un certain point, si on ne rit pas, on meurt – ou on angoisse à mort.
C’est Freud qui considérait que le rire est une manière d’économiser de l’énergie psychique : au lieu d’être dépensée dans le refoulement (source d’angoisse), l’humour libère cette énergie du psychisme sous forme de plaisir. En psychanalyse, on classe souvent le rire parmi les mécanismes de défenses matures, au même titre que la sublimation – dont l’art participe. Enfin, c’est aussi une manifestation de jouissance, le rire, puisqu’il échappe au moins en partie à la rationalité. Donc ensuite, sur l’alternance des tonalités dans mon texte, peut-être que c’est tout simplement parce que je ne suis pas mature ou rationnelle à tous égards, alors mon propos non plus. C’est une composition de différentes façons de faire exister des affects.
Tes poèmes se construisent fréquemment à partir de ton corps et de tes sensations. Dans l’un de tes textes, « Caprice », tu parles de ce hiatus entre les mots et les choses. As-tu toujours l’impression que l’écriture est insuffisante à rendre compte du corps ? (On retrouve cette même idée dans ton fantasme de te faire tatouer toutes les phrases que tu aimes)
Agathe Saint-Maur : Je ne sais pas si c’est une insuffisance – même si parfois écrire me décourage, ce qui peut donner cette impression – parce que ce sont deux lieux distincts. Il y aurait insuffisance s’il s’agissait d’évaluer une forme d’efficacité, celle de l’écriture à restituer le réel. Ça n’est pas son objet. Comme on ne mesure pas une orange à sa capacité à faire un bon banana-split. Je ne pourrai jamais choisir entre la littérature et le réel. Heureusement l’équation ne se pose pas comme ça. Heureusement cette vie nous permet d’être dedans-dehors. Ça me rassure comme s’il y avait toujours une sortie de secours dans l’avion. Une vraiment utilisable (j’ai peur en avion, justement car je ne crois pas à leurs fausses sorties de secours). Le corps c’est quelque chose d’indicible. Sa puissance. Mais la littérature et sa puissance sont quelque chose d’irreprésentable, au même titre. On ne va pas la mimer. Sinon c’est du théâtre, ça n’est plus pleinement elle. On ne pourra jamais l’incarner assez dans la vie des chairs.
Maintenant, c’est intéressant que tu identifies le sujet du hiatus entre les mots et les choses, notamment dans le texte « Caprice ». Parce que si ce livre a une origine, c’est celle d’un hiatus entre les mots et les choses. Mais celui que j’avais identifié n’était pas le mien, c’était celui d’un garçon que je laissais me faire tourner en bourrique. Toxique (Marc Joly, sociologue, plaide pour la réhabilitation de l’expression « pervers narcissique », comme catégorie utile d’alerte, indépendamment de son exactitude psychanalytique dans la situation décrite, comme mot permettant effectivement de désigner l’anormalité d’un comportement à fin d’en sortir. Donc va pour toxique). C’est intéressant alors que le hiatus dont tu parles soit le mien. Ça n’est donc pas qu’un symptôme, ou alors celui de tous les humains.
La politique rentre par effraction dans ton texte. Dès le premier texte, tu évoques MeToo mais en même temps, tu récuses la posture d’écrivain politique : “On n’est pas en train d’écrire des slogans sur un carton en vue d’aller en manif (eh bien non, puisqu’on est des écrivains conservateurs)”. Quel regard portes-tu sur les rapports entre la poésie et l’action ?
Agathe Saint-Maur : Conservateurs dans ma bouche ça ne désigne pas les affreux jojos de droite qui se cramponnent à tout prix aux institutions et à la sauvegarde, face à une menace paranoïaque, de la famille, le travail, la Nation, et tout un tas de sacs de toile vides comme ça. Conservateur c’est un mot que je veux vraiment qu’on reprenne, que la gauche reprenne, parce qu’il y a des choses qu’on veut conserver très fort, on a le droit de vouloir conserver des choses et de revendiquer ça, en particulier en période de néo-libéralisme, où des gens – Cyril Hanouna, il y a quelques jours – disent « L’Etat c’est une entreprise » ; eh bien non, Cyril. Dans une période, donc, de néo-libéralisme et de néo-management où l’administration de la plus grande puissance mondiale trouve qu’il y a trop de normes et que vraiment, il faut dégager tout ça, c’est presque un devoir, à gauche, de se positionner pour dire : non, non, ça, on garde. Ça on veut garder. On veut garder : le service public, on veut garder : les systèmes de solidarité nationaux, on veut garder : les soins gratuits, etc .
Je fais pas ce rappel par coquetterie, mais parce que je pense que je transpose ce rapport à la littérature. Je suis intéressée par plein de nouvelles formes, je trouve qu’il y a des choses très belles – venues d’autres domaines : de la politique, de l’image, de la musique populaire – qui parviennent jusqu’à la littérature, et c’est pour le mieux, mais en même temps, je lâcherai rien sur le fait qu’il y a des choses à garder dans le classicisme littéraire, dans la forme polie par des années et des années de critique littéraire – bourgeoise. Un auteur que j’adore, c’est Joseph Andras, et Joseph Andras c’est cela : il est exactement dedans (la méthode classique) mais sa langue est portée par un ton, par des aspérités tout à fait inédites. Et c’est incroyable. Donc conservateur à-demi, dans un sens esthétique seulement, bien trié.
Pour en revenir à ta question, mon rapport entre l’écriture, la littérature et l’action, il est pareil : timoré. J’aime bien l’idée, qui peut être portée par quelqu’un comme Bégaudeau, que la littérature c’est déjà du temps volé au capitalisme et à ses impératifs de productivité, c’est déjà une dépense gratuite, donc c’est en soi un acte contre le capitalisme. Et en même temps, j’ai la sensation qu’il faut faire autre chose. Qu’on ne peut pas faire que ça. Qu’il y a besoin de prendre le monde.
La littérature seule a le luxe de la nuance. Et c’est vrai que c’est un espace qui suspend, qui n’est pas opérationnel.
Quelque part dans le recueil, je dis que la littérature seule a le luxe de la nuance. Et c’est vrai que c’est un espace qui suspend, qui n’est pas opérationnel. Je travaille toute la journée dans une administration, avant je travaillais dans un tribunal, où il s’agit d’être opérationnel, décisif. On se rend compte que quand on agit, quand on est obligés d’agir, on est aussitôt positionné à un endroit qui fait pencher la balance (sans mauvaise métaphore) plutôt d’un côté ou de l’autre. La littérature aussi, dans l’ensemble, quand on prend du recul, finit presque toujours par être positionnée, mais c’est un positionnement plus fin, on peut occuper une surface plus ample. En quoi c’est sa force. Mais c’est contradictoire aussi avec le fait de vivre dans le monde. De malaxer le réel. Et à la fin, dans des situations où le monde se tend, on en voit les limites.
En ce moment, je lis le livre formidable, brillant, de Naomi Klein, « Le double – voyage dans le monde miroir » et elle écrit quelque chose qui m’a frappée. Elle dit, je le cite de mémoire, « c’est vrai, on [la gauche] a réussi à faire changer le langage » (on dit racisé – ça c’est moi qui le dis – on parle de changement climatique, on énonce ses pronoms, on fait attention à ce qu’on dit parce qu’on sait qu’on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, cf Yann Moix et Depardieu). Donc ça, oui, c’est une victoire de la gauche. Mais on arrive à cette victoire, dit-elle, au moment où le langage n’a jamais été aussi dévalué. On gagne dans la langue au moment où la langue perd. Est concurrencée – beaucoup par l’image. Par l’émotion. Et elle identifie ça comme une limite de la gauche, au sens où la victoire s’est arrêtée au champ le plus déprécié actuellement. J’en comprends qu’on ne peut pas faire que dire, ou qu’écrire.
- Agathe Saint-Maur, Rends ta couronne, Castor Astral, 2025.