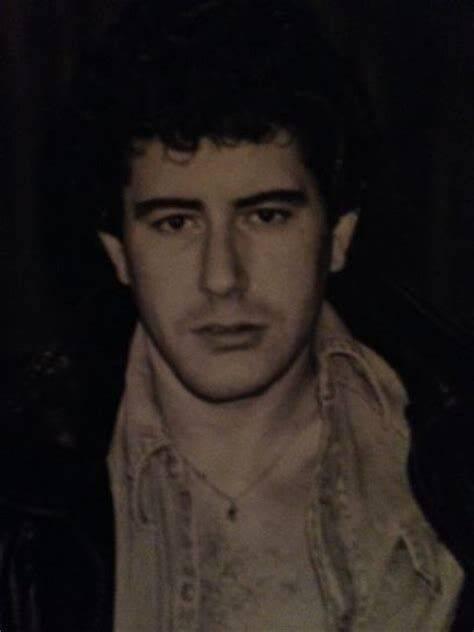Zone Critique poursuit son dossier dominical consacré aux écritures de l’homosexualité, avec la figure de Denis Belloc, dont certains romans ont été réédités il y a quelques années aux éditions du Chemin de fer. L’écrivain Patrick Autréaux nous propose un article inédit, qui explore la présence si peu connue de Belloc.

Je l’aperçois entre les bruyantes figures d’une époque révolue. Rétrospectivement, car leurs noms n’étaient alors pour moi que des échos. Ses livres sur l’étagère côtoient ceux de Hocquenghem, Dustan, Guibert, Collard, et quelques autres. Je les ai trouvés chez un brocanteur. Et, par un hasard qui vaut rencontre, alors que je venais de découvrir une réédition de son premier roman Néons. Il semblait surgir de cette inépuisable réserve des oubliés.
Ce coup de poing inaugural avait été pourtant reconnu par une drôle de fée. Marguerite Duras elle-même avait pointé sur lui son doigt de justice. Un geste (et long entretien dans Libération) qui embrassait le texte, le dénudait à l’os, adoubait son auteur. Mais les fées sont aussi impuissantes que le bon dieu à vous assurer du destin.
On venait de passer des années sida aux années pacs. Les autres étaient morts, lui le seul prolo se taisait.
Certes D. Belloc n’était pas resté l’auteur d’un livre. D’autres avaient suivi jusqu’en 2000 : Suzanne sur la jeunesse de sa mère et ce père mort d’un mauvais coup lors d’un match de boxe, Kepas sur la dope, et quelques romans arrachés à ce que Duras nommait « la nuit sociale ». Et puis plus rien. On venait de passer des années sida aux années pacs. Les autres étaient morts, lui le seul prolo se taisait. Épuisé de came et d’alcool, rapporterait un de ses admirateurs américains. Et peut-être de ce qu’il aurait résumé d’un : ça m’emmerde. Le cri d’un homme qui n’évite plus l’évidence qu’il n’a jamais été qu’en sursis de son milieu.
C’est beau mais c’est glauque, dit Triche, la trav dans Les Ailes de Julien. Elle sermonne le trop jeune fugueur qui découvre Paris, Paris la nuit. Y’a des jours où il fait nuit, je t’interdis d’aimer la nuit ! dit-elle encore. Au-delà du glauque, n’est-ce pas où il faut descendre pour écrire ? C’est en se méfiant qu’il faudrait aborder les livres de D. Belloc. Du peu et du trop qu’il écrit. Deux crêtes s’y esquissent sur un terreau souvent autobiographique : la ligne de la famille, père violent mère buveuse fils fugueur, et dans ce triangle un marais, l’inceste qui menace ou les insultes, les gnons et les cocards, la langue sans gêne et serrée comme un filet dont on semble ne pouvoir se dépêtrer. Et puis le monde des tantes, de la came et des prostitués, des petits cris qu’on pousse la nuit en remontant le boulevard de Clichy ; non pas le folklore des tapins, mais une solitude si souillée qu’on n’existe plus. Une sorte de coma, souffle Belloc. Où s’obstine pourtant un désir de pureté. Mais qui conduit au suicide. Tu as montré la nuit que tu as dans ta tête, dit Duras.
Dans un entretien télévisé, après la parution de Néons, le causeur qui l’interroge le soupçonne d’exagérer un peu. D’un air très doux qui prévient le chaland naïf, il répond que la réalité est beaucoup plus forte. On lui fait remarquer son parler âpre, cru, violent. C’est le parler quotidien, rétorque-t-il. Deux réalités se font face sur l’arène où guette le corps noir et cornu d’un monde dont ont peur même ceux qui y sont piégés. On s’y cogne, s’y dépucèle avec brutalité, on y baise debout dans les pissotières, y jouit peu ou pas, on y cohabite avec les bougnoules youpins et tapettes qu’on n’aime pas, mais avec qui on est tout sourire dans l’escalier. On y écoute les murs, qui ne séparent que pour parquer chacun dans son isolement. Il y a les bruits des corps malades et les coups des dingues du dessus. Les bruits ça s’infiltre partout, ça ne laisse jamais rêver. On n’y lit pas sauf les marques et les promos du supermarché, parfois L’Huma ou Stephen King pour se donner des frissons. Il y a un père qui tabasse, il y a une mère qui gueule et picole. Et ce jusque dans son dernier roman, Un samedi soir chez Bob. On en sort atteint, on voudrait fuguer, on comprend bien les gosses qui décampent, mais on garde le nez collé aux relents d’un réel d’où rien ne nous arrache, d’où on ne peut être expulsé que pour la poubelle. Et pour éviter ça, on reste la joue coincée sur le bitume sale ou un capot de voiture. Que ça passe. Ou alors on se cloue à la nuit à coup de cachetons et de dope.
C’est un monde crasseux qui patauge, presque beckettien. On s’y agite mais on fait du surplace. On devient « l’absence maquillée ». Ou quand les éjaculations sont amères, on n’est plus que les reliques d’une innocence imaginaire : « Je suis mon cartable posé dans la pissotière. » On avale tout des plastiques de la vie, tout des détritus des autres, de soi, tout ce qui flotte et nous pollue. On refile ce qu’on porte de déchets à ses enfants, ou de tréponèmes à des amants qu’on méprise. Parfois il y a des anges gardiens. Pas des sauveurs, mais qui veulent protéger quand même, voudraient mieux. Et au-dessus d’eux, l’auteur jamais complaisant, sans caparaçon identitaire, ne cache rien de l’ignoble mais sans juger ceux qu’il agite devant nous.
Un écrivain, c’est un type qui boite dans la vie.
Voilà ce D. Belloc, qui tient à son initiale sans expliquer pourquoi. On pose de toute façon trop de questions. Et rarement les bonnes. Disons que son prénom se fait presque particule. Ou béquille. Un écrivain, c’est un type qui boite dans la vie.
…à Denis Belloc
Car il y a aussi Denis Belloc. Tel qu’on peut le revoir dans les rares entretiens télévisés. Avec Pivot, ce « receleur qui pose au critique littéraire », écrit Raymond Cousse, il a l’aura du primo romancier, Duras penchée sur le berceau, sous haute protection donc. Avec Méphisto Ardisson, trois livres plus tard, il apparaît au Palace en auteur perfecto toxico.
Les deux journalistes tentent de jouer sur le malsain du loulou. C’est que les ingrédients y sont : giton des pissotières, enculé qui aime ça, petit casseur récidiviste qui a connu maison de correction et tôle ; et qui, pour son portrait chinois, se dit en insulte un enculé, en vice les avoir tous mais surtout pédé, en maladie un cancer crado, en mort violente un crash en avion, en supplice celui du pal évidemment, en poison l’arsenic. Mais dans l’une et l’autre émission, on voit un homme réservé, qui sourit peu, a peut-être peur ou qui s’en fout – même chose. Et par contraste, c’est la vulgarité des questionneurs qui gêne. L’absence de délicatesse et le dédain de l’un, l’intérêt voyeur de l’autre. Devant eux, on dirait qu’il concède plus qu’il ne répond, avec l’élégance d’un homme qui a dû traverser des descentes et esseulements si ravageurs qu’il n’en reste que cet effacement sans tapage, sans pose.
On sent que Belloc aimerait parler de la peinture, juste pour montrer comme est dangereuse l’écriture, si trompeusement banalisée par le receleur devant lui qui dégaine ses petits jugements, qui guette et condescend.
Face à Pivot, qui semble le subir, il s’affirme peintre. Et qui a fait de nombreuses expositions, précise-t-il. Il faudrait expliquer que les couleurs et les graffitis l’ont sauvé d’une spirale qui le menait au sans-retour. Peintre-écrivain qui sait aussi qu’écrire entraîne sur le rebord inquiétant de la fenêtre. Il dit cela à quelqu’un pour qui ça paraît être « de la littérature », et ça se voit à cette moue distante, à cette écoute qui a aux lèvres : Ne nous la fais pas trop, mon gars. Ne pas trop la faire, non, et pas seulement à qui pelote ses livres plus qu’il ne les lit, mais à nous qui ne voulons pas toujours savoir ce qu’est un écrivain. On sent que Belloc aimerait parler de la peinture, juste pour montrer comme est dangereuse l’écriture, si trompeusement banalisée par le receleur devant lui qui dégaine ses petits jugements, qui guette et condescend. Mais il reste sage, d’une sagesse sans rage, taiseuse, dont on se demande si elle ne pourrait pas soudain se lever et dire : Monsieur, je vois votre mépris et votre morgue, la vulgarité de vos intentions me répugne, vous me faites chier. Pas seulement vous, monsieur, mais tout ce que vous représentez. Tout ça me fait chier. Mais il se tait et fend d’un sourire ce jeune et grave visage, presque triste.
Chez Méphisto, la vulgarité est plus cynique, elle le fait grimacer plutôt que sourire en coin. Après tout, Ardisson, c’est un peu le Laclos de la télévision d’alors. On fait scandale en moraliste. Denis Belloc ne parle plus de peinture, mais de la dope qui mange tout – sexe, amitiés, corps, écriture aussi, peinture sans doute –, du verlan qu’on lui reproche, du réalisme. Il pourrait parler de l’illisibilité foncière de celui qui dit juste, mais préfère laisser plutôt entendre qu’écrire mène trop loin. Qu’écrire fait replonger.Qu’écrire a pu rester encore possible. Même si les critiques lancent leur acide. Il est vrai que les jeteurs d’acide, l’écrivain qu’il est les emmerde. Emmerder le monde est la défense de qui n’a pas le pouvoir de nuire. C’est ce que je vois dans son visage : une incroyable innocence qui s’accuse de tous les vices, les a sans doute. L’innocence de qui connaît si intimement la salissure qu’il n’a même pas besoin de la méchanceté.
Il reste pétri de cette chair pâle, presque fade, du milieu d’où il vient.
Belloc, comme les saints larrons incertains d’eux-mêmes, peut regarder le mal dans les yeux. De cette force très humble, il ne tire aucune gloire. Devant Pivot, Collard a le charme brisé de qui va mourir et Hocquenghem prend d’un peu haut le receleur qui avec lui reste prudent ; chez Ardisson, Dustan à la perruque séduit en contre-séduisant. Belloc lui transpire quelque chose de blême et un sérieux presque enfantin. Il reste pétri de cette chair pâle, presque fade, du milieu d’où il vient. Petit délinquant et victime, il est sorti de là mais semble suspendu dans son camp. Sans le vouloir. Il se tient dans un entre-deux. Ça m’a toujours emmerdé l’existence, dit-il. Peut-être qu’il se sait piégé de toute façon. Il n’y a pas de transfuge ni de salut social, seulement des tolérances et des compromis. Il se sait piégé mais ne se débat pas, ne milite pas. La lutte des classes le gonfle, écrit-il quelque part. Mais se dire pédé lui fait esquisser un sourire joueur. Ça vous gêne ? Il serait parmi les derniers de la race d’ep. Du genre non tapageur, « j’ai jamais aimé parler », préférant zoner en lisière des jours, « je regarde et j’attends la nuit. » Et qui vit « d’immenses solitudes. » C’est qu’il souffre moins d’oppression que de séparation, aurait écrit Hocquenghem.
Belloc, comme les saints larrons incertains d’eux-mêmes, peut regarder le mal dans les yeux. De cette force très humble, il ne tire aucune gloire.
Saint méconnu qui vit dans des limbes, Belloc s’y noiera sans doute. Cela paraît plus évident depuis qu’il a cessé d’écrire. Sa mort aura passé presque inaperçue près de quinze ans plus tard. Et c’est ce qui est déjà manifeste face à ces gens de télévision : encore jeune mais revenu de tout, il les rend perplexes, parce que sa limpidité trouble est immiscible dans le milieu des lettres.
Tant mieux. C’est elle qui le contraint, bonhomme et écriture, à récolter sur cette frontière, où presque rien ne se voit, une sorte de manne : ce qui flocule quand on écrit en « resserrant les boulons », comme il dit, ou citant Duras, « à la crête des mots. » Là où vient rôder le corps noir et cornu de ce qu’on doit écrire. Et que personne ne peut vraiment lire. Mais de qui est-ce l’affaire après tout ? Ce qui compte, c’est de danser avec les papillons de nuit. Pour enfin pouvoir tranquillement se taire.
Dès Néons, on demandait : Êtes-vous réconcilié avec la vie ? Et lui : Un peu, on n’est jamais réconcilié avec la vie.
Patrick Autréaux
- D. Belloc, Néons, Editions Lieu Communs, 2006