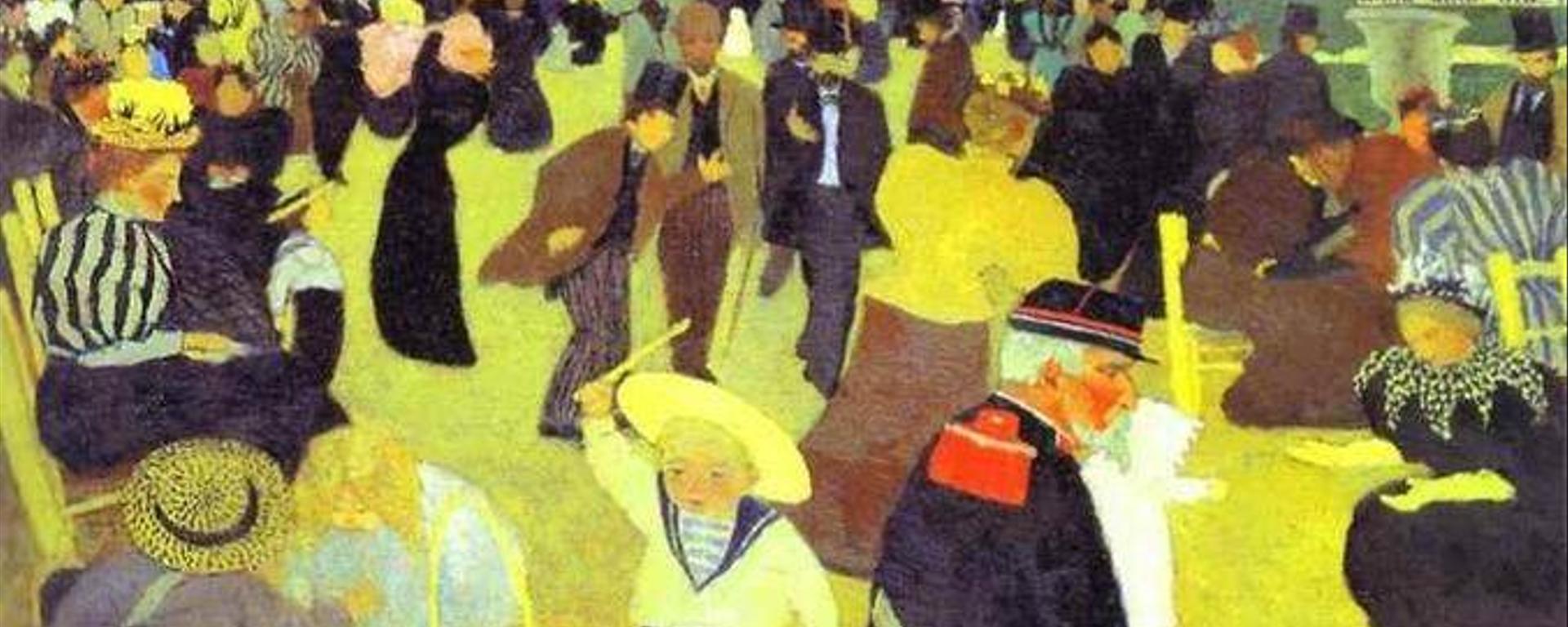Alors que Remise de peine sera republié demain dans la collection Signature de Points, Zone Critique prend le parti de se pencher sur l’un des romans les moins connus de Patrick Modiano, et pourtant les plus intéressants, Chien de printemps. Celui-ci raconte l’enquête difficile d’un écrivain sur la vie du photographe Francis Jansen, trente ans après la disparition de ce dernier.
Imaginaires multiples
Francis Jansen est un célèbre photographe. Le narrateur de Chien de printemps se souvient brusquement de cette homme qu’il a connu trente auparavant, dans les années 60. Le narrateur mène des recherches sur la vie de cet artiste qui a voulu disparaître sans laisser de traces. A partir des clichés pris par le photographe, que le narrateur avait voulu conservés à l’époque et classés dans un cahier, ce roman raconte l’écriture difficile de la vie de Francis Jansen par son jeune ami, trente ans après. Ce roman raconte finalement sa propre écriture. Le narrateur va s’appuyer sur le souvenir des connaissances de cette époque d’après-guerre, gravitant autour de Jansen: Robert Capa le fondateur de l’agence Magnum, Colette Laurent, le couple Meyendorff, Eugène Deckers, Jacques Besse, Nicole et son horrible mari, le Mime Gil.
C’est une quête littéraire du souvenir qui se réalise grâce à plusieurs imaginaires. Les images photographiques d’abord, qui portent au dos des annotations très précieuses pour recouvrer le souvenir de la vie du photographe, et de ses amis comme la numéro «332 Colette. Rue de l’Aude». Mais aussi l’imaginaire très riche de la géographie parisienne, répertorié grâce aux photos (325. Palissade de la rue des Envierges ; 327. Escalier de la rue Lauzin ; 328. Passerelle de la Mare ; 331. pente de la rue Westermann). C’est le souvenir de ce Paris d’après la Libération qui permet de dessiner le contour de certaines rencontres cruciales dans cette recherche du temps perdu modianesque. C’est en se rappelant d’une marche avec sa mère «au coin de la rue Saint-Guillaume et du Boulevard Saint-Germain» que le narrateur situe sa première rencontre avec Colette Laurent. L’imagerie télévisuelle est également sollicitée pour recomposer la vie de Francis Jansen. En regardant à la télévision «une série policière anglaise» tournée dans le Londres des années 60, le narrateur reconnaît Eugène Deckers, un ami acteur de la bande de Francis. Enfin, l’écrivain, protagoniste de ce roman, fait appel à l’imaginaire onirique dans sa quête du souvenir. Tout un pan du passé s’éclaire de nouveau grâce aux rêves, qui se forment à partir de vagues moments vécus. «Nous nous réunissions là-bas chaque dimance soir. Et, dans mon rêve, j’étais certain de retrouver ce soir-là parmi les convives Jacques Besse, Eugène Meyers, le docteur de Meyendorff et sa femme». Le rêve devient la réalité si désirée.
C’est le souvenir de ce Paris d’après la Libération qui permet de dessiner le contour de certaines rencontres cruciales dans cette recherche du temps perdu modianesque
Le narrateur, dans sa recherche des multiples images du passé, va jusqu’à se confondre avec l’objet de son travail. «Une pensée m’accompagnait, d’abord vague et de plus en plus précise: je m’appelais Francis Jansen». L’écrivain devient le double du photographe. Leurs fonctions respectives se confondent: l’écriture de ce livre repose sur des images et la valeur des photographies n’est effective que grâce à ce qui est écrit au dos.
D’une manière, l’identité de l’écrivain-narrateur disparaît au fil du roman. Le présent n’offre au narrateur aucun repère identitaire, aucun sens: «et moi presque joyeux d’avoir trouver un but à ma journée». Une présence au monde qui explique une quête du passé systématique, même face à un ticket de métro: «il évoquait une période si lointaine de ma vie». «Je regardais fixement le ticket rose, comme s’il était le dernier objet susceptible de témoigner et de me rassurer sur mon identité.» La perte progressive de l’identité de l’écrivain se traduit par son intégration au sein de la foule, comme Baudelaire dans Le spleen de Paris. Le narrateur, est comme un touriste avec son appareil photo, et se fond dans la masse. Les mots de la foule deviennent siens comme ceux des deux dames qu’il écoute, allongé dans les herbes du jardin du Luxembourg: «je percevais encore quelques mots, les voix des deux femmes devenaient de plus en plus douces», «j’allais disparaître dans ce jardin, parmi la foule du lundi de Pâques». La disparition racontée du photographe devient celle vécue de l’écrivain.
La littérature, bavardage inutile

L’extinction progressive de la voix du narrateur-écrivain est associée dans ce roman à une vision dépréciatrice de la littérature. Une dévalorisation perceptible à travers les appelations que donnait à l’époque le photographe Francis Jansen au narrateur. Un «scribe», un simple «archiviste». Le photographe dépeint la littérature comme un vulgaire bavardage inutile, à l’image de toute parole. C’est que Francis Jansen est un amoureux du silence, porteur de mystère. «De tous les caractères d’imprimerie, il m’avait dit qu’il préférait les points de suspensions.» Son oeuvre et sa vie elles-mêmes sont à passer sous silence: «il vaut mieux faire table rase». Et si le véritable enjeu de la parole littéraire était de réussir à provoquer le silence? A l’image de certaines phrases de Modiano, offrant des images claires et immédiates: «un vent atlantique agite les branches des arbres et fait se retourner l’étoffe des parapluies.» Elles ne semblent pas avoir d’utilité signifiante particulière dans l’économie romanesque. Elles renvoient au simple silence de la contemplation. Une pause, un sentiment paisible, dans le vacarme de l’existence.
Chiens de printemps, Patrick Modiano, Points, 1997
Alexandre Poussart