La littérature et la politique ont toujours entretenu des relations tumultueuses. Pour certains hommes d’État, elle constitue une forme de divertissement qui ne procure qu’un simple plaisir intellectuel tandis que la plupart des écrivains refusent de se compromettre dans la chose publique. Nicolas Idier n’en fait pas partie. Son roman, Matignon la nuit, s’appuie sur son expérience en tant que conseiller discours de Jean Castex, et il nous fait pénétrer dans l’intimité de l’Hôtel de Matignon tout en nous montrant la fragile puissance de la littérature.
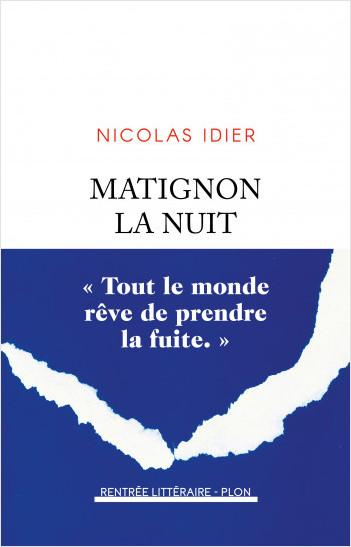
Vous avez écrit le roman Matignon à la nuit aux éditions Plon, et c’est un roman où l’écriture politique côtoie l’écriture poétique. Une des grandes forces du livre est de faire se heurter ces deux types d’écriture, c’est-à-dire une écriture programmatique, du discours, et une sorte de flux de conscience d’un personnage, qui se laisse envahir par la nuit. Est-ce l’enjeu du livre ? Comment concilier ces deux approches ?
Nicolas Idier : Ce sont deux approches qui ne se superposent pas. L’écriture politique, c’est-à-dire l’écriture des discours écrase tout le reste. L’écriture politique n’est pas littéraire, ce n’est pas sa visée première. On peut parfois avoir certaines méthodes proches de l’écriture littéraire, notamment pour créer une sorte de tension dans le discours. Mais, en revanche, l’objet n’est pas littéraire. L’objet doit percuter une audience, la tenir éveillée, et généralement, lui faire des annonces. Il vaut mieux être extrêmement bon grammairien, avoir un sens du rythme, mais éviter de fabuler.
En revanche, l’écriture littéraire vient assez rapidement après la politique – tant la politique est un milieu romanesque. Ceux qui habitent la politique sont des personnages de romans. Ce sont des personnages qui sont parfois illuminés par leurs idéaux ou rongés par leurs ambitions, parfois par leurs frustrations. Surtout, c’est un milieu où les gens se côtoient et se frottent les uns aux autres. Je pense qu’une des grandes forces du roman, c’est justement de mettre en contact des individualités débordantes et de les faire se rencontrer. En politique, ce qui est formidable, c’est que vous avez une sorte de précipité chimique de tout ce qui affecte les êtres humains. Certaines décisions prises dans une centaine de mètres carrés peuvent détruire la vie des gens ou au contraire l’améliorer.
L’écriture littéraire et l’écriture politique peuvent parfois entrer en contradiction. Lorsqu’on est dans l’exercice même du pouvoir, ou quand on aide ou conseille les gens qui exercent le pouvoir, l’écriture littéraire est impossible parce que le pouvoir écrase tout. Le pouvoir est d’une violence, d’une intensité incroyable. Ce qui fait qu’il est parfois difficile, y compris pour de très bons romanciers, de comprendre l’essence même du pouvoir s’ils ne l’ont jamais vécu. Ils le voient de l’extérieur dans des institutions où existent des jeux de pouvoir comme, l’université ou les maisons d’édition. Mais en politique, le pouvoir est surtout national et écrase tout. Donc là, il n’y a pas de confrontation, il n’y a pas d’affrontement.
En revanche, c’est vrai que lorsqu’on redevient romancier après avoir été un technicien de la politique, il y a un risque d’affrontement intérieur. Quand on écrit un roman – et ça a été tout le défi de Matignon la nuit – la première nécessité est de se détacher du politique et de quelque chose qui est essentiel en politique : le respect. Un romancier qui respecte trop est un romancier qui s’écrase. Un écrivain est un hors-la-loi. Il impose sa propre liberté, et c’est à cette condition seulement qu’il peut écrire sur la politique. C’est fournir un effort sur soi, sans tomber dans l’acrimonie et chercher la méchanceté à tout prix. La politique ni la littérature n’ont à se nourrir de méchanceté ou de cruauté. La bienveillance et même la tendresse peuvent être plus efficaces. A condition, toutefois, d’imposer sa singularité, et en somme, de refuser le trop-plein de civilité qui fait peut-être un bon serviteur de l’Etat, mais pas forcément un bon écrivain. En écrivant Matignon la Nuit, je me suis ensauvagé. Mais ce n’était pas la première fois. J’ai connu le même processus en écrivant sur l’Inde de Narendra Modi et d’Arundhati Roy avec Dans la Tanière du Tigre ou bien sûr sur la Chine avec Nouvelle jeunesse.
Il y a une sorte de paradoxe avec un texte qui est à la fois pris dans un carcan très strict, dans un espace temporel délimité, la nuit, l’heure est indiquée sévèrement en tête de chapitre, et traduit un sentiment d’urgence, et en même temps, on a un narrateur qui s’évade en permanence. Est-ce que c’est parce que c’est un espace où on est affranchi, quelque part, de l’ordre du jour, et que tout peut arriver, entre le rêve et la réalité ? Pourquoi la nuit ? Est-ce qu’elle s’oppose plus directement à l’ordre du jour, à l’ordre politique ferme ?
Il y a plusieurs éléments. Tout d’abord, lorsqu’on entre dans l’hôtel de Matignon, on entre dans un lieu qui est hors du temps, et puissamment dans le temps. Le Grand Portail, au 57 rue de Varennes, se situe dans la proximité quasiment immédiate de la Porte des Enfers de Rodin au 77 de la même rue. Une autre temporalité se déploie. A commencer par le jour et la nuit qui commencent à se mélanger, dont la frontière disparaît et avec elle, celle du réel et de l’imaginaire. Pour survivre à Matignon, je conseille de devenir un voyageur du temps. La nuit incarne cet espace hors du temps. Ce sont des moments du rêve, des cauchemars, de l’insomnie, de l’interlope. A Matignon, la nuit est très vivante.
Ensuite, l’écriture des discours a généralement lieu le soir, et parfois même à des heures très tardives, tout simplement parce que la journée, c’est le moment de l’exécution de l’action politique. Lorsqu’il y a des commandes, les conseillers travaillent : ils appellent les recteurs, les préfets, les hôpitaux, les magistrats, pour construire leur matière. Les discours se construisent à partir du réel. La journée, les conseillers discours sont comme des pêcheurs qui lancent leur filets et qui travaillent à ramasser de l’information. Ensuite, vient le temps des arbitrages, des décisions une fois que la pêche a été ramenée au port. Ce sont des choses qui sont faites entre les ministres du gouvernement, le premier ministre, le président de la République et les conseillers de l’Elysée. Et enfin, arrive le moment terrible pour le conseiller de discours où on lui donne tous les poissons et on lui commande : « Vas-y, tu nous prépares une bonne petite bouillabaisse qu’on aimerait servir demain matin ». Et tout ça, ça se passe le soir. Cela tombe bien parce que pour écrire un discours, même si ce n’est pas un roman, il vaut mieux être un peu concentré. La concentration est plus forte lorsque les téléphones sonnent moins que pendant la journée.
j’avais envie d’écrire un livre non seulement sur l’enfermement de la politique, mais aussi sur la possibilité d’en sortir, la possibilité de la fuite
Enfin, j’avais envie d’écrire un livre non seulement sur l’enfermement de la politique, mais aussi sur la possibilité d’en sortir, la possibilité de la fuite. Et je pense que la fuite en politique, est permanente. Je pense que même les plus hauts dirigeants, ont de temps à autre une pensée où ils se disent : « Mais mon Dieu, qu’est-ce que je fais là ? Pourquoi je ne suis pas auprès de mes proches pour ceux qui en ont ou auprès d’un lieu qu’ils aiment et dont ils s’éloignent parce qu’ils sont encore une fois enfermés. » Parfois, comme un boxeur, ils ont envie de rentrer un petit peu dans les loges et de se reposer. Ce désir de fuite intervient plutôt la nuit , quand les regards sont moins insistants, quand la lumière des caméras commence à baisser. C’est dans ces moments-là que certains vont marcher dans Paris tandis que d’autres se réfugient à la campagne, ou tombent fou amoureux, ou appellent leur astrologue, et tout ça se passe plutôt la nuit. La nuit est la seule liberté qu’il leur reste.
On pourrait dire que le récit est aussi pris dans un impératif très concret avec la crise migratoire et on sent qu’une pression constante s’exerce sur le narrateur. Pourtant, il baigne aussi dans un monde très fantasque, fait de marabouts, d’étranges digressions. Pourquoi toutes ces digressions-là ? C’est peut-être une sorte de fuite psychique du narrateur, mais comment est-ce que vous avez choisi de penser la porosité entre ces deux espaces, à savoir d’un côté le concret, la crise migratoire, les éoliennes, etc., et de l’autre, les rêveries et la littérature ? Comment avez-vous pensé cette articulation au sein de l’espace romanesque ?
Elément véridique de mon roman, un grand portrait de Robbe-Grillet peint par Jean-Pierre Chambas trône dans le bureau dédié aux conseillers de discours. Ce personnage porte un livre comme une lame de rasoir de manière très agressive. Le visage aux traits tirés et au regard sombre de Robbe-Grillet pèse en permanence sur moi. Ce qui est étonnant aussi, c’est qu’il fait face dans cette même pièce au portrait du président de la République. Le président de la République lui-même a sur son bureau un livre de Stendhal, un autre d’André Gide. La littérature est tout de suite extrêmement présente dans ce lieu. J’y vois presque un duel, un match de boxe et malgré moi, je suis au milieu du ring.
La littérature est un élément nécessaire pour mon narrateur qui lui permet précisément de s’approcher d’une réalité extrêmement lointaine pour lui, celle des migrants. Les migrants, qui sont des voyageurs forcés au voyage, forcés à la fuite, qui se retrouvent parfois en mer, en situation de très grande difficulté, parfois sur nos rivages, et qui sont des personnalités qui vivent à notre époque, mais dans des réalités presque parallèles. L’un des personnages les plus essentiels du livre, c’est un livreur Deliveroo qui sillonne Paris avec son vélo. J’ai toujours été étonné, même si heureusement on a légiféré dessus, qu’on accepte très volontiers qu’il y ait toute une population qui même la nuit et même quand il pleut des trompes d’eau, avec des espèces d’anorak, pédalent à en perdre haleine, pour nous amener à manger. Et je me demande quelle est la vie de ce livreur Deliveroo qui pédale comme un fou pour donner à manger à des gens plus riches ? Donc j’invente un personnage très diplômé, qui a perdu ses diplômes dans le voyage mais qui a continué à avoir envie d’apprendre, et qui dans son sac, n’a pas de hamburger froid prêt à livrer, mais des livres pour apprendre le chinois, les sciences politiques, je trouve ça assez nécessaire que de s’interroger sur ces personnages, qui sont des invisibles de notre société. Pour s’approcher des invisibles, il fallait s’approcher de l’invisible.
Il y a aussi cette part d’irrationnel dans la nuit et dans l’espace politique.
Je vais vous dire, la politique, il y a tellement de pression qu’un certain nombre de décisions se prennent sans aucune explication autre que l’irrationnel. Il y a des décisions, parfois très importantes, qui ne peuvent s’expliquer que par l’intuition ou la vision prémonitoire. François Mitterrand, consultait une astrologue, Elisabeth Tessier, tandis que Jacques Chirac se réfugiait dans les magies primitives et d’autres encore avaient sûrement d’autres méthodes. Et je trouve qu’à notre époque en particulier, il y a une dimension irrationnelle, voire magique, qui est tout simplement celle de l’écran de télévision, comme une sorte de réalité parallèle qui défile dans un flux d’images continu. Les plateaux de BFM et de CNews, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment au courant, mais qui commentent tout, qui vous annoncent l’avenir en permanence, qui vous disent ce qui va se passer. Quand j’allume la télévision dans mon bureau à Matignon, j’ai un peu l’impression d’allumer la boule de cristal.
La vérité, c’est qu’il y a beaucoup de choses qui dépassent le politique, qui dépassent les pays, et qui touchent vraiment l’irrationnel. En 2021, ce virus par exemple qui arrête les avions, les voitures, nous oblige à rester chez nous, qui ferme les frontières, qui nous met dans un état où on se dit je vais peut-être mourir seul à l’hôpital. Il y en a beaucoup à qui c’est arrivé, ou beaucoup qui ont perdu des proches comme ça. Mais ce sont vraiment les grandes peurs millénaristes qui reviennent. Et autant on n’a pas eu le bug de l’an 2000, mais on a eu cet événement saisissant, l’année d’après en 2001, sur toutes les télévisions, la destruction en direct des tours jumelles et l’effondrement possible de l’Occident. Vingt ans plus tard, vous avez le Covid autant dire, le retour de Grande Peste. Tous les vingt ans, un événement mondial dépasse l’entendement dans ce que Guy Debord a très bien qualifié de société du spectacle, et qui va sidérer le spectacle. De la même manière que les tours jumelles se sont effondrées des dizaines de millions de fois sur tous les écrans de la planète, de la même manière que le Covid a paralysé la vie de dizaines de millions de personnes, à chaque fois on est face à des événements qui, par leur charge symbolique dépassent tout et surmultiplient les images.
La vérité, c’est qu’il y a beaucoup de choses qui dépassent le politique, qui dépassent les pays, et qui touchent vraiment l’irrationnel.
Je ne voulais pas faire un roman millénariste, réinventer une crise hallucinante ou faire de la science-fiction en détruisant la tour Eiffel ou imaginer un attentat. En revanche, j’avais envie de prendre un petit exemple de ce que peut-être une crise, telle qu’elle arrive au quotidien avec ces personnes en situation de migration, qui parfois ont de très belles vies avant le drame de la guerre ou l’obligation de la fuite et qui cherchent à reconstruire leur vie mais qui n’y arrivent pas, qui sont donc un peu suspendus dans l’interzone et qui se retrouvent parfois dans des situations extrêmes. Ils sont bien quarante sur un canot de sauvetage, pourquoi ils ne monteraient pas à quarante en haut d’une éolienne ? Ils sont très haut et s’ils tombent, ils les caméras vont filmer leur mort. On sera obligé de voir et non plus de les cantonner à de simples chiffres rapportés chaque matin sur France Info. Donc là, ça devient tout de suite très politique.
Parmi les influences qui peuplent le livre, il y en a une qui m’a marqué parce que c’est peut-être la plus étrangère à Matignon, celle de l’Orient. Elle occupe une place importante dans votre roman. Le narrateur s’abreuve de saké, il cite fréquemment des proverbes asiatiques ou des auteurs chinois. Pourquoi cette importance accordée à l’Asie ?
Matignon la nuit est un livre extrêmement différent de ceux que j’ai écrits avant mais je voulais tout de même, pour me reconnaître dans mon livre, rester ce que je suis, c’est-à-dire en ligne directe avec l’Extrême-Orient, par sa littérature, sa pensée, sa peinture. Le secret est de se réinventer en restant soi-même, se réinventer par certains thèmes, mais tenir la fibre qui nous constitue en profondeur. Quand j’arrive à Matignon, parce que je suis ce que je suis, j’entre dans la Cité interdite. Ce sont des lieux très secrets, parfois repliés sur eux-mêmes mais surtout, des lieux construits par des siècles d’Histoire.
J’arrive aussi dans un lieu à un moment où la France a vécu un certain nombre de crises. Nous sommes à un moment de bascule. Or, je suis hanté par le livre de Segalen, René Leys qui coïncide avec les derniers jours de l’Empire chinois et la rupture sidérante avec plus de 2000 ans d’histoire impériale. Matignon la nuit tente d’exorciser le très grand danger dans lequel le monde entier et la France sont entrés. Et c’est vrai que cette Cité interdite, dans un moment où la pression commence à faire vaciller le système, me semble une très bonne métaphore de ce que nous vivons aujourd’hui. L’Orient, pour moi, s’est imposé par ce que je suis, mais aussi par la situation elle-même : une situation révolutionnaire, à tout point de vue.
Matignon la nuit tente d’exorciser le très grand danger dans lequel le monde entier et la France sont entrés
Matignon la nuit est un texte palimpseste, parcouru d’autres discours. Le narrateur va convoquer un certain nombre de figures littéraires : Robbe-Grillet, Hemingway dans les cuisines de Matignon et puis Philippe Sollers, avec lequel un coup de fil est échangé. Pourquoi convoquer ces fantômes illustres ? Est-ce qu’il y a un désir de filiation ? D’hommage ? De mise à distance ?
Il n’y a pas de filiation. Il n’y a pas de mise à distance. C’est extrêmement central, là aussi. La littérature est l’avenir de la politique.La politique est très réduite, elle est heurtée par le présent, elle a du mal à s’articuler. La littérature domine la politique, et la politique a besoin de la littérature pour exister. C’est toute l’histoire de la littérature que de faire vivre la politique, et de transformer la politique dans ce qu’elle a de pire ou de meilleur, en littérature. Autant Alain Robbe-Grillet se détachait beaucoup du monde, mais il y en a un qui a toujours été présent, au prix d’un certain nombre d’erreurs, mais aussi d’un certain nombre de fulgurances, voire d’illuminations. C’est bien Philippe Sollers qui, jusqu’à ses derniers jours, était passionné par le destin de la France. En 1999, il publie à la Une du Monde La France moisie, une dénonciation salutaire sur les relents du pétainisme permanent, et sur cette dimension collaborationniste d’un certain nombre de nos dirigeants. « Elle était là, elle est toujours là ; on la sent, peu à peu, remonter en surface : la France moisie est de retour. » Une autre figure tout à fait essentielle pour nous permettre d’entrevoir cette relation passionnelle entre littérature et politique, c’est Bernard Frank. Bernard Frank, un véritable taoïste d’apparence, qui restait beaucoup chez lui, affalé dans des grands fauteuils, chez Françoise Sagan de temps en temps, en Normandie, au Manoir du Breuil, qui buvait et mangeait à l’excès, mais qui écrivait sans cesse. Et dans ses chroniques, qu’est-ce que fait Bernard Franck ? Il y a toujours de la littérature, c’était un immense amoureux de Madame Bovary, mais aussi de la politique, qu’il suivait de son œil de gros chat à moitié endormi. Au fond, la littérature, c’est la politique en mieux. Qu’on aime, qu’on n’aime pas, la littérature fait avancer la société beaucoup plus vite que la politique.
Qu’on aime, qu’on n’aime pas, la littérature fait avancer la société beaucoup plus vite que la politique.
Pourtant, il y a un grand absent, c’est Malraux. Malraux, finalement, qui est la figure à laquelle on pense quasiment immédiatement quand on pense à convoquer littérature et politique puisqu’il a fait de la politique. Malraux a été un très grand ministre. Je n’appelle pas les écrivains à devenir des politiciens ou des ministres. J’appelle la société française à considérer la littérature comme un acte très politique, ce qui est différent. J’aurais pu, évidemment, mettre André Malraux en position de force dans le roman, d’autant plus qu’il adorait la Chine et l’Orient. Marguerite Duras était, on le sait, très proche de François Mitterrand, mais n’a jamais été reçue à l’Élysée, elle s’intéressait beaucoup à la politique et en a fait. On pourrait aussi citer Annie Ernaux. Annie Ernaux qui signe un certain nombre de tribunes, qui parfois, lorsqu’on l’invite à monter sur une estrade, le fait, mais ce n’est pas là qu’elle est politique. Elle est politique lorsqu’elle écrit justement ses romans qui ne sont pas, me semble-t-il, des romans à thèse ou de la littérature engagée. C’est toute la force des écrivains.
Ce qui est passionnant chez Malraux, c’est qu’il va chercher ses sujets. J’aime et admire cette démarche. Quand il va en Espagne, il va s’employer à faire la guerre contre le fascisme, mais il vient aussi chercher un sujet. Il est à la pêche aussi. Lorsqu’il va en Chine, il a cette conscience d’attraper les sujets. La politique, c’est la même aventure. Il a contribué de manière très forte à la mythologie de la Résistance, ce qui est fondamental, puisque tout est légende. Sans littérature, pas de politique. Sans les écrivains, pas de résistance. Il faut des mots pour écrire l’Histoire.
Votre texte interroge le rapport entre l’écriture et l’action, entre les mots et les choses. Et l’urgence humaine qui se heurte à la politique institutionnelle. Après avoir côtoyé le pouvoir, ou du moins après avoir occupé ce poste-là, est-ce que vous croyez toujours en la portée ou la puissance du discours politique ?
Oui, d’abord, parce que la République est née par le discours. Avant la République, on régnait par le symbole. On régnait par la foi, avec une monarchie de droit divin qui se passait de mots. Le discours révolutionnaire a tout changé : voisin de la tribune, il y avait l’échafaud. Le discours est constitutif de notre histoire républicaine. Sans le discours, pas de République. La police, l’armée, ce sont des choses importantes. Mais le discours est beaucoup plus important encore que la démonstration de la force ou le maintien de la paix. Le discours est absolument consubstantiel à l’histoire républicaine. Aujourd’hui, le discours s’est creusé, vidé. La perte de confiance du peuple envers la politique vient aussi que nombre de discours ne sont suivis d’aucun effet. Le discours a laissé la place au bavardage, à la cacophonie et à ce que Camille Pascal a appelé un jour, « le discours de la volière ». Je garde cependant confiance dans la capacité du discours à influer sur le réel. À une seule condition. Que le discours ne soit pas, et c’est la même chose à l’université, que le discours ne soit pas précédé par une idéologie imperméable au réel, à la vie des gens.
Le bon discours, de la même manière que le bon travail universitaire, doit d’abord être précédé d’une réflexion théorique conjuguée à une attention aux autres dans leur pluralité, d’une recherche sur ce qu’on appelle le terrain avant de vouloir conclure. Le discours doit être précédé par le réel. Sinon, nous sommes dans le totalitarisme. Un pays n’est pas une page blanche. Être précédé par le réel, déjà, ça permettrait au discours de raisonner. Lorsqu’un élu prend la parole, il ne prend pas la parole en tant qu’individu, il prend la parole en tant qu’élu, élu par de vrais gens donc, du réel.
Mais le plus beau des discours, c’est le silence.
Quel est le plus beau discours politique, selon vous ? Le plus efficace ou celui qui vous a le plus marqué ?
Il y a eu des personnalités politiques qui, par leur stature, leurs discours, ont été extrêmement puissants. Certaines étaient de grands écrivains, je pense évidemment à de Gaulle, entré dans la Pléiade. Quel que soit le bord politique ou la marque laissée dans l’histoire, beaucoup ont laissé derrière elles de beaux discours. Tous les présidents de la Cinquième République ont, à un moment ou à un autre, contribué à cette tradition très française ou à tout le moins européenne, à l’opposé du show-business à l’américaine ou des tartufferies castristes dont l’on retrouve aujourd’hui certains accents jusque dans les rangs du palais Bourbon. Mais le plus beau des discours, c’est le silence. Quand l’homme ou la femme d’Etat apprend à maîtriser le silence, c’est une force considérable, à l’opposé du noise et de l’apocalypse cognitive décrite par Gérald Bronner. Le silence, lui, ne s’écrit pas.
- Nicolas Idier, Matignon la nuit, Plon, 2024.
- Crédit photo : Nicolas Idier – Photo © Patrice Normand

















