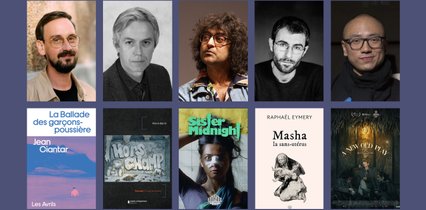Avec Chemins de fer du Mexique, Gian Marco Griffi livre un roman-monde où résonne, au cœur de l’Italie fasciste, un chant d’amour à la littérature et à une myriade d’auteurs qui vont des grands noms de la littérature hispano-américaine comme Jorge Luis Borges, Juan Rulfo ou encore Roberto Bolaño, à la tradition italienne d’un Boccace, en passant par Anna Maria Ortese ou même Carlo Emilio Gadda. Chez son éditeur en France, Gallimard, où il est publié dans la collection « Du monde entier », Gian Marco Griffi a revêtu un tee-shirt à l’effigie de Frida Kahlo et revient sur la véritable success-story de son roman, Chemins de fer du Mexique, publié par Laurana Editore et vendu aujourd’hui à plus de 50 000 exemplaires. Traduit par Christophe Mileschi, son roman est sorti en France le 14 mars 2024, pour le grand bonheur des lecteurs assoiffés de quêtes loufoques, de personnages marginaux et d’une langue drolatique et toute musicale.
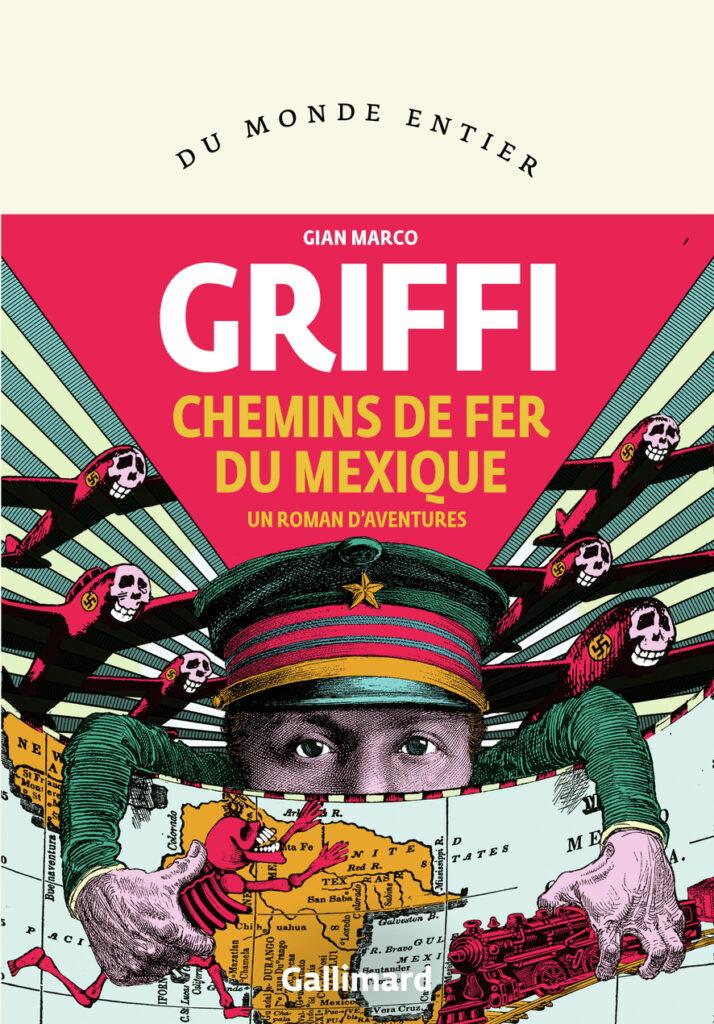
Zone Critique : Votre livre, Chemins de fer au Mexique, a été une véritable surprise éditoriale : publié par Laurana Editore, une petite maison d’édition indépendante, avec une distribution initiale de seulement 168 exemplaires, Chemins de fer au Mexique est devenu un bestseller avec plus de 50 000 exemplaires vendus en Italie et a même été sélectionné pour le Prix Strega. L’aventure n’est donc pas seulement l’un des thèmes du roman, elle est aussi un terme qui pourrait résumer le parcours tout picaresque de votre livre. Comment avez-vous vécu cette histoire pleine de rebondissements ?
Gian Marco Griffi : Ça a été une vraie aventure : les librairies italiennes ont demandé initialement 168 exemplaires. En plus, Laurana est une toute petite maison d’édition, et la collection « Fremen » dans laquelle j’ai été publié, était nouvelle, avec seulement 3 ou 4 livres déjà publiés. Mais ce qui est formidable, c’est de voir la croissance, à partir d’un bouche-à-oreille initial qui a commencé sur les réseaux sociaux, d’abord sur Facebook puis sur Instagram. Les gens ont commencé à réserver le livre, à le demander en librairie. Les libraires ont commencé à le lire de plus en plus. Ils ont été si nombreux à tomber amoureux du roman qu’ils ont commencé à le proposer à de nouveaux clients. Le bouche-à-oreille, ainsi généré, a véritablement été la clé qui a permis de vendre, à ce jour, 50 000 exemplaires du livre. Ensuite, bien sûr, il y a eu le coup de boost qu’ont donné les différents prix que le roman a remportés : il a été élu livre de l’année par Fahrenheit, l’émission littéraire la plus importante en Italie. Et puis, l’entrée dans la sélection pour le Strega a fait toute la différence. En Italie, les livres qui parviennent à atteindre les 10 000 exemplaires sont vendus dans les supermarchés, sur les aires d’autoroute ou dans les gares. En un mot, les livres que l’on trouve partout et qui sont publiés en règle générale par de grandes maisons d’édition comme Einaudi ou Mondadori.
Chemins de fer au Mexique est publié en France chez Gallimard, dans la collection « Du monde entier » qui a fait date et qui a publié entre autres Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, James Joyce, Franz Kafka, des écrivains qui semblent entrer en résonance avec votre conception de la littérature. Quels liens entretenez-vous avec ces écrivains en particulier ?
Il faut toujours maintenir ses distances avec ces grands écrivains. Il faut bien apprendre de quelqu’un, alors pourquoi apprendre des mauvais ? Il faut apprendre des meilleurs, non ? Quand j’avais 15 ans et que je jouais au football, je regardais les plus grands champions et j’essayais d’apprendre d’eux. C’est la même chose pour les écrivains. Je les étudiais. Je les ai étudiés entre guillemets. « Étudier » est une façon de dire « lire ». Je me suis donc davantage concentré sur eux, sur les plus grands, sur mes amours littéraires : Gadda, Manganelli, Fenoglio, Buzzati. J’ai appris de tous ces écrivains géniaux qui, pour mille raisons, m’ont appris la langue italienne. Et puis, parmi les différents courants qui se sont juxtaposés aux Chemins de fer du Mexique, le seul que je sente vraiment mien est, en effet, celui du réalisme magique qui n’était pas l’apanage des Hispano-Américains. Il a existé aussi en Italie avec des auteurs comme Buzzati ou Anna Maria Ortese. Ensuite, il y a tous ceux que vous avez mentionnés : Cortázar, Borges, Joyce. Ce sont tous des auteurs qui font partie eux aussi de mes amours littéraires. J’ai dû lire au moins dix fois Ulysse de Joyce. C’est un de ces livres que je relis constamment. Il en va de même pour les nouvelles de Borges ou pour les œuvres de Juan Rulfo, l’auteur de Pedro Paramo que l’on considère comme le texte fondateur du réalisme magique. On en arrive ensuite à des auteurs comme Roberto Bolaño ou David Foster Wallace. Tous ces écrivains m’ont formé d’abord comme lecteur, ensuite comme écrivain.
Il est vrai qu’avec Chemins de fer du Mexique, je voulais écrire une histoire kafkaïenne : j’avais envie d’inventer un récit où un personnage se voit confronté à une situation incompréhensible et assez bizarre. Pas une histoire insensée ni absurde, parce que réaliser une carte du réseau de chemins de fer mexicain n’est pas un non-sens improbable. Je cherchais une voie intermédiaire qui se trouve entre les aventures néoréalistes d’un soldat devant affronter la vie quotidienne en période de guerre et l’histoire d’un homme qui se réveille un matin métamorphosé en cafard, ce qui est une option trop exagérée et trop allégorique par rapport à ce que je cherchais à faire avec mon roman. J’ai eu en tête 1000 idées différentes mais aucune ne convenait totalement. Puis, en lisant que Proust avait investi dans les chemins de fer du Mexique, j’ai compris que c’était exactement ce genre de situation que je recherchais. C’est une situation assez impensable et suffisamment marginale et farfelue, mais elle est avant tout incompréhensible. Cet ordre que reçoit le personnage de Cesco Magetti, celui de réaliser une carte des chemins de fer du Mexique, est exactement ce qu’il me fallait : c’est une bonne façon de mettre au cœur d’une période historique fondamentalement dramatique une situation marquée par sa marginalité extrême.
En plus d’être un roman d’aventures (avec un -s final), comme l’indique le sous-titre, Chemins de fer du Mexique, est un roman qui dialogue ouvertement avec la tradition moderniste en raison de l’importance accordée à la langue et au langage.
Vous savez, je suis un grand amoureux de Céline. Je me souviens que lorsqu’on a demandé à Gadda de trouver un écrivain avec lequel il avait des affinités, il a répondu Céline. Et c’était surtout à cause de la langue. Aujourd’hui, je peux apprécier Céline même en italien, mais il est évident que Céline doit être lu en français. Si j’ai déjà du mal avec le français, je vous laisse imaginer ce qu’il en est avec l’argot français. On comprend bien que l’argot soit particulièrement difficile à traduire.
La richesse des langues et des idiomes de Chemins de fer du Mexique est un défi pour tout traducteur. Quelle a été votre relation avec Christophe Mileschi, le traducteur du roman en français ? Son travail de traduction a-t-il été l’occasion d’un dialogue ?
Christophe Mileschi m’a dit que la seule partie qu’il n’a eu aucun mal à traduire a été la partie qui se passe dans la taverne de l’Aigle agonisant où j’utilise un idiome appelé lingua zerga, une langue utilisée par les détrousseurs et les petits bandits au XVIe siècle notamment en Vénétie et que Christophe a traduit en utilisant l’argot français. L’inverse aurait été beaucoup plus difficile car l’argot n’existe tout simplement pas en italien. Je trouve que c’est là un aspect très intéressant de la langue et de la traduction. A l’inverse, la traduction des mots croisés lui a donné beaucoup plus de fil à retordre. Il a fallu reconstruire cette grille de mots croisés en français en gardant des enjeux très précis. Je pense que traduire, surtout dans le cas de Chemins de fer du Mexique, c’est aussi un peu réécrire. Il est donc évident que les Français liront Chemins de fer du Mexique écrit par Gian Marco Griffi, mais ils liront aussi Chemins de Fer du Mexique traduit par Christophe Mileschi. Et c’est normal dans un roman composite de ce genre. Christophe a dû faire des choix qui lui sont propres. Il a décidé, par exemple, de traduire le piémontais dans un autre dialecte français. Si ces choix de traduction sont clairs et assumés, l’effet qu’ils auront sur le lecteur français reste à mon échelle relativement imprévisible. On imagine l’effet majeur, notamment en raison de la différence de traitement en France en ce qui concerne les dialectes. On a beaucoup échangé avec Christophe sur ces particularités françaises et italiennes. Une chose est sûre, l’effet du dialecte est intéressant parce que le lecteur français ressent immédiatement son effet dépaysant, la rupture qu’il implique. Par ailleurs, il était essentiel de créer un environnement linguistique piémontais car les personnages évoluent dans une petite ville piémontaise, Asti, dans laquelle, en 1944, personne ne parlait l’italien, mais le piémontais, la langue de la région d’Asti et de ses alentours. J’avais aussi à cœur de montrer comment ces dialectes sont une véritable richesse de l’italien et je suis heureux que Christophe ait fait ce choix. Je pense que c’est le bon.
Sur votre profil Facebook, vous vous définissez comme un «écrivain du lundi », mais il paraît évident que la littérature n’est pas juste un passe-temps récréatif pour vous. Chemins de fer du Mexique est un roman ambitieux, une tentative de créer une œuvre-monde dans laquelle la foi et la confiance dans la littérature sont renouvelées, voire proclamées à cor et à cri. Pour reprendre le titre d’un essai célèbre de Sartre, qu’est-ce que la littérature pour vous ? À quels besoins de la société peut-elle répondre aujourd’hui ?
Pour moi, la littérature est un grand plaisir, un grand jeu. Et comme tous les jeux, elle se joue bien sûr avec beaucoup de sérieux. La littérature est un jeu qui englobe toute la gamme des émotions humaines et les étudie. Elle me semble être un moyen privilégié de connaître l’être humain et le monde qui l’entoure. Je pense que l’on a trop souvent tendance à prendre la littérature comme quelque chose de vraiment trop sérieux, au sens négatif du terme. N’oublions pas que nous avons eu des exemples où le jeu joue le rôle principal, je pense à l’OuLiPo et à des écrivains comme Queneau ou Umberto Eco. Quand je parle de jeu, je n’entends évidemment pas une littérature de divertissement, loin de là, mais une littérature qui réussit plutôt à sonder les profondeurs de l’être humain.
Pouvez-vous nous parler de l’organisation de votre atelier d’écrivain ? Quels sont ses rituels et vos habitudes, les règles que vous vous imposez et les erreurs que vous vous engagez à ne pas commettre ?
C’est aussi pour cela que je me qualifie d’« écrivain du lundi », parce que je suis essentiellement un écrivain du dimanche. En Italie, on parle d’écrivain du dimanche quand on fait quelque chose comme un hobby. Mais je travaille le dimanche, puisque je travaille dans un club de golf, et je suis donc à la maison le lundi, comme les coiffeurs ! Évidemment, pour écrire Chemins de fer du Mexique, j’ai eu à écrire aussi les six autres jours de la semaine, mais c’est là que le confinement est venu à mon secours. Sans cela, j’aurais manqué de temps matériel pour donner sa forme définitive au roman. Au-delà de ce temps très concret de l’écriture, il y a aussi le temps de l’imagination. J’ai vraiment besoin d’avoir du temps pour imaginer. Et ce temps de l’imagination est une période où je me dédie à toute autre chose, où je ne pense pas physiquement à la page, à l’écriture, mais où je pense en fait à l’histoire. Je suis capable d’y penser peut-être cinq heures par jour, mais toujours en faisant autre chose. Pour cette phase-là, j’ai tendance à ne pas prendre de notes, j’ai tendance à laisser les idées s’accumuler, se déposer, s’installer. Si au bout de 15-20 jours, certaines idées ont persisté, c’est qu’elles valaient la peine d’être écrites. Je suis écrivain par passion. Alors si je n’ai rien à dire, pourquoi le dire ? Pour Chemins de fer du Mexique, la grande chance que j’ai eue, c’est que j’ai commencé à l’imaginer avant, puis pendant le confinement. J’ai passé plusieurs mois au bureau pour l’écrire. J’écrivais environ 10 heures par jour. Pour beaucoup, le confinement a été dramatique, mais pour moi, c’était magnifique, j’en ai fait bon usage. Je peux donc dire que cette période a été très belle et très créative.
Comment est né Chemins de fer du Mexique ? Quelle a été la genèse du roman ?
J’avais envoyé mon premier livre, un recueil de nouvelles, intitulé Più segreti degli angeli i suicidi (Plus de secrets que les anges, les suicidés) à peu près partout, mais il est passé complètement inaperçu. Le seul à m’avoir répondu et à avoir manifesté de l’enthousiasme pour le recueil a été Giulio Mozzi. En 2019, il m’a téléphoné pour me dire qu’il éditait une nouvelle collection, « Fremen », et qu’il aimerait publier un livre de moi. Je lui ai envoyé une première version de Chemins de fer du Mexique, pratiquement terminée, en mai 2021. Quand il a reçu mon manuscrit, nous avons commencé l’édition du texte avec Lucia Zago et lui. Avec Giulio, ils m’ont lu tout le roman à haute voix. Cette mise en voix du texte m’a donné à entendre toute la musicalité et le rythme de mon écriture, qui sont des éléments que je considère comme décisifs dans la prose. J’ai toujours été sensible à cela. D’ailleurs, les premiers textes que j’ai commis en littérature étaient des poèmes. Mais rapidement je me suis rendu compte que je n’étais tout simplement pas capable d’écrire de la poésie et j’ai abandonné ce chemin bien trop escarpé pour moi. J’ai essayé en revanche de mettre à profit les enseignements que j’avais tirés de l’écriture poétique : l’importance de la musique, l’attention toute particulière porté au rythme, la sonorité des mots choisis et les figures de style. Giulio et Lucia sont eux aussi sensibles à ces aspects et pendant le travail d’édition du texte, ils m’ont interrogé sur le choix de tel adjectif, de tel verbe, de tel adverbe ou de tel mot. Ils voulaient savoir pourquoi j’avais choisi un mot plutôt qu’un autre. Je pense que la différence entre quelqu’un qui écrit en faisant des choix en pleine conscience et quelqu’un qui n’adopte pas cette démarche se mesure justement dans cette capacité ensuite à expliquer les choix et à les motiver. Le travail d’édition a donc été un travail essentiellement axé sur le langage, et pas tant sur la trame qui était pourtant le point que je redoutais le plus et pour lequel je pensais avoir besoin le plus d’aide car je n’avais encore jamais écrit de roman.
Le roman raconte une semaine de la vie de Cesco Magetti, un soldat de la Garde Nationale républicaine ferroviaire en poste à Asti, une ville du Piémont. Pourtant, la trajectoire du personnage croise les histoires d’une myriade de personnages et inscrit dans l’œuvre une forme de tension continue entre le roman et la nouvelle. C’est un enseignement que vous semblez hériter directement de la tradition italienne de la nouvelle et de Boccace lui-même dont le Décaméron, ce vaste recueil de nouvelles, peut être considéré à bien des égards comme le premier roman moderne italien, mais aussi de Roberto Bolaño, un auteur essentiel dans le renouvellement de la forme romanesque au XXIe siècle. D’un autre côté, votre précédent livre, Inciampi, est un véritable recueil de nouvelles et vous avez publié de nombreuses nouvelles sur des sites et revues littéraires en Italie. Cette relation dialectique entre roman et nouvelle semble au cœur de votre poétique.
Avant Chemins de fer du Mexique, je n’avais écrit que des nouvelles. En fait, pour tout vous dire, lorsque j’ai eu l’idée de faire quelque chose de plus vaste, donc une sorte de roman, j’ai commencé à écrire des parties que j’ai finalement adaptées en nouvelles. Quelques chapitres prévus pour Chemins de fer du Mexique se trouvent dans le livre précédent, Inciampi, sous cette forme. Comme j’avais d’abord imaginé que ces récits feraient partie du roman, j’ai dû les réajuster pour les publier dans le recueil de nouvelles. La nouvelle permet d’encadrer un personnage, même 1000 personnages, mais à un moment précis. Du coup, Chemins de fer du Mexique est un emboîtement d’histoires. Je suis convaincu qu’il ne s’agit pas vraiment de digressions, car ces histoires sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Les parties du roman que j’ai finalement supprimées étaient pour leur part de véritables digressions. Par exemple, je voulais profiter du personnage de Lito Zanon pour faire quelque chose de très jazzy et me laisser porter par son histoire en suivant le rythme de son récit et ses mille variations, puisqu’il joue du cornet et aime le jazz. Finalement, j’ai décidé de couper cette partie car je me suis rendu compte que même s’il est bon de perdre le lecteur, on doit toujours le faire en lui laissant des indices. On peut offrir au lecteur mille histoires différentes qui s’entrecroisent et le détournent de l’histoire principale, mais si on l’emmène loin, peut-être à 10 000 km des chemins de fer du Mexique, il faut toujours veiller à lui laisser des indications qui lui permettront de revenir sur la route principale, parce que c’est là qu’il veut aller. Je peux dire au lecteur : nous allons à Marseille mais nous passerons par Paris. Mais, au cours des déviations, il faut quand même qu’il y ait un panneau qui lui indique à combien de kilomètres se trouve Marseille, la vraie destination du voyage. Cela permet au lecteur de comprendre que nous arriverons bel et bien à destination et que les déviations ne sont que temporaires, comme des haltes sur un parcours bien défini.
Le roman évoque le Mexique, mais aussi l’Amérique latine en général. L’Argentine est le premier pays hispano-américain mentionné dans le roman : Lito Zanon raconte à Cesco Magetti et à Tilde Giordano, son amoureuse, ses voyages autour du monde. Pourquoi avoir choisi cette zone géographique en particulier ?
Je ne suis jamais allé au Mexique. Mon opération était une opération à la Emilio Salgari (ndlr : un auteur de romans d’aventure exotiques qui n’a pourtant jamais mis un pied dans les pays où se déroulent ses livres). Et le choix du Mexique a été totalement aléatoire. J’aurais tout aussi bien pu faire tourner un globe et choisir un endroit au hasard. Au lieu de cela, les choses ont suivi un autre cours : alors que je lisais une biographie de Proust, quelque chose qui n’avait donc apparemment pas grand-chose à voir avec le Mexique, j’ai découvert que Proust était un passionné de bourse et qu’il avait l’habitude d’investir dans des actions particulièrement exotiques. Parmi ces actions, il y avait les chemins de fer au Mexique. Ensuite, de ce Mexique de Proust, j’en suis venu à l’ensemble de l’Amérique du Sud, comme pour rendre hommage aux écrivains que nous avons mentionnés plus tôt : Borges, Cortázar, Bolaño. A partir du moment où j’ai décidé de parler du Mexique, je me suis demandé ce que je connaissais réellement du Mexique et j’ai décidé de l’étudier de manière plus approfondie. C’est là que la littérature que j’aimais est venue à mon secours : Bolaño, évidemment, qui décrit un peu le pays, mais aussi Juan Rulfo que j’ai relu alors. Je me suis aussi replongé dans Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, un de ces livres qui me fait aimer la littérature.
L’histoire joue un rôle important dans votre livre. La trame narrative de Chemins de fer du Mexique reprend un épisode crucial de l’histoire italienne du XXe siècle, la République de Salò, un régime collaborationniste de l’Allemagne nazie qui a existé entre le 23 septembre 1943 et avril 1945, voulu par Adolf Hitler et dirigé par Benito Mussolini afin de gouverner une partie des territoires italiens militairement contrôlés par les Allemands après l’armistice de Cassibile. Comment avez-vous conçu et entrecroisé le travail d’invention et de documentation dans l’écriture du roman ?
Je voulais à tout prix reconstituer la ville d’Asti de 1944. En effet, ce n’est qu’avec une reconstitution historique précise qu’il est possible d’opérer des changements dans l’histoire. Je savais que j’allais créer une sorte d’uchronie, c’est-à-dire une année 1944 un peu différente de celle qui a réellement existé. J’avais donc besoin d’une base et de tout savoir. J’ai consulté des archives et notamment celles de l’Institut de la Résistance. J’ai lu des journaux de l’époque, surtout locaux car ce sont des mines d’informations sans pareille : ils racontent les nouvelles du coin, ils disent les dates d’ouverture et de fermeture des cinémas, ils rappellent qu’il y avait un couvre-feu, ils montrent les annonces publicitaires et, avec elles, les goûts et les besoins des gens à l’époque. Il y avait des offres d’emploi et toutes ces informations qui vous permettent de construire le contexte véridique d’une histoire. Et puis, j’ai eu la chance de trouver le journal d’un prêtre datant de février 1944. Au départ, le roman se déroulait en novembre 1943. Puis j’ai réalisé que la Garde nationale ferroviaire n’avait été créée que le 8 décembre 1943 et j’ai donc dû décaler mon histoire à un mois de l’année où les conditions climatiques sont relativement proches de celles du mois de novembre. C’est comme ça que j’ai choisi de placer l’action du roman en février 1944. J’ai ensuite vérifié à quelle heure le soleil se levait et à quelle heure il se couchait pour assurer la vraisemblance de mon récit, car si le personnage doit se promener dans la ville à différentes heures du jour, si je dis que le jour se lève à 7 heures et qu’en février à 7 heures il fait encore nuit noire, l’ensemble devient un peu absurde. Enfin, par commodité, j’ai décidé de placer la maison de Cesco Magetti exactement dans la rue où j’habite. Je partais de la maison pour procéder à des vérifications et je calculais le temps réel nécessaire pour se rendre à tel ou tel endroit de la ville. Cela m’a permis de connaître ma ville d’une manière unique. Cela m’a également permis de connaître l’urbanisme d’Asti qui, en 1944, était très différent de ce qu’il est aujourd’hui. L’onomastique est aussi un moyen de redécouvrir l’histoire d’un lieu : le célèbre Corso Regina Margherita à Asti, comme l’Italie était une monarchie à l’époque, s’appelait à l’époque Viale Gabriele d’Annunzio en raison de la proximité de l’écrivain avec l’idéologie dominante. Puis, immédiatement après la guerre, cette même rue a été renommée Viale Partigiani (des partisans). Il est passionnant de voir comment ces changements contribuent à créer l’histoire et comment cette documentation permet, d’une certaine manière, de faire des Chemins de fer du Mexique une œuvre ouverte où le lecteur qui veut vérifier les informations peut reconstruire l’histoire. D’ailleurs, plus d’une personne m’a écrit après avoir lu le livre parce qu’elle voulait venir à Asti pour une visite guidée. Je les ai donc emmenés faire un tour, évidemment le lundi, parce que j’étais libre !
Malgré cette importance accordée à l’Histoire dans le roman, le lecteur est sensible au traitement non réaliste de certains des personnages, et en particulier des soldats de la Wehrmacht et des officiers du Troisième Reich comme Obersturmbannführer Hugo Kraas par exemple, qui sont représentés non sans ironie, voire avec sarcasme. Ce choix stylistique permet de prendre de la distance quant à l’objet traité : le regard jeté sur la période paraît finalement anachronique et les figures historiques apparaissent comme bouffonnes, loufoques et même grotesques. Quels ont été vos modèles dans la représentation de l’Italie fasciste ?
Cet effet est peut-être inconscient, car je ne pense pas avoir suivi de modèle. Je voulais décrire tous ces personnages et ces situations et les mettre au pilori. D’ailleurs, en définitive, le personnage d’Hugo Krass n’est pas vraiment bouffon. C’est un méchant si l’on veut, mais un méchant jusqu’à un certain point, parce que finalement c’est surtout quelqu’un qui n’a pas de scrupule. Parce qu’en fait, les nazis, on s’attend en quelque sorte à ce que ce soient des salauds. Ainis, la présence de Cesco Magetto auprès de lui dans le chapitre où Krass joue au golf ajoute une bizarrerie et une rupture, dans le sens où si les nazis sont évidemment indifférents à la mort et à tout de manière générale, ils ne le sont pas ici en tant que nazis. Ils sont finalement indifférents en tant qu’êtres humains. Parce que les êtres humains peuvent être des salauds et des méchants indifférents.
J’avais peut-être à l’esprit les lointains échos d’un livre que j’ai toujours aimé, que j’ai lu il y a longtemps et qui me vient à l’idée : Alfred Jarry et tout le cycle d’Ubu. Je suis un grand amateur de théâtre, et d’ailleurs, je pense que dans le chapitre mettant en scène Adolf Hitler et Eva Braun, j’ai explicitement voulu faire un chapitre écrit à la manière d’Ionesco, pour faire de cet épisode une sorte de farce absurde. Et en même temps, j’ai essayé de traiter un sujet très délicat, parce que parler d’Hitler, c’est toujours délicat. D’autant plus d’ailleurs que dans ce chapitre, on ne rit pas seulement d’Hitler à la façon du Dictateur de Chaplin, mais on rit avec Hitler. Il y a donc même le risque d’une complicité entre lui et le lecteur qui voit Hitler dans un moment de totale quotidienneté, dans une dispute avec sa compagne, le type de situations que nous avons tous vécu. Mais c’est exactement ce que je voulais faire, c’est-à-dire prendre un moment de la vie quotidienne d’Hitler et qui n’appartienne pas seulement à Hitler, mais qui soit commun à tout le monde. Je voulais par-là aborder le thème du mal, de la banalité du mal.
Je voulais par-là aborder le thème du mal, de la banalité du mal.
Chemins de fer du Mexique est aussi l’occasion d’inventer une histoire littéraire parallèle, qui commence avec l’Historia poética y pintoresca de los ferrocarriles de México de Gustavo Baz, le livre que Magetti recherche désespérément pour rédiger sa carte, et se poursuit avec l’invention du poète Vicente Orozco, un poète de la génération de 1937, et celle d’Edmondo Bo, « poète-freineur, ou freineur-poète », amoureux des poètes à condition qu’ils se suicident. Pouvez-vous nous parler de l’intention et du sens que vous donnez à ces inventions d’un canon littéraire et d’un monde littéraire parallèles ?
Dans Chemins de fer du Mexique, les livres et les pseudo-livres jouent un rôle essentiel. Le pseudo-livre le plus important est évidemment le livre autour duquel tourne la quête obsessionnelle du protagoniste, Cesco Magetti, à savoir l’Historia Poética en effet. Elle représente le livre perdu, le livre-Graal vers lequel il faut tendre, le but ultime d’une quête que le héros doit entreprendre par soif d’aventure ou de connaissance, ou encore (et je dirais que c’est le cas de Cesco Magetti) parce qu’il est contraint par les événements, parce qu’il est dépassé par le cours de l’histoire. Plus généralement, les pseudo-livres ont pour fonction d’approfondir une partie de l’univers narratif du roman, mais aussi, et c’est en ce sens qu’elles sont utilisées dans Chemins de fer du Mexique, de bifurquer vers l’histoire principale, ou de rattacher une branche secondaire à la trame narrative. En bref, dans le cas de Historia poética, la fonction est également de construire un monde dans le monde. Dans ce cas, c’est un monde à peine esquissé, que le lecteur imagine, mais suffisant pour créer une atmosphère exotique, mystérieuse, aventureuse, faisant référence aux chemins de fer mexicains, ce que je cherchais à créer.
D’ailleurs, dans la deuxième partie du roman, l’Historia poética sera, si la seconde partie voit véritablement le jour, le protagoniste, à la fois en tant qu’objet physique, en tant que livre, avec toutes les personnes qui l’ont possédé et lu, qui l’ont annoté, sali, dessiné, et en tant que contenu même. Évidemment, tout cela contribue à construire aussi une histoire littéraire imaginaire.
Le titre Chemins de fer du Mexique est un surprenant hommage à Marcel Proust, qui avait des actions en bourse sur les chemins de fer mexicains. Pour conclure, pourquoi ne pas répondre à quelques questions du célèbre questionnaire de Proust.
Votre occupation préférée ?
Je dois forcément répondre l’écriture. En fait, je suis indécis entre la lecture et l’écriture. Disons plutôt la lecture-écriture tout attaché. Raconter des histoires et écouter des histoires, c’est mon occupation préférée. Mais aussi jouer avec mon fils, ce qui est encore une variante de la narration.
Votre héros de fiction ?
Je pourrais dire, pour rester dans les classiques, Hector et Ulysse. Et l’autre Ulysse, celui de Joyce. Mais aussi Don Quichotte. Oui, Don Quichotte est fantastique.
Votre héros dans la vie réelle ?
C’est une bonne question, car je n’ai pas trop ce culte du héros. Je ne peux pas trop répondre. J’ai du mal. Frida Kahlo (ndlr : Ce jour-là, Gian Marco Griffi porte un T-shirt à l’effigie de Frida Kahlo). Et Tina Modotti, son amie.
Votre héros dans l’Histoire ?
Sandro Pertini (ndlr : un partisan devenu Président de la République italienne de 1978 à 1985).
Les personnages historiques que vous détestez le plus ?
Dire Hitler serait une réponse trop facile, donc je vais donner le nom d’un Italien : Mussolini. Mussolini est vraiment un personnage qui est difficile à digérer.
Votre état actuel ?
La joie d’être ici à Paris.
Et pour finir, votre devise ?
Sic semper tyrannis. C’est toujours ainsi que la mort vient aux Tyrans.
Entretien mené et traduit par Milène Lang et Giovanni di Benedetto.
Crédit photo : Francesca Mantovani ® Gallimard
- Chemins de fer du Mexique, Gian Marco Griffi, Gallimard, « Du monde entier », 2024.