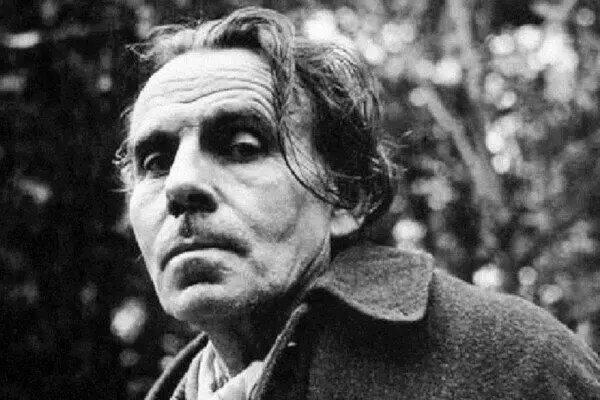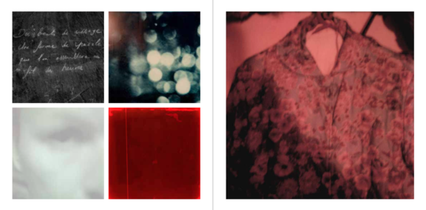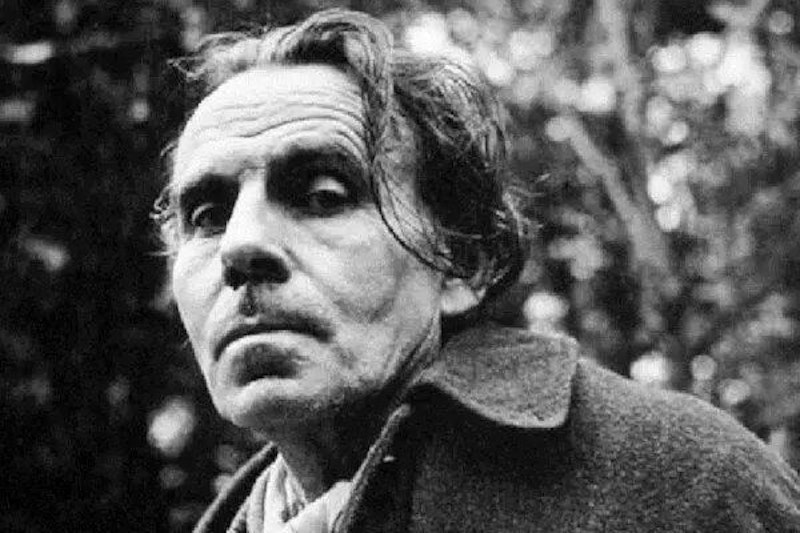
La sortie de ce premier inédit miraculeux de Louis-Ferdinand Céline inaugure quelque chose qui est probablement sans équivalent dans l’histoire de la littérature. Depuis le cinq mai dernier, des milliers de lecteurs peuvent découvrir en même temps les écrits d’un des plus grands auteurs français, en faire la critique, partager leurs impressions, faire s’affronter les inévitables préférences, tout cela comme s’il était question d’un auteur vivant sortant son dernier opus ; tandis qu’une génération entière de céliniens — dont certains particulièrement dévoués et pointus — a disparu sans avoir pu en lire une ligne.
Lorsqu’a lieu le débarquement du 6 juin 1944, Céline met rapidement en ordre ses affaires afin de fuir la très prochaine épuration qui ne manquera pas de lui rendre la monnaie de ses pamphlets antisémites. Ne pouvant emporter avec lui le mètre cube de manuscrits sans attirer l’attention sur une fuite qui devait évidemment rester secrète, il place les feuillets au-dessus d’une armoire de son appartement du 4 rue Girardon. La stratégie était-elle inspirée de la lettre volée d’Edgar Poe ? Elle n’eut pas le même succès. L’appartement est pillé, et les papiers — entre autres — disparaissent. Céline fulmine et accuse, mais on ne le prendra guère au sérieux, ni en pitié. Il avait pourtant mentionné les objets du larcin dans des lettres, notamment à son éditeur Denoël : « J’ai résolu d’éditer Mort à crédit, premier livre, l’année prochaine Enfance, Guerre, Londres. »

On se gardera bien ici d’arbitrer entre les prétentions de ceux qui ont le droit pour eux, et les mystérieux agents de cette retenue qui ne souhaitaient pas engraisser la veuve d’un auteur ayant commis des pamphlets ignobles pour le fond, quoiqu’admirables parfois pour la forme. Qui pourrait démêler dans cette affaire le sac de nœuds des questions patrimoniales, légales, esthétiques, morales et économiques ? La justice a sans doute bien fait de botter en touche et de nous épargner un spectacle qui, plus long, aurait immanquablement été plus navrant. On appréciera également que ces textes, antérieurs de quelques années aux écrits antisémites de Céline, aient assez peu agité l’inévitable baromètre du « faut-il séparer l’homme et l’œuvre ? ». Le célinien passionné peut presque savourer ce nouveau volume sans être traité ouvertement de collaborateur — ce plaisir n’est pas si fréquent.
Mais si ce « Guerre » peut offenser quelqu’un, ce sera plutôt les « contempteurs » du corps et les adeptes de la pudeur littéraire, comme on le verra. Le roman raconte un épisode de guerre inspiré de l’expérience de Céline, vers la fin 1914 en Belgique : sa blessure à la tête, sa convalescence, puis son projet de fuite vers Londres. Comme toujours chez l’auteur, la biographie est dopée à l’imagination, et il faut se garder de voir les textes comme de rigoureuses autobiographies.
Que vaut ce texte ? A-t-on raison de crier au chef-d’œuvre, ou se laisse-t-on abuser par la renommée de l’auteur ? Être méfiant en la matière est un droit, après que tant d’éditeurs aient tenté d’augmenter leurs bénéfices en proposant les fonds de tiroir d’écrivains qui avaient parfois bien raison de ne pas tout publier. Tâchons d’être nuancé : on ne peut raisonnablement pas mettre Guerre au même rang que les grandes œuvres publiées de l’auteur. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Féerie pour une autre fois, la « trilogie allemande » sont d’une autre facture, pour des raisons tout à fait objectives : le travail du style. Guerre est un premier jet retouché, il nous fait entrer dans ce qui était chez Céline le début d’un très long, d’un très exigeant processus de réécriture et de retouche. Comme Flaubert, il était un forçat du texte, et ne s’estimait content que lorsque l’agencement des mots parvenait à produire cette « petite musique » qui était, selon lui, sa principale invention. C’est la raison pour laquelle il ne garde pas ses brouillons ; et aussi pour laquelle il méprise tant d’écrivains reconnus :
« Mauriac ?.. Directeur d’École Libre qui a mal tourné… qui s’est donné à la politique et tout un tas de trucs… Giono..? Insignifiant je dois dire… N’est-ce pas ? Insignifiant… Je peux vous dicter au microphone… tout de suite… un roman de trois cents pages..! Anatole France ou Bourget… Je peux inventer une intrigue entre mademoiselle là… monsieur ici… et puis la machine à coudre et puis le bonhomme d’en bas !.. C’est facile ! N’est-ce pas ?! Mais j’aimerais mieux mourir que faire des histoires comme ça… Tiens ! Je considère ça comme très vulgaire !.. Je ne veux pas ! Je veux gagner ma vie d’une certaine façon… Je ne veux pas faire ma vie comme putain n’est-ce pas… Je veux faire ma vie comme ouvrier honnête… Bon… Alors je suis à mon établi… Je la fais… Je fais passer… au prix d’un abominable effort… l’émotion du langage parlé dans le langage écrit… J’y suis parvenu dans une certaine mesure et je crois assez bien… Oui… Assez bien. »
L’art poétique de Céline est inséparable du dégoût. Il faut lire ce long passage de Bagatelles pour un massacre pour s’en convaincre, et pour comprendre ce qui sépare Céline de tous les autres :
« Ce n’est pas tout à fait de leur faute… À ces grands écrivains… Ils sont voués depuis l’enfance, depuis le berceau à vrai dire, à l’imposture, aux prétentions, aux ratiocinages, aux copies… Depuis les bancs de l’école, ils ont commencé à mentir, à prétendre que ce qu’ils lisaient ils l’avaient en personne vécu… A considérer l’émotion « lue », les émotions de seconde main comme leur émotion personnelle ! Tous les écrivains bourgeois sont à la base des imposteurs ! Escrocs d’expérience et d’émotions… Ils sont partis dans la vie du pied d’imposture… Ils continuent… Ils ont débuté dans l’existence par une imposture… […] Les uns sont de plain-pied, dès l’origine, dans l’expérience, les autres seront toujours des farceurs… Ils n’entrent dans l’expérience que plus tard, par la grande porte, en seigneurs, en imposteurs… même Vallès. Ils ont fait la route en auto, les mômes de la communale, à pompes… Les uns ont lu la route, les autres l’ont retenue, butée, soumise pas à pas… Un homme est tout à fait achevé, émotivement c’est-à-dire, vers la douzième année. Il ne fait plus ensuite que se répéter, c’est le vice ! Jusqu’à la mort… Sa musique est fixée une fois pour toutes… dans sa viande, comme sur un film photo, la première impression… C’est la première impression qui compte. Enfance des petits bourgeois, enfance de parasites et de mufles, sensibilités de parasites, de privilégiés sur la défensive, de jouisseurs, de petits précieux, maniérés, artificiels, émotivement en luxation vicieuse jusqu’à la mort… Ils n’ont jamais rien vu… ne verront jamais rien… humainement parlant… Ils ont appris l’expérience dans les traductions grecques, la vie dans les versions latines et les bavardages de M. Alain… Ainsi qu’une recrue mal mise en selle, montera sur les couilles de travers, pendant tout le reste de son service… tous les petits produits bourgeois sont loupés dès le départ, émotivement pervertis, séchés, ridés, maniérés, préservés, faisandés, du départ, Renan compris… Ils ne feront que « penser » la vie… et ne « l’éprouveront » jamais… même dans la guerre… dans leur sale viande de « précieux », de sournois crâneurs… Encroûtés, sclérosés, onctueux, bourgeoisés, supériorisés, muffisés dès les premières compositions, ils gardent toute leur vie un balai dans le trou du cul, la pompe latine sur la langue… »
C’est la raison pour laquelle un véritable amoureux de Céline ne doit pas placer Guerre trop haut. L’« abominable effort » pour faire passer l’émotion dans le langage écrit n’y est pas mené jusqu’au bout. La « viande » a le goût fixé, mais demande à passer en version écrite. Même de la part de Céline lui-même, le premier jet est encore encombré de toutes les raideurs de l’usage, de toutes les ankyloses de l’automatisme. L’artiste n’y est pas revenu cent fois pour « faire sortir de ses gonds » le langage. Bien sûr, on y trouve des passages absolument magnifiques, où la première expression semble trouver immédiatement la perfection qu’on retrouve dans le papier bible des Pléiade :
« C’est drôle y a des êtres comme ça ils sont chargés, ils arrivent de l’infini, viennent apporter devant vous leur barda de sentiments comme au marché. Ils se méfient pas, ils déballent n’importe comment leur marchandise. Ils savent pas comment présenter bien les choses. On a pas le temps de fouiller dans leurs affaires forcément, on passe, on se retourne pas on est pressé soi-même. ça doit leur faire du chagrin. Ils remballent peut-être ? Ils gaspillent ? Je ne sais pas. Qu’est-ce qu’ils deviennent ? On n’en sait rien du tout. Ils repartent peut-être jusqu’à ce qu’il leur en reste plus ? Et alors où qu’ils vont ? C’est énorme la vie quand même. On se perd partout. »
Les lecteurs de Mort à crédit s’y retrouvent. Ceux du Voyage aussi : l’infini et le pathétique du petit détail se donnent la main, on en redemande. On croit lire du Pascal, l’esprit parcourt en quinze mots l’espace qui sépare son néant de l’infini, et les contracte pour qu’on les ait bien ensemble sous les yeux. Avec un petit « style coupé », par lequel la phrase nous gifle en même temps qu’elle nous instruit :
« Je m’étais pas trompé de beaucoup. Je suis doué pour l’imagination, je peux bien le dire sans vexer personne. Je crains pas non plus la vérité, mais avec ce qui se passait à Peurdu-sur-la-Lys y avait de quoi faire tomber la fièvre à bien des bataillons. Pas de questions. Je m’explique. On jugera. Dans ces cas aussi on se conseille soi-même. On se dirige sur ce qui vous reste d’espérances. Ça brille pas fort l’espérance, une mince bobèche au fin bout d’un infini corridor parfaitement hostile. On se contente. »
On peut continuer longtemps la chasse aux champignons :
« On n’a plus répondu. Seulement ceux qui gémissaient, ils gémissaient plus. Sauf un qui répétait Marie, plutôt avec un accent, et puis un glou glou tout près de moi, d’un mec sûrement qui se vidait par la bouche. Je connaissais ce ton-là aussi. J’avais appris en deux mois à peu près tous les bruits de la terre et des hommes ».
« On a regardé. Loin, loin c’était toujours du soleil et des arbres, ce serait le plein été bientôt. Mais les taches de nuages qui passaient restaient longtemps sur le champ de betteraves. Je le maintiens c’est joli. C’est fragile les soleils du Nord. À gauche défilait le canal bien endormi sous les peupliers plein de vent. Il s’en allait en zigzag murmurer ces choses là-bas jusqu’aux collines et filait encore tout le long jusqu’au ciel qui le reprenait en bleu avant la plus grande des trois cheminées sur la pointe de l’horizon. »
« Je croyais pas beaucoup aux journées nouvelles. Chaque matin j’avais plus de fatigue que la veille à force de m’être réveillé vingt trente fois par les bourdonnements au cours de la nuit. C’est des fatigues qui n’ont pas de nom, celles qu’on tient de l’angoisse. On sait bien ce qu’il faudrait faire dormir pour redevenir un homme comme les autres. On est trop fatigué aussi pour avoir l’élan de se tuer. Tout est fatigue. »
Mais on trouve aussi bien des maladresses, que Céline n’aurait probablement pas conservées dans une version finale, même si elles comportent leur part de charme. Parmi ces beautés impures, comment ne pas regretter le passage suivant :
« Je croyais que j’allais réveiller la bataille tellement que je faisais du bruit dedans. Je faisais à l’intérieur plus de bruit qu’une bataille. »
L’image est belle, mais manque singulièrement de fini, avec cette répétition qui blesse l’oreille. Toute la première partie, d’ailleurs, est singulièrement plus faible que la suite. De quel droit se permet-on de juger aussi cavalièrement la prose du plus grand écrivain du XXe siècle ? Répétons-le, la critique de l’écriture spontanée, des premières intuitions, des esquisses, est en même temps hommage à la patience de l’artisan. Ce brouillon nous permet justement de mesurer tout ce que Céline peut quand il ne s’arrête pas avant la satisfaction du travail bien fait. Dire « c’est du Céline » veut dire « c’est du travail de Céline », jamais quelque chose qui tombe directement dans le bec, ou qui serait l’expression naturelle, non-transformée, de son idiosyncrasie.
Autre motif peut-être de déception, mais qui relève davantage du goût particulier du lecteur, l’excès de vulgarité parfois quasi pornographique, qui est comique à petites doses, et donne immédiatement à sentir quelque chose de la rugosité extrême des circonstances, mais qui finit souvent ici en plaisanterie de trouffion, perdant quelque chose de cet art dont on parlait plus haut, par lequel Céline encapsule toute l’amplitude de l’existence. Cela se discute, mais on remarquera que les œuvres ultérieures de Céline abandonneront cette outrance trop massive et un peu facile, ce qui dit assez ce que l’auteur a lui-même tiré comme conclusions sur son art.
Malgré ces imperfections bien compréhensibles, ce texte est un régal, et l’estimer à sa juste valeur n’empêche pas d’en recommander chaudement la lecture. Ce n’est peut-être pas un chef-d’œuvre, et s’il apparaît tel, c’est sans doute par la distance immense qui sépare le Céline « moyen » de l’étiage de notre littérature contemporaine, surtout dans les grandes maisons. Mais bien des littérateurs d’aujourd’hui se damneraient pour être capables d’écrire certaines de ses phrases sublimes qui semblent arriver sous la plume de l’auteur de Guerre avec une facilité déconcertante, même si le polissage y manque. C’est d’autant plus remarquable que Céline s’acharne à ce point à retoucher sa prose, quand un premier jet suffirait à lui assurer la reconnaissance.
Romain Peter