Dans Courir, Jean Echenoz se réapproprie l’histoire de l’athlète Emil Zátopek en l’érigeant au rang d’un artiste façonnant l’art de la course, et aussi l’art de la vie. Au fil de ses performances, le sportif-artiste grandit, échoue, et se reconstruit, sculptant son corps et son esprit.
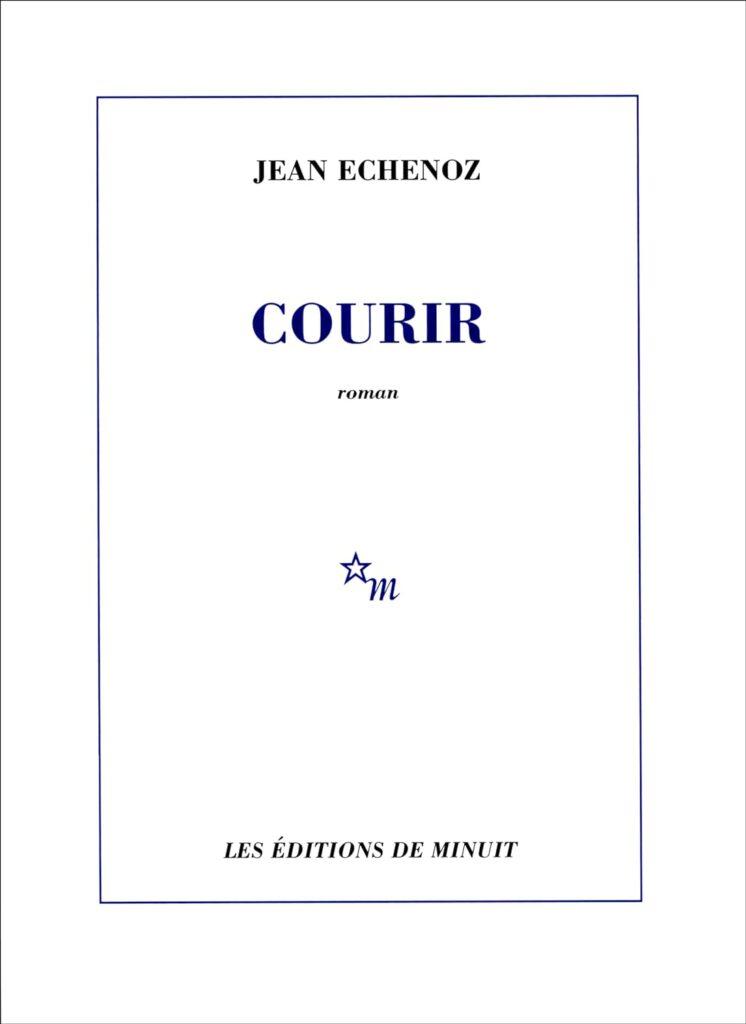
« Celui qui veut apprendre à voler, celui-là doit d’abord apprendre à se tenir debout et à marcher et à courir, à grimper et à danser. Ce n’est pas du premier coup d’aile que l’on conquiert l’envol ! »
Ces mots de Nietzsche résonnent avec l’œuvre de Jean Echenoz, Courir publiée aux Éditions de Minuit en 2008. Cet ouvrage s’inscrit dans une lignée d’écriture particulière pour l’auteur, puisque deux ans auparavant, il publie Ravel, un livre qui évoque la vie du célèbre compositeur. Jean Echenoz souhaite romancer des destins extraordinaires, issus de différents milieux, mêlant subtilement des éléments vrais à des éléments fictionnels. Par la suite, il écrit Des éclairs (2010)qui dresse le portrait de l’inventeur Nicolas Tesla. Loin de se prétendre biographe, Jean Echenoz cherche en ces profils une certaine sensibilité, ce qui démarque ces personnalités, ce qui fait leur succès, mais aussi leurs déboires. Hors de question de glorifier des figures connues du grand public, non. C’est une plongée dans leur intime, leurs forces, leurs failles qui l’intéresse.
Dans Courir, Jean Echenoz met en scène un sportif de renom, Emil Zátopek, athlète tchécoslovaque, spécialiste des courses de fond, dont il francise le nom « Émile ». Si cela peut paraître étonnant pour un romancier de s’inspirer de l’histoire d’un sportif, ce choix est en réalité légitime : Jean Echenoz a grandi dans les années 1950, et les performances extraordinaires de Zátopek noircissent les pages des journaux. Au-delà du parcours étonnant du coureur, le contexte historique dans lequel il évolue, ainsi que plus tard ses engagements feront de Zátopek un ovni dans son milieu – un personnage unique, quelque peu « maudit », et pourtant, proche du génie dans sa pratique. Ce sont ces éléments qui courent sur les pistes de l’histoire de Zátopek « réimaginée » par Jean Echenoz : un sportif-artiste, personnalité hybride, à la détermination ascétique, pantin du système qui élèvera sa voix pour la liberté. En somme, toutes les caractéristiques qu’on retrouve dans les plumes, les peintures, les chansons et les images des plus grands artistes du XXème siècle.
C’est bien ce parallélisme entre la figure de l’artiste et du sportif qui émerge dans Courir, et qui permet au lecteur de découvrir une facette silencieuse de Zátopek par le regard de Jean Echenoz.
La vie « imaginaire » d’Émile Zatopek
Il serait étrange d’employer le terme de « biographie fictionnelle », si on part du principe qu’une biographie se doit d’être fidèle à la vie de la personne, objet du livre. Dans l’ensemble des biofictions d’Echenoz, celles de Ravel, Zátopek et de Tesla constituent un véritable exercice de style qui n’est d’ailleurs pas un cas isolé dans l’histoire de la littérature. Marcel Shwob constate ainsi que dès l’année 1984, « une coïncidence de multiples publications convergentes » renouvelle ce qu’il nommera lui-même « les vies imaginaires ». Qu’il s’agisse ainsi de réécrire la vie d’un personnage réel, ou bien d’établir la biographie détaillée d’un personnage fictif, les frontières entre le vrai et la fiction se touchent, au point qu’il est presque impossible de les distinguer.
Dans le cas de Courir, Echenoz ne se lance pas dans une description chronologique des événements de la vie du sportif, ni dans une glorification de ses exploits. Bien au contraire, il s’agit de plonger dans son intime, que ce soient ses failles ou espoirs. Jamais Echenoz n’est tenté de rendre Zátopek plus grand qu’il ne le fut : « L’imprévu, c’est que bientôt ça commence à lui plaire. Il ne dit rien mais il paraît y prend de goût. Au bout de quelques semaines voici même qu’il se met à courir seul, pour son propre plaisir, ce qui l’étonne lui-même et il aime mieux ne pas en parler à qui que ce soit. » (p.18) C’est avec simplicité qu’Émile, dont il francise le nom volontairement, devient plus intéressant que Zátopek, celui dont le nom s’imprime aussi facilement sur les journaux que ses victoires. Ainsi, comme l’affirme Frank Wagner dans « Des coups de canif dans le contrat de lecture », « la biofiction échenozienne » brouille les pistes sur lesquelles les lecteurs courent alors qu’Émile les dépasse déjà, car lui-même devenu personnage de fiction dans un décor qui mime parfaitement la réalité.
Émile : le coureur-artiste
Si on se souvient d’un Zátopek prodige, dont les jambes semblent presque « voler » sur le terrain, le visage émacié et grimaçant par l’effort à la télévision, la foule l’applaudissant, l’Émile d’Echenoz représente davantage ce qui se cache derrière un tel succès. Ce n’est pas tant la carrière extraordinaire du sportif qui frappe l’auteur, mais davantage les coulisses d’un génie qui rien ne prédestinait au sport – un sport qu’il transforme d’ailleurs en art. Dans un cas plus récent, rappelons-nous d’un Roger Federer que toute la presse nommait le « Maestro », car il avait la grâce d’un chef-d’orchestre sur le terrain, maîtrisant ses coups comme un musicien classique. L’élégance majestueuse de ses gestes, parfaitement pensés et travaillés, contrastait avec l’image du sport, si éloignée de l’art, et pourtant si proche, ce qu’explique Robert Redeker dans Sport, je t’aime moi non plus :
« Et pourtant, dans ce ‘même pas de l’art’ qu’est le sport, cet empire du dérisoire, la beauté trouve sa place. Fendons le sport en deux : le spectacle, et la pratique. Le type de beauté ne sera pas le même : il supposera une extériorité du sujet faisant l’expérience de la beauté à l’action dans le cas du spectacle, depuis les tribunes ou devant la télévision, il renverra à une fusion du sujet et de l’action dans le cas de la pratique. Dans la seconde occurrence, la beauté se fait tout intérieure : elle est une sorte de joie de se mouvoir dans le monde, une joie issue du corps, du mouvement des membres, des organes, de l’exercice de leur puissance. Une joie d’être dans le monde. Une joie de respirer le monde. »
Dès le départ, Echenoz insiste sur le fait qu’Émile ne court pas comme les autres, que sa manière de courir est « bizarre », et que tous pensent « qu’il fait n’importe quoi » : « Tu cours bizarrement mais tu ne cours pas si mal, lui dit-il. Enfin vraiment tu cours très bizarrement, insiste l’entraîneur en secouant une tête incrédule, mais bon, tu cours pas mal. De ces deux propositions Émile n’écoute et n’entend distraitement que la seconde. »
« Bizarre », certes, mais cela ne l’empêche pas de cultiver cette différence, de manière ascétique, à la manière de l’écrivain qui sculpte son style : « Émile, on dirait qu’il creuse ou qu’il se creuse […] loin des canons académiques et de tout souci d’élégance, Émile progresse de façon lourde, heurtée, torturée, tout en à-coups. Il ne cache pas la violence de son effort qui se lit sur son visage crispé, tétanisé, grimaçant, continûment tordu par un rictus pénible à voir. » (p.49)
C’est avant tout la construction très personnelle d’un style, d’une sensibilité artistique qu’Echenoz décrit. Émile, d’ailleurs, « invente » le sprint final, il repousse les limites de la création sportive pour perfectionner sa pratique, s’approprier une certaine façon de courir qui reste inimitable, car entièrement crée de son esprit et de ses efforts. Robert Misrahi écrivait : « Quelles que soient les motivations sociales d’une pratique sportive, l’essentiel réside cependant ailleurs : dans le pur plaisir d’une activité heureuse où le désir déploie sa rêverie sur les substances qu’il s’est choisies pour s’y réfléchir et s’en nourrir. »
Ce n’est pas la première fois que l’ascèse, presque violente, de l’artiste est mise en avant. Nous pouvons faire un parallèle avec Meaume, dans Terrasse à Rome de Pascal Quignard, où la gravure est un acte cathartique, d’une violence extrême pour faire surgir toute la créativité de l’artiste, ou encore la force de l’écriture ascétique de Charles Juliet où ses lambeaux de mots tentent de combattre le mutisme qui le ronge. Émile est ainsi un ascète, courant avec la violence et l’art, sur le même terrain, toujours gagnant même dans la douleur, et surtout, dépassant un style enjolivé. Ce qui compte, c’est l’intensité du style :
« Faire marcher la machine, l’améliorer sans cesse et lui extorquer des résultats, il n’y a que ça qui compte et sans doute est-ce pour ça que franchement, il n’est pas beau à voir. C’est qu’il se fout de tout le reste. Cette machine est un moteur exceptionnel sur lequel on aurait négligé de monter une carrosserie. Son style n’a pas atteint ni n’atteindra peut-être jamais la perfection, mais Émile sait qu’il n’a pas le temps de s’en occuper : ce serait trop d’heures perdues au détriment de son endurance et de l’accroissement de ses forces.» (p. 54)
De par ce travail ascétique, Echenoz montre également l’évolution d’Émile. La course devient alors, également, une métaphore de la quête initiatique que tout être humain entreprend, et souvent d’ailleurs, à travers son art, pour citer Baudelaire : « L’humain, ce ‘frêle athlète de la vie’. »
L’humain : ce « frêle athlète de la vie. »
Dans une étude de Noëlle Portets, « Les sentiers de la performance », l’auteure met en avant que le sportif, tout comme l’artiste, « parfait » son empreinte dans le monde. C’est un besoin absolument humain, trop humain, de laisser une trace de son passage sur Terre, de faire et d’agir. L’Émile d’Echenoz n’apparaît pas comme un humain en quête de reconnaissance : il se laisse dépassé par les événements politiques, devient même un « pantin » du gouvernement malgré lui. A la fin du roman, il accepte non seulement son déclin physique, mais aussi de tomber dans l’anonymat. Non, Émile ne se bat pas contre la vie, peut-être d’ailleurs, ne cherche-t-il pas à courir contre elle. Cependant, il court avec elle, à grande vitesse, peu importe l’événement. L’important, c’est d’aller vite, la vitesse, c’est la source même de son style, et c’est aussi ce qui le rend vulnérable. D’après Guillaume Le Blanc, l’art de courir est à l’origine même d’une certaine vulnérabilité. Si, on pense à tort que le coureur est un être insubmersible, « il doit se composer une philosophie qui intègre cette expérience de la fragilité. Il la recherche même comme une preuve de sa vitalité. » En ce sens, le coureur s’approche de ce que Nietzsche décrivait à propos de la maladie qui demeure « un point de vue sur la vie », permettant ainsi, indirectement, un autre amour de la vie. Par son travail douloureux, sa recherche intense de la performance, au fil des pages, Émile se fait une autre idée de la vie, ne fuyant jamais sa vulnérabilité, s’y soumettant même, ce qui peut laisser au lecteur un goût amer de son personnage à la fin du livre. L’Émile d’Echenoz, malgré sa force sur le terrain, n’est pas un héros, ni un génie. Il est avant tout un humain dans toute sa fragilité, et aussi, sa résilience : « J’aime courir, je veux encore courir, courir beaucoup, mais ce n’est pas mal non plus de redevenir un coureur normal qui peut perdre. » (page 110)
De l’expérience de la perte, Émile semble tirer une leçon de dépassement, mais le lecteur ne s’attend certainement pas à la résilience dont le personnage fait preuve. Rattrapé par des années d’acharnement physique, et aussi par un engagement soudain contre le gouvernement à la fin du livre, Émile est presque « contraint » de ne plus courir. Couper les jambes à un coureur, c’est comme brûler la plume d’un écrivain : sa force vitale s’effondre. Cependant, Claude Leroy apporte une vision différente de la vulnérabilité d’Émile dans son étude « Solitude et grandeur du coureur à pied (Gibeau, Sillitoie, Echenoz) » : « Émile ne pense qu’à une chose, courir, mais cette chose, il ne la pense pas. Que lui importe de gagner ou de perdre (gagner, c’est quand même mieux), l’important, c’est de courir – sans penser. » Là où Leroy y voit dans le fait de courir un acte devenu robotique, palliant le vide qui habite le sportif, nous percevons davantage un Émile qui se réinvente – au risque de décevoir ses lecteurs-spectateurs. Lors du Printemps de Prague, lorsqu’Émile prend position pour soutenir les manifestants contre l’invasion soviétique, il est forcé de travailler durant six ans comme manutentionnaire dans la mine d’uranium de Jáchymov, puis en 1974, travaille comme éboueur dans les rues de la ville qu’il est autorisé à réintégrer. Réduit à l’anonymat, privé de son art, Émile est pourtant acclamé par le peuple : « Jamais aucun éboueur au monde n’aura été autant acclamé. Du point de vue des fondés de pouvoir cette opération est un échec. » (page 141) La course est donc bien une métaphore de l’existence, dans tout ce qu’elle a de plus beau et de plus cruel. Dans Le Stade aux cent portes, une œuvre publiée en 1930, André Cazenave écrit que « L’homme semble courir contre l’éternité », à comprendre ainsi, « contre la mort ». Cela prend donc sens dans l’idée d’Émile de courir, physiquement, symboliquement, et cela peu importe son statut : vedette du sport, éboueur, archiviste. Il faut dépasser l’étiquette d’artiste, de sportif : nous sommes humains avant tout, et nous ne sommes pas nés pour être des héros.
« To an Athlete Dying young », du poète anglaise A.E. Housman, est une élégie dans laquelle le narrateur se souvient du triomphe athlétique d’un jeune coureur, malheureusement décédé :
“The day you won your town the race
We chaired you through the marketplace
Today, the road all runners come
Shoulder high we bring you home
And set you at your threshold down
Townsman of a stiller town.”
Courir, certes, mais l’humain ne ressortira jamais gagnant de la course contre la mort. Il ne s’agit pas de se confronter à elle, mais bien de courir, continuer à courir sous toutes les formes possibles. Comme Claude Leroy le soulignant, l’Émile d’Echenoz tarde à révéler le célèbre Zátopek en lui, se présentant presque comme une personne familière, proche de l’auteur et du lecteur, un héros de conte qui n’a rien de la grandeur de son nom, mais tout de la vulnérabilité d’un personnage de roman auquel nous ne cessons de nous attacher malgré tout.
En cela, Courir peut être considéré comme un roman initiatique loupé, car jamais Émile ne se transforme en guerrier ou en héros de son destin. Pourtant, tout comme un artiste, il réinvente « les choses de la vie », il est humain avant d’être sportif, dans tout le déclin qu’implique la condition humaine et contre laquelle l’art ne peut lutter, si ce n’est, sûrement, en la racontant.
- Echenoz, Jean, Courir, Editions de Minuit, Paris, 2008.
- Crédit photo : Jean Echenoz – (c) ULF ANDERSEN / Aurimages
En période de JO, Zone Critique propose de revenir sur les écrivains qui ont abordé les liens entre littérature et sport. L’ensemble de ces textes se trouve dans le N°5 de la revue Sport, toujours disponible à la commande.


















