Alors que vient de paraître son troisième roman, Que notre joie demeure, aux éditions Héliotrope, Zone Critique a profité de la présence de l’écrivain Kevin Lambert au Festival America, à Vincennes, pour s’entretenir avec lui sur la littérature, l’écriture et la politique. Dans un entretien chaleureux et dynamique, l’auteur des remarqués Querelle et Tu aimerais ce que tu as tué, publiés chez Héliotrope au Canada et au Nouvel Attila et évoque une véritable recherche du tremblement au sein de l’écriture, manière d’une jouissance du texte comme d’une réflexivité féconde.
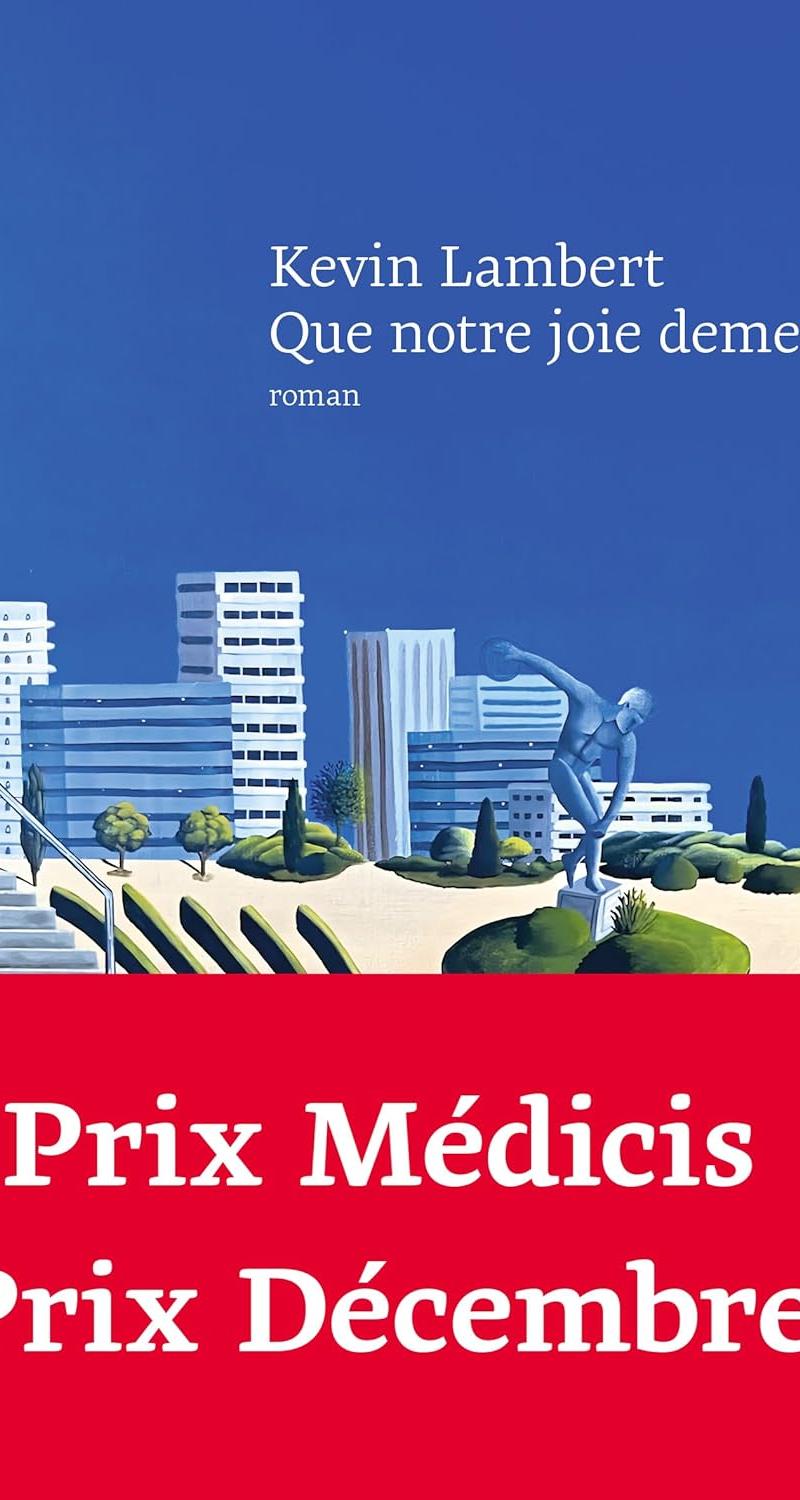
Rodolphe Perez : J’aurais aimé qu’on évoque de façon d’abord générale ta manière de toucher à tout : et tu écris, et tu enseignes, et tu as fait une thèse, et tu as été libraire. Comment ton rapport à l’écriture trouve-t-il son unité ? Ton approche du livre est multiple : comment cela impacte-t-il ton rapport à l’écriture ?
Kevin Lambert : C’est assez organique. J’ai fait mon parcours dans un programme de création littéraire, système très développé au Québec. En France il y en a de plus en plus mais ça reste assez nouveau. Dans ces programmes, on fait surtout des ateliers, personne ne nous apprend à écrire concrètement. Il s’agit d’ateliers où le texte est lu par le groupe, on commente ensemble, on se donne des pistes de re-travail de manière intersubjective. C’est vraiment la force de l’atelier. Donc l’écriture pour moi dans le cadre universitaire prenait sa place assez naturellement, puis d’un autre côté l’enseignement s’inscrit dans cette continuité parce que mon enseignement est un cours de création littéraire, j’utilise à la fois mon expérience d’écriture mais aussi mon expérience d’étudiant pour essayer de créer un climat où les étudiants ont envie d’écrire, de poursuivre leurs recherches dans l’écriture. Quand j’écris, j’écris toujours dans une forme de recherche plus thématique, liée aux enjeux du livres mais aussi une recherche stylistique, je lis beaucoup d’auteurs ou d’autrices pour m’inspirer, pour travailler la forme de mon texte. Quand j’enseigne la création, souvent je fonctionne comme ça : j’utilise des textes que je trouve intéressant puis j’essaie de montrer aux étudiants comment on peut lire le texte en écrivain ou en écrivaine, en se demandant comment l’auteur a fait, pourquoi il a pris cette décision. Il me semble que la seule manière d’apprendre est d’essayer de décortiquer ce qu’ont fait les autres.
Rodolphe Perez : J’imagine que ça vous met, toi en tant étudiant à l’époque, comme tes propres étudiants, sur un pied d’égalité avec les auteurs. Disons que l’aura qui peut émaner d’un auteur ou d’une autrice fait d’emblée moins peur, ce qui légitime une capacité à écrire, dans la mesure où le rapport à la littérature fait autrement sens, fait famille.
Kevin Lambert : Tout à fait. Quand on lit un texte en écrivain ou écrivaine, on se place au moment où l’oeuvre n’était pas un classique, on se place à un moment où Virginia Woolf ou Henry James se sont demandés comment construire leurs personnages, à quel moment telle phrase va arriver, comment je décris le passage du temps pendant dix ans sur une maison comme Virginia Woolf le fait dans To the lighthouse. C’est un jeu, un travail de fiction là encore, manière de se remettre au moment de l’écriture. Un texte qui nous apparaît comme classique de par le livre lui-même, de par sa collection, ses notes, ses analyses,… Tout ça nous intéresse moins, parce qu’on cherche vraiment à ramener le texte à ses possibilités, au moment où l’écrit est encore une série de possibilités inexplorées, où l’auteur choisit.
Rodolphe Perez : Dans quelles mesures est-ce que ce n’est pas prescriptif, ce n’est pas imposer des styles à des étudiants qui auront du mal à s’en défaire ? Comment arrives-tu à cet équilibre où demeure un rapport familier à la littérature, chaleureux – qui ferait moins peur – tout en s’appropriant une écriture qui nous est propre, singulière, émancipée de cette famille ? Comme dans tes romans d’ailleurs où se joue une dialectisation du milieu où l’on évolue. Comment travailles-tu cette tension ?
Dans l’écriture, on n’est pas dans l’intention individuelle mais on prend appui sur la direction que le texte lui-même donne, pour la suivre.
Kevin Lambert : Il ne faut jamais que les modèles imposent quoi que ce soit. C’est fondamental. Dans les cours de création, je n’ai jamais d’attentes stylistiques ni thématiques, c’est un espace où je les amène à écrire ce qu’ils désirent. Une des professeures qui m’a marqué reste Catherine Mavrikakis, écrivaine aussi, qui parle du « désir du texte », elle disait essayer d’amener le texte là où il veut aller. Là où l’auteur – étudiant ou étudiante – ne s’en rend même pas compte. On sort de l’intention, c’est ça qui est intéressant. On n’est pas dans l’intention individuelle mais on prend appui sur la direction que le texte lui-même donne, pour la suivre.
Rodolphe Perez : Comme sentir l’instinct du texte ?
Kevin Lambert : Exactement. La pire chose à faire pour des étudiants ou étudiantes serait d’imposer un style, au contraire il faut les amener à acquérir une maturité dans leurs propres décisions et à rejoindre leur propre désir. Parfois on ne sait pas ce qu’on veut, c’est tout un travail que permet aussi l’atelier. Barthes en parle dans son texte « au séminaire », dans Le Bruissement de la langue, il parle de « s’originaliser », il décrit bien ce travail, où l’on apprend à distinguer notre désir de celui des autres. Le séminaire, la forme d’un petit groupe, permet ça.
Rodolphe Perez : Chez Barthes c’est un mouvement similaire, entre une recherche de la neutralité – le fameux Neutre – et un besoin de « s’originaliser », de s’émanciper pour aller vers le « désir du texte », dont parle Mavrikakis mais, corollaire du fameux « plaisir du texte » barthésien, sorte de jouissance et dans l’écriture et dans la lecture. Ce qui veut dire que toi tu peux être face à des étudiants aux styles et thèmes absolument différents, et différents des tiens mais ton engagement propre sera de permettre à ce style d’émerger par lui-même, en dehors même de toi qui de fait t’effaces. Tu sécurises sans imposer.
Kevin Lambert : Oui, enseigner la création est aussi un travail d’humilité. Ne pas considérer qu’on serait meilleur qu’un autre. C’est l’écriture comme une technique, par technique je n’entends pas une série de règles, une série de recettes. La technique c’est la question du « comment faire », question de l’écriture, de la poiesis grecque. Comment fabriquer ? C’est précieux parce qu’en lisant différents auteurs, on peut approcher le texte de manière technique : comment construit-on un personnage au-delà de l’inspiration qui devrait venir naturellement à tout créateur ? Parce que cette image finalement ne nous aide pas beaucoup à écrire, peut même nous empêcher d’écrire. Ce qui est intéressant quand on pose la question de la technique c’est qu’on ne trouve jamais la réponse, on trouve seulement des stratégies, employées par différents textes : tel construit un personnage très psychologique, ou très réaliste, puis tel un personnage sans identité. Ce qui est agréable comme rassurant c’est de considérer que l’envie de faire un texte est appuyée par la technique, qui me permet de m’approcher de ce texte. Si pour écrire tel texte j’ai besoin de construire un personnage crédible, je veux commencer avec une scène de son intimité, je vais trouver des pistes. Déjà, quand je me pose cette question : où est l’intimité ? À la maison ? Où vit ce personnage ? Je cherche des solutions. On a tort de voir la technique comme un tabou de l’écriture, alors que c’est fondamental. D’ailleurs il y a aussi là l’idée qu’on est en constant apprentissage comme écrivain ou écrivaine, qu’on peut peaufiner notre texte, qu’on peut se dire d’un livre à l’autre : j’apprends peut-être mieux à construire un personnage, un récit ou une atmosphère.
Rodolphe Perez : Finalement, dans ce que tu dis, le texte est une entité quasiment autonome, face à laquelle, pour revenir à Barthes, tu es censé biaiser tout le temps. La technique te sert aussi à biaiser, face à ce texte qui t’échappe mais est à toi, face auquel tu rejoues un rapport créateur. J’imagine que lorsque tes textes ont été publiés en français, un an après les premières publications, il y a eu un rapport de reprise ou d’échappement du texte. Tu étais un nouveau primo-romancier en France.
Kevin Lambert : Tout à fait. Moi je ne crois pas à l’idée qu’un texte puisse être achevé. Giorgio Agamben en parle vraiment bien, il dit que la fin d’un texte est une contingence. Un processus potentiellement infini, où l’on pourrait toujours changer quelque chose. Le livre fixe les choses mais lorsqu’on rouvre le texte on pourrait tout changer, j’ai souvent cette envie là mais il y a aussi un stade où il faut défendre l’état. Le texte en est arrivé là et on peut laisser comme telle cette cristallisation là.
Rodolphe Perez : Comment considères-tu être arrivé à cette contingence là, que c’est cette contingence qui appelle que tu te décharges du texte ? Pourquoi ce moment là plus qu’un autre ?
Kevin Lambert : Je pense qu’il y a des éléments biographiques, externes. C’est virtuellement infini, mais ce n’est pas très utile de travailler un texte à l’infini, sinon c’est Le Chef d’œuvre inconnu, tu t’en sors pas. Il y a une série de hasards qui mettent un point final à un texte. Puis, je suis assez intéressé par les études de manuscrits, ceux qui travaillent sur les processus d’écriture d’écrivains plus classiques auxquels on a accès par les archives. Souvent on se rend compte que les plus beaux passages de la littérature relèvent du hasard. Il y a une anecdote que j’aime beaucoup à propos de la pièce Les Belles sœurs de Michel Tremblay, il y a un monologue très fort, très chargé. Le personnage dénonce les viols conjugaux. Ce passage-là il l’a écrit le lendemain de la première car l’actrice, en jouant la première, s’est rendu compte que toute les actrices avaient un monologue, mais elle non. Il s’est pressé le lendemain de lui écrire un monologue qui est en fait devenu l’un des passages les plus marquants du texte. On pourrait multiplier l’exemple par mille. L’écriture est une aventure et les vents qui soufflent dans ses voiles sont ceux de la vie, de l’inattendu. Une série de hasards qui fixent un texte ou non.
Rodolphe Perez : Et toi, lorsque tes textes ont été publiés en France, as-tu voulu les reprendre ou non ?
Kevin Lambert : Pour Querelle, on a adapté. C’est écrit dans une langue très propre à la région, c’est très oral mais dans une langue orale québécois du lac Saint-Jean, il y a donc beaucoup d’expressions utilisées principalement par les gens de cette région. Puis la langue orale est en discours indirect libre, elle est mêlée à la narration, on n’est pas dans un scission entre narration puis discours direct, guillemets, etc. Il y avait donc des enjeux de compréhension pour un lecteur français, qui malheureusement n’est pas assez en contact avec la langue orale québécoise, on a fait un travail, léger. Il y a eu un travail de recalibrage d’expressions qui pouvaient porter à confusion.
Rodolphe Perez : Et pourquoi avoir modifié le titre ?
Kevin Lambert : Pour la référence à Roberval, qui aurait pu créer une incompréhension face à l’imaginaire français. Puis le film de Fassbinder, adapté de Querelle de Brest, s’appelle juste Querelle, pour moi ce n’était pas vraiment une trahison que mon roman passe de Querelle de Roberval, au Québec, à Querelle.
Rodolphe Perez : Pour en revenir à la question de la technique, j’ai été frappé dans le Querelle justement, par la structure, structure très théâtrale, qui renvoie explicitement au théâtre antique, pourquoi as-tu fait ce choix ?
Kevin Lambert : Pour moi, les personnages qui sont mis en scène sont en lutte avec des forces supérieures, comme dans le théâtre antique. Assez rapidement ils se rendent compte, dans l’histoire syndicale, que ce n’est pas le patron l’ennemi mais une sorte de structure qu’on pourrait appeler le capitalisme, qui s’apparente pour moi, dans son caractère surpuissant et insaisissable, aux divinités antiques. C’est ça que nous raconte le théâtre antique : des gens qui tentent de lutter contre une fatalité, contre des choses plus puissantes qu’eux. On peut seulement perdre contre ces forces. J’aimais l’idée de reprendre aussi le théâtre antique, qui ne met en scène que des rois et reines, dans un milieu social qu’il ignore.
Rodolphe Perez : Oui, il n’existe pas, ou alors c’est un chœur lointain.
Kevin Lambert : C’est ça, c’est la voie commune mais sans aucune distinction, les personnages ne sont pas distingués. Pour ce que je voulais explorer du rapport au capitalisme, cette idée de charge tragique était importante.
Rodolphe Perez : On le sent, le texte cristallise une dimension excessive du tragique, jusqu’à la fin, qui l’est d’autant plus. Et en même temps, ce qui est paradoxale – pour la dimension théâtrale – sans l’être tout à fait c’est qu’il n’y a aucun discours direct, ce que tu disais justement. Toute forme de discours, quasiment, est en indirect libre. Il y a une sorte de jeu sur la forme romanesque, qui reprend une structure de théâtre, mais de théâtre noble puisque la tragédie antique est le genre le plus noble. Donc tu entreprends presque un jeu de souille de la noblesse d’un genre a priori supérieur – pour l’autorité qu’il représente aussi – avec une thématique qui, elle, va dans la crudité la plus profonde, explore des personnages qui ne sont jamais explorés dans la tragédie antique et en même temps retourne l’importance du dialogue dans une narration, elle-même saturée et polluée par l’indirect libre.
Kevin Lambert : Pour moi l’indirect libre est une manière de rendre le texte démocratique, au sens de faire entendre plusieurs voix. Tu as raison de dire que c’est impur parce que c’est beaucoup moins pur qu’un monologue tenu par un personnage. Dans le discours indirect libre, parfois, on ignore qui parle. Même lorsque c’est un personnage qui semble tenir le discours, on ne sait pas si c’est lui qui pense ou une voix sociale, adoptée par les personnages. Il permet d’inclure toutes les voix, de leur donner un écho. Quant au travail de souillure, j’ai été beaucoup marqué par le travail de Kathy Acker, écrivaine queer punk, toute son œuvre vise à reprendre des classiques pour les pirater. C’est le sentiment que j’avais, reprendre un peu Genet, mais pirater ou sampler quelques extraits, créer à partir de sample un univers piraté, de désaxer par exemple des éléments structurels de la tragédie grecque, pour que ça fonctionne avec mon univers.. J’ai besoin de lire pour m’inspirer mais j’ai aussi besoin de me dire que la propriété, notion capitaliste, n’existe pas. La tragédie grecque n’appartient à personne, comme Genet n’appartient pas à Gallimard. Il faut aller dans les classiques, pour qu’ils ne meurent pas, ne soient pas écrasants.
Rodolphe Perez : Oui il y a une perspective de patrimonialisation qui nous vole le texte. Tu t’inscris donc dans une forme hybride, bâtarde, dans cette recherche de l’impureté comme originalité. Et, il y a ce passage singulier, où tu dis, sans doute dans cet effort aussi de démocratisation : « il faut maintenant dire le vrai », c’est toi qui parles, tu coupes la narration. Et tu ajoutes : « je – Kévin Lambert ». Tu brises l’illusion romanesque. Puisque tu recours à la forme théâtrale, j’ai d’emblée pensé au théâtre de Brecht, qui cherche à briser l’illusion et impose en permanence à son spectateur de savoir qu’il regarde un spectacle, de se refuser au divertissement et au romanesque. Tu cherches toi, là, à ce que le lecteur sache qu’il lit, qu’il prenne conscience de la dimension fictionnelle de sa lecture, qu’il y a autre chose qui se joue derrière l’emportement d’une narration linéaire, qui nous déplace.
Mon idée était justement que la narration tienne une position trouble, ou troublante. Qu’elle remette en question ce qu’on a lu pour suggérer au lecteur ou à la lectrice de se révolter contre le texte.
Kevin Lambert : Brecht a été un des premiers à comprendre qu’il y a presque, chez le spectateur, une soumission au spectacle. C’est-à-dire que si on croit trop à la transparence de ce qu’on voit, il peut y avoir une limite politique au geste artistique. Mon idée était justement que la narration tienne une position trouble, ou troublante. Qu’elle remette en question ce qu’on a lu pour suggérer au lecteur ou à la lectrice de se révolter contre le texte. De se dire que l’autorité de la voix narrative n’est pas acquise, pas stable, qu’on peut, en lisant, refuser cette autorité là et la mettre en question. Ce passage nous force à ça. Parfois on n’est pas d’accord avec la voix narrative.
Rodolphe Perez : Absolument, et dans le même temps, comme tu l’évoquais au départ, le texte est certes individuel, solitaire, il navigue malgré toi mais tu décides d’imposer au lecteur une forme de réflexivité. Il y a dans tes textes une dimension politique omniprésente. Il y a une forme de pédagogie dans le texte qui n’est pourtant pas un discours politique à proprement parler, que tu fonds dans la narration, tout en rappelant au lecteur qu’il est en train de lire. D’ailleurs, Querelle est sous-titré « fiction syndicale ». Pourquoi ? Tu voulais d’emblée poser une dialectique politique ? Une position réflexive du lecteur ?
Kevin Lambert : Il y avait ça, et aussi de l’ironie, dans ce sous-titre. Au sens du tremblement, de l’incertitude. Ce n’est pas un texte démonstratif, il ne tient pas une ligne de parti. Il y avait aussi le désir de faire un clin d’œil à une forme d’héritage littéraire, de textes qui sont des fictions syndicales et qui m’ont inspiré comme Germinal par exemple. Il y avait cette envie de marquer un rapport à d’autres textes, une continuité.
Rodolphe Perez : Quand tu dis que dans le discours indirect libre on sent parfois la voix qui ne serait même pas celle du narrateur ou du personnage mais celle de la démocratie, de l’opinion, ça c’est précisément ce que l’on trouve dans une partie de la littérature réaliste du XIXe siècle, au moins en France, avec le poids de l’opinion chez Stendhal, chez Flaubert,… qui va contaminer le personnage. Et nous, on sait qu’on est tellement saturés d’opinions et d’informations qu’effectivement, tes textes informent cela, en témoignent. Est-ce que tu considères à partir de là que la littérature doit forcément être politique ?
Kevin Lambert : Je pense que oui, mais en définissant ce qu’on entend par politique. Je crois que la dimension politique de la littérature réside dans le fait d’approcher des sujets sociaux, d’actualités, tout en ne tranchant pas. Ça serait ça l’élément formel qui permet une littérature politique, il n’y a pas de « bonne » position possible. Je vois ça dans l’idée du texte démocratique comme exploration de différents points de vue, de différentes idéologies. Querelle est vraiment construit comme ça, avec des personnages qui pensent des choses opposées.
Rodolphe Perez : C’est polyphonique.
Kevin Lambert : Oui précisément. Le texte, à mon sens, n’a pas à dire quel personnage a raison et quel personnage a tort. Il présente une situation. L’effet politique sera surtout dans le cheminement de la personne qui va lire après. Parce que ce n’est pas le texte seul qui est politique, mais il le devient dans son rapport à la lecture. De nous placer dans l’incertitude, de nous présenter des éléments de notre société dans un angle différent, en humanisant des personnages, en les mettant en récit… on peut susciter une réflexion politique.
Rodolphe Perez : D’où l’intérêt d’avoir un rapport dialectique au texte et à la lecture, pour dégager un enjeu didactique qui émane malgré lui, malgré le texte. Et malgré toi.
Kevin Lambert : C’est ça. S’il y a du didactisme c’est dans la lecture.
Rodolphe Perez : Oui, non pas dans l’écriture mais dans la polyphonie justement qui permet au lecteur de lui-même faire ce travail didactique.
Kevin Lambert : Oui. Parfois, dans certains discours politiques par rapport à la littérature, on pourrait comprendre qu’il faut que les textes soient plus clairs, donnent des réponses, prennent des positions plus ancrées sur la politique comme elle se pratique. Mais le politique qui m’intéresse m’amène plutôt à défendre la complexité narrative, l’ambivalence et l’ambiguïté. Je trouve que c’est un geste davantage démocratique et anarchiste : je n’en sais pas plus que le lecteur, mais comme lui je sais ce qui ne marche pas, ce qui me révolte. J’ai été un enfant turbulent qui ne supportait pas qu’on me dise quoi penser, et quand on me disait quoi penser, je pensais de fait le contraire. Je trouve que la littérature peut nous éviter de se voir imposer quoi penser.

Rodolphe Perez : Alors il s’agirait davantage d’une littérature qui ouvre les questions de le politique, qu’une littérature qui assène les vérités de la politique.
Kevin Lambert : Oui, c’est ça qui m’intéresse. J’aime beaucoup Despentes par exemple, qui me semble travailler cette veine. Elle prend un enjeu de l’extrême actualité, dans son dernier roman, elle présente le point de vue de trois personnages, sans nous dire qui a tort ou qui a raison. Elle nous montre pourquoi les gens sont ainsi, en humanisant chacune des positions. Puis ensuite, on entre, comme lecteur, dans ce dialogue. C’est une démarche qui m’intéresse.
Rodolphe Perez : Est-ce que c’est pour ça que dans tes textes il y a toujours des personnages, certes, mais surtout un milieu ? Il y a une interdépendance au lieu, qu’il faut détruire ou pas, mais en tout cas un lieu qui fait sens, qui fait écho, où les personnages interagissent. Le lieu est un personnage à part entière, qui détermine les interactions de le politique justement, et du demos entre les personnages eux-mêmes. Demeure un lieu à l’image d’une scène théâtrale.
Kevin Lambert : C’est peut-être la dimension documentaire de mon travail. Même si je suis dans une démarche de fiction, où je raconte des histoires inventées et souvent impossibles d’ailleurs, l’élément de réalisme dans mon travail reste dans la description des milieux. C’est un point important pour moi. Justement, pour travailler sur les discours sociaux, sur les idéologies, j’ai besoin de ces milieux. Les discours et les enjeux humains et politiques ne sont pas les mêmes dans les milieux riches de mon dernier roman que dans la classe ouvrière. Il y a, dans la démarche, un désir de parler de choses vraies, qui passent beaucoup par les lieux oui. Comment donner un souffle mythologique à des lieux qui existent mais sont parfois banals.
Rodolphe Perez : C’est ça. Parce que les lieux occupent vraiment une place. Ils ont la même autorité que le palais des Atrides dans l’imaginaire que tu déploies. On sent cette portée documentaire, comment travailles-tu cela ? Tu te rends sur les lieux ?
Kevin Lambert : J’écris sur des choses que je connais, ou que j’apprends à connaître au fil de l’écriture. Mes deux premiers livres portaient sur la région d’où je viens, je connais aussi des personnes qui ressemblent à mes personnages. J’ai visité une usine, une scierie, j’ai rencontré différents intervenants du milieu forestier. J’aime beaucoup rencontrer des personnes avec des positions sociales différentes. Pour Querelle j’ai rencontré une série d’entrepreneurs, des employés d’usine, des autochtones, des allochtones,… C’est important parce que je ne cherche pas une vérité mais une pluralité de visons sur un même enjeu. Ça me semble fructueux de rencontrer des gens qui ne pensent pas de la même manière. J’ai fait un peu pareil avec le milieu de l’architecture, pour mon dernier roman. J’ai rencontré des architectes, des grosses boites, des plus petites, des professeurs d’architectures, des gens qui débutent leur carrière,… Souvent, j’écris dans les lieux. Pour Querelle, j’ai été écrire à Roberval.
Rodolphe Perez : D’autant que, ce que ces lieux ont de singulier – mais c’est aussi parce que tu es en immersion – c’est qu’ils manifestent l’enfermement, un enfermement qui prend aux tripes les personnages et nourrit leur besoin de transgression, et d’émancipation du lieu. Est-ce que tu considères qu’on est assignés ? Ou alors le lieu est une métaphore de la racine, généalogique ou ontologique. En enfermant, le lieu cristallise la violence instinctive que chaque personnage porte en lui, et s’institue comme scène qui reproduit le huis clos de la tragédie antique, laquelle on le sait est un reflet des passions humaines.
Kevin Lambert : J’ai beaucoup eu ce sentiment d’être enfermé par les lieux d’où je venais. De ne pas avoir ma place, parce que pas hétéro notamment, c’était pas une condition qui existait dans cet endroit. Quand ton droit à l’existence n’existe pas, tu es porté par ce sentiment, d’étouffer. J’en ai beaucoup voulu aux lieux d’où je venais parce qu’il me semblait que c’était la ville entière qui était contre moi, le monde entier, mais mon monde c’était celui-là. Ça m’intéresse comment on peut interpréter justement une forme de fatalité : j’avais parfois l’impression que c’était les rues qui m’en voulaient.
Rodolphe Perez : Parce que tu ne connaissais rien d’autre.
Kevin Lambert : Oui, c’est ça.
Rodolphe Perez : Et finalement, c’est une manière de conjurer ça que de montrer la pluralité des voix qui existent et dont toi tu n’avais pas conscience. Tes personnages découvrent que le monde est beaucoup plus vaste, ils cherchent à transgresser le lieu, au sens de dialectiser, de digérer quelque chose de cet être-au-monde qui enferme, dans sa propre image, dans l’image de la société, et dans les lieux.
Kevin Lambert : Oui, la transgression se situe là. Les personnages, en existant, transgressent. La transgression pour moi serait de dire que les valeurs sur lesquelles tout le monde s’entend ne sont peut-être pas si importantes que ça. Elles sont peut-être mêmes parfois néfastes.
Rodolphe Perez : On retrouve ça dans un usage presque fantaisiste de la mort. Dans Tu aimeras ce que tu as tué par exemple, la question de la morale se pose peu. Le personnage transgresse dans la mort, par le geste de la mort, quelque chose d’une injonction sociale et politique, de la politique. Comment tu as pensé cette légèreté de la mort ? Du geste, notamment de tuer ses enfants, geste très mythologique. Il apparaît dans le roman comme un épiphénomène, qui poursuit le personnage sans vraiment le bouleverser.
Kevin Lambert : J’avais envie que le rapport ne soit pas clair envers la mort des enfants. Je voulais qu’à la lecture on soit à la fois un peu outré, par cette ville qui par son ignorance et ses limites, tue ses enfants, non plus métaphoriquement, ou comme une métaphore qui s’incarne dans le récit : détruire les enfants c’est refuser le futur, le droit à la liberté. J’avais envie toutefois qu’en lisant on prenne presque plaisir à la mort de ces enfants. Une forme de cruauté jouissive, presque cathartique, parce que ça ne serait pas intéressant de dire : voilà la morale, voilà les victimes. Ça serait trop binaire, il n’y aurait pas de tremblement. Finalement, si notre monde tue les enfants, il y a aussi une partie du monde qui est en nous : les choses les plus terribles dans nos sociétés font aussi partie de nous. Tout ça n’est pas à l’extérieur de nous. Ce désir de tuer les enfants, au cœur de la ville de Chicoutimi, est aussi un désir du personnage. Même s’il se révolte et décide de se venger, il n’est pas pur dans ses actions, commet des choses discutables. Je ne voulais pas présenter de manière étanche les bourreaux et les victimes, et pour moi ça passait par une position de lecture ambivalente où on rit mais on souffre, on est libérés par la mort mais aussi animés par la colère.
Rodolphe Perez : Tout en étant très banalisé. Le personnage pousse Croustine, qui meurt. C’est aussi une façon pour le personnage d’empêcher la reproduction de cette ville qu’il a en horreur, tout en reproduisant lui-même un geste de violence qui émane de cette ville. Comme tu le dis, il y a un rapport d’interdépendance, entre la violence du personnage et celle de la ville. La ville nourrit la violence des personnages et la violence des personnages incarne aussi celle de la ville. Est-ce que tu considères que la destruction est essentielle ? Qu’il faut détruire pour manifester un sentiment de révolte et que le tremblement prenne corps ?
En littérature, on peut se permettre de détruire bien des affaires, des valeurs qui ne nous conviennent pas, des idéologies qui nous dérangent, des positions de pouvoirs qui nous révoltent.
Kevin Lambert : Dans la littérature, la destruction est vraiment quelque chose d’intéressant. La destruction pure ça n’existe pas : si tu écris la destruction tu écris quand même. Il y a quelque chose de vraiment inspirant dans cette négativité, ce trou noir. Il produit malgré tout, tout le temps. En littérature, on peut se permettre de détruire bien des affaires, des valeurs qui ne nous conviennent pas, des idéologies qui nous dérangent, des positions de pouvoirs qui nous révoltent. On peut tout faire. Puis, cette destruction ne fera jamais de mal, au contraire, elle produit de la vie, elle amplifie notre liberté, notre regard sur le monde. Moi ça m’a beaucoup porté en tout cas, cette idée de la destruction dans l’écriture, car je trouve que c’est une destruction éthique.
Rodolphe Perez : Elle évite la position autotélique du détruire pour se taire et reconduit le seuil du tremblement. Est-ce que tu as conscience que tu t’inscris dans une tradition de la négativité, ou contre-tradition ? En tant que lecteur, je sens cette continuité, du besoin de silence chez Duras à l’exploration des limites de la mort chez Bataille par exemple, la recherche d’une dialectique, la mort et l’érotisme comme émancipation dans une perte jouissive aussi, qui concourt à la souillure. Genet, aussi, évidemment. Comme tu joues avec l’histoire littéraire.
Kevin Lambert : Pour moi c’est une tradition paradoxale. Comment construire une tradition sur la négativité, sur le rien.
Rodolphe Perez : Oui c’est le paradoxe.
Kevin Lambert : La soustraction manifeste pour moi une forme de tradition sans tradition. Peut-être même d’ailleurs que le modèle de la tradition et de l’héritage linéaire devient caduc avec ces références que tu évoques, parce que l’énergie de leur œuvre ne reproduit pas l’héritage économique et familial de notre société. Je ne suis pas attaché à la tradition ni à l’héritage littéraire comme concepts, je me sens plus dans une relation très libre aux références. Finalement, c’est des connivences, des amitiés littéraires que je tisse avec des textes que je lis, où je me rends compte que des artistes ont questionné des affects dont je me sens proche. Ont approché des vides ou des trous qui me questionnent.
Rodolphe Perez : C’est prégnant notamment dans le rapport aux figures d’autorité pour toi en tant qu’écrivain mais également aux manifestement de l’autorité au sein du texte. Si elles sont là, elles sont d’emblée niées par les personnages. D’ailleurs, Tu aimeras ce que tu as tué s’ouvre sur « l’autorité fêlée » de la professeure. Les personnages ont d’emblée conscience que quelque chose dysfonctionne. Et c’est dans cette brèche, cette faille postulée qu’ils vont jouir de leur capacité de révolte et de violence. Poser l’écriture comme un geste où l’autorité n’existe pas, au sens d’un écran, d’une morale ou d’un poids, ouvre des perspectives très riches.
Kevin Lambert : L’autorité est un mot envers lequel je suis ambivalent parce que l’existence du mot peut nous faire croire que l’autorité existe, ou qu’elle est légitime. Mais en regardant des gens en position d’autorité on peut rapidement se rendre compte que ça ne repose sur rien. Ils sont grotesques. C’est arbitraire. Je trouve que les fondements de l’autorité sont toujours clownesques.
Rodolphe Perez : Oui c’est ce que dit Pascal justement la dimension arbitraire, partiale.
Kevin Lambert : C’est ça. Souvent dans son exercice, sa mise en scène, l’autorité présente sa dimension clownesque, sans le savoir. Quoi de plus absurde qu’une parade présidentielle ? Une cérémonie gouvernementale ? Moi dans ces contextes, je ne sais pas jouer le jeu. L’autorité est juste un costume, dès qu’on voit un peu on se rend compte que la perruque tient mal, que la moustache se décolle.
Rodolphe Perez : On revient à cette dimension brechtienne d’un regard réflexif. Le réel a une dimension romanesque, la cérémonie est une fiction. On sent dans tes personnages ce côté, qui me fait évidemment penser au théâtre de Genet, des rôles caricaturaux, des jeux sur le costume, et un geste de démystification par des personnages qui s’en moquent.
Kevin Lambert : Oui c’est Le Balcon, qui raconte ça.
Rodolphe Perez : Complètement. Puis Querelle débarque et démasque le ridicule du monde, mais même lui, puissance en soi, avec un corps architectural, qui en impose, finit par être dialectisé. Rien ne tient. Rien n’incarne totalement, car tout est réversible, peut être négativisé.
Kevin Lambert : C’est ça. Querelle est un fantasme. Un écran sur lequel tout le monde fantasme des désirs. Les humains fonctionnent comme ça. Les rôles sociaux aussi. On projette sur les autres. On projette sur Querelle le sur-homme ultra viril baiseur suprême, ou un élément de discorde sociale, possible tueur. Mais il n’est ni l’un ni l’autre finalement, il est juste la somme de ces écrans.
Rodolphe Perez : Justement, concernant ton dernier texte, qui vient de paraître au Canada mais n’est pas encore sorti en France, j’ai lu un entretien du journal Le Soleil, où tu dis : « J’ai essayé de capter cette nouvelle ville dans laquelle j’habitais et comment elle est structurée par le pouvoir. » On revient à cette question de la ville, du lieu. Et cette fois c’est un lieu qui s’élève. Pourquoi as-tu voulu te confronter à l’architecture ?
Kevin Lambert : L’architecture pose la question de la construction et du corollaire de toute construction, plus que n’importe quel autre art puisque les impacts sociaux qu’elle pose sont ultra concrets : combien de familles seront impactées par des hausses de loyer, combien de foyer on doit raser, quelle forme de gentrification cela aura ? Pour moi, c’est un peu fascinant ces arts qui sont aussi des industries, qui sont dépendants du pouvoir, qui sont à la fois très inspirants, c’est beau l’architecture, ça enchante, et change notre manière de vivre l’espace.
Rodolphe Perez : Parce que c’est aussi l’art qui représente le plus l’imposition du pouvoir, qui manifeste le plus l’érection du pouvoir.
Kevin Lambert : Oui, et on construit toujours sur quelque chose d’autre. La construction cache toujours un cadavre.
Rodolphe Perez : Alors est-il aussi question de destruction dans ce roman ?
Kevin Lambert : De manière très différente, c’est plutôt l’histoire d’une construction contestée. Un personnage a envie de bâtir, pense, en bâtissant, faire le bien, mais pour la première fois de sa vie a un grand projet publique à Montréal, qui va être remis en question par des groupes militants, par des spécialistes,… les gens privilégiés ont construit leur position, ils ont bâti un escalier en haut duquel ils se sont placés. Ma question serait : est-il possible, pour qui s’est construit un escalier et est sur la dernière marche, de défaire cet escalier. J’ai pas la réponse, mais ça m’intéresse de poser la question : on remet en question les privilèges, à raison, mais je voulais me demander comment cela est vécu du point de vue des privilégiés. Quelles sont les limites de la remise en question de ses propres privilèges.
Rodolphe Perez : Une autre manière d’interroger le rapport de classe, et comment la démocratie peut s’emparer de sujets qui la concernent mais dont elle est dépossédée.
Kevin Lambert : Oui, et de savoir comment un individu peut porter le poids d’une structure sociale. L’architecte, dans mon texte, devient un peu le bouc émissaire. Elle est très critiquée, il y a des impacts concrets à sa construction qu’il faut dénoncer mais en même temps est-ce elle comme individu qui porte le poids du capitalisme et de la gentrification ? Ça serait lui accorder beaucoup de pouvoirs. Je ne pense pas qu’un individu puisse incarner tout ça dans sa chair. Cette ambivalence, dans la réflexion militante comme dans l’action politique, de figures qui cristallisent nos idées et se font repoussoir. Malgré tout il y a une subjectivité humaine sous ces idées qui ne peut pas coller parfaitement à ce qu’on projette sur elle.
Rodolphe Perez : C’est mettre en lumière la difficulté à faire coïncider tous les êtres en soi et dans ce rapport social toujours pervers. Car le vice est aussi dans le regard que les gens portent, sur l’architecte comme sur Querelle. Il y a quelque chose d’une injonction à être, et qui renvoie à ce que tu disais sur le milieu comme loi et étouffement. Tu reproduis, d’une autre manière, comment un personnage, a priori mauvais, malgré tout garde une part d’humanité parce que le mal est diffus. Le mal indéfini et impalpable. Le condamnable est partout.
Kevin Lambert : C’est une idée qui m’a beaucoup aidé, une espèce de commune abjection des humains. Même si on critique quelqu’un ou qu’on dénonce des privilèges ça ne signifie pas qu’on est supérieur à la personne qu’on critique, ça veut dire qu’on est dans une forme de radicale égalité avec cette personne, et d’interdépendance. Je voulais trouver comment formuler une critique sociale sur un personnage sans placer la narration dans un rôle de supériorité morale par rapport à ce personnage justement. C’aurait été une faiblesse littéraire pour moi de simplement juger et montrer comment elle était de droite, ou stupide, de la caricaturer. Je veux montrer la tension humaine. Elle demeure un être humain complexe et intéressant et je peux critiquer ses privilèges sans binariser. C’est cela que doit montrer la littérature pour moi.
Crédit photo : (c) Julia Marois
- Kevin Lambert, Que notre joie demeure, Nouvel Attila, 18/08/2023.
Un article par Rodolphe Perez 18 août 2023.

















