Belle conclusion à une belle trilogie que Clapotille. Initié dans l’ombre des traumatismes infligés par les parents, poursuivi par l’amour, l’itinéraire du narrateur s’achève avec une paternité tout aussi onirique et diffractée par les mots et la folie que le furent ses précédentes aventures.
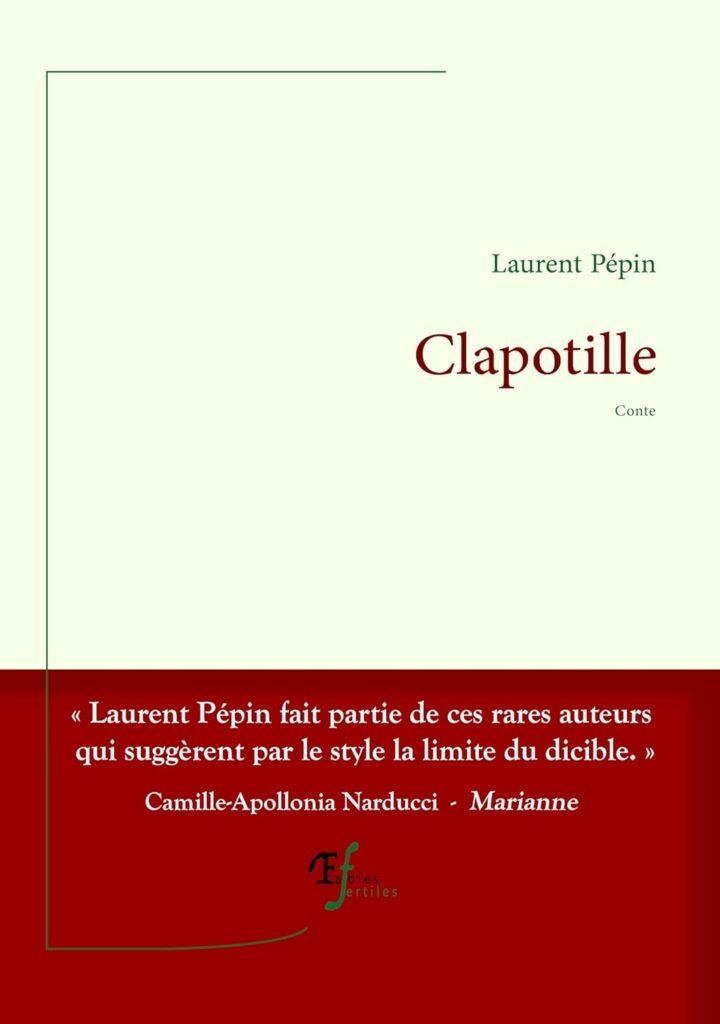
Le conte s’ouvre lorsque le narrateur met au monde, en terminant de la dessiner, Clapotille, l’enfant mort-né de sa compagne décédée, qui vivait jusque-là dans les limbes — avec un compagnon sur lequel nous reviendrons. En achevant ce dessin, il permet à Clapotille de venir au monde. Puis il l’élève douze ans durant et, s’il est indéniable qu’il l’aima, il l’aima comme il avait aimé la mère de l’enfant ou la compagne qui l’avait précédée : à l’image d’un parasite qui, blessé et marqué à mort par ses traumatismes, ne peut plus agir qu’en trou noir et qui, inéluctablement, tragiquement, aspire et épuise l’âme des êtres lumineux qui lui est donné de côtoyer.
Car ces contes joignent à l’émerveillement des mots et des images une noirceur profonde, la fatalité des traumatismes infantiles. Certes — et on renverra le lecteur à l’ensemble de la trilogie — le narrateur a subi les sévices les plus vils que l’on puisse infliger à un enfant. On pourrait croire que la psychologie puis la poésie lui permettraient de, comme on dit, « s’en sortir ». Après tout, Camus ne disait-il pas lui-même qu’on écrivait pour sauver sa peau ?
Le rêve comme refuge du langage humain
Mais le narrateur ne se sauve nullement, et ne fait que retarder l’échéance. Il n’arrive pas à élever Clapotille, et sent avec l’éveil à l’amour de cette dernière qu’il voudra la posséder, qu’il laissera ses vieux démons, ses monstres le posséder, le pousser à lui faire du mal. Alors il fuit, fréquente les bars à rêves dans lesquels les rêveurs se dissimulent pour vaquer à leurs dérives nocturnes, dans ce monde qui a banni tout onirisme, en ce qu’il ne tolère plus aucun décalage avec la réalité.
« Le rêve, la littérature, la musique, les arts, les phénomènes météorologiques susceptibles d’éveiller l’émerveillement étaient considérés comme des délits qui mettaient en danger la santé publique.
Il fallait reconnaître que nous étions tant de Rêveurs brisés par le monde que la communication pouvait régulièrement se trouver coupée entre les individus, chacun traduisant la langue selon ses paysages engloutis ou le corps de ses femmes disparues. »
On ne peut ici ne point songer à Orwell, qui nous a appris que toute novlangue, c’est-à-dire tout langage qui se fixe pour objectif d’asservir en diminuant, cherchera à créer un langage univoque. Or l’humain mâtine, patine sa perception du monde en y mêlant son irréductible singularité : ce faisant, il rend équivoque toute expression. Ainsi « chaque Rêveur, même brisé, [a] le pouvoir de troubler le sens formel des mots et de l’illustrer dans les expressions de son visage ». C’est ce qu’exprime à l’extrême l’ “expérience limite” de la folie du narrateur : ce dernier crée un monde imaginaire par la manière qu’il a de regarder le monde qui existe.

















