« Où étions-nous avant d’être ici ? » C’est par cette question existentielle que débute le dernier ouvrage de Marie Modiano, L’Île intérieure, véritable voyage poétique et onirique sur l’île de Capri, cette « petite île » dont parlait Félicien Marceau, lieu chargé d’histoire et de culture, propice à la rêverie et où l’on peut encore croiser les mânes de Tibère, Jacques d’Adelswärd-Fersen et Curzio Malaparte entre les murs des villas Lysis ou San Michele.L’Île intérieure est l’histoire de la fuite d’un couple de musiciens, désignés sous les initiales M et P où l’on reconnaît Marie Modiano et son compagnon, le musicien Peter von Poehl, dont on ne sait d’où ils viennent, ni ce qu’ils fuient. Ils débarquent presque par hasard sur l’île de Capri où ils apprennent, par l’entremise d’esprits, qu’ils doivent donner le soir même un spectacle dont ils ne savent rien. Voyage intérieur, odyssée mentale en solitaire à la recherche de soi, ponctué de poèmes et de chants, le roman de Marie Modiano conduit, dans la lignée d’un Maeterlinck, le lecteur à se perdre avec délices dans les méandres de la psyché le temps d’un songe d’une nuit d’été méridionale, solaire et azuréenne.
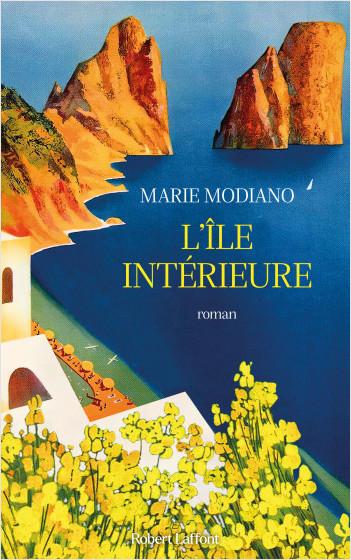
Guillaume Narguet : Votre ouvrage est-il une traduction, sous forme de rêverie poétique, d’instants de vie que vous avez passés à Capri, comme un long carnet de notes dans un style qui ne serait plus neutre, pour reprendre vos termes, mais au contraire personnel, subjectif ?
Marie Modiano : Mon Capri, si j’ose dire, est onirique et imaginaire. J’y ai passé très peu de temps et j’ai eu l’opportunité d’y donner un spectacle dans le cadre d’un festival pendant une semaine. C’est quand je suis rentrée à Paris que je me suis rendu compte que s’était développée en moi, telle une plante qui a pris racine et qui pousse et se déploie, la vision d’un Capri fantasmé que j’ai retranscrite dans le livre sous forme de rêverie. C’est presque un prétexte qui me sert à évoquer des souvenirs et des moments de vie, d’en inventer d’autres et de me perdre dans un rêve infini.
G.N : L’Île intérieure est présentée comme un roman mais l’ouvrage convoque plusieurs genres dans une construction singulière : le poème, le journal, le chant. Cela en fait une œuvre qu’on pourrait qualifier de polyphonique.
M.M : Tout à fait, même si ce n’était pas l’effet recherché au départ. Quand on commence à écrire, on tâtonne, on ne sait pas exactement vers quoi l’on se dirige ; puis, au fur et à mesure de l’écriture, je me suis sentie plus libre de recourir à des genres divers. Avant d’être romancière, je suis musicienne et poète, puisque j’ai commencé par composer des poèmes, et cette variété de styles et de moyens d’expression s’est déclarée presque malgré moi pour se retrouver dans le livre, comme si j’étais emportée par un flot ou un flow intérieur. Je pense qu’il s’agit de mon roman le plus libre. Il n’y avait plus de digues ni de frontières, je naviguais sur une mer avec l’horizon à perte de vue.
G.N : « J’ignore encore comment s’achèvera l’histoire que je suis en train d’écrire. » Vous avez écrit au fil de l’eau ou du rêve ?
Quand on prend conscience d’être « poussé » par l’inspiration, tout devient plus facile.
M.M : En effet. Chacun a une manière différente d’écrire ; certains ont un plan et savent dès le départ quel est l’objectif qu’ils souhaitent atteindre. Ce n’était pas mon cas : au fur et à mesure que je parcourais le long trajet de l’écriture, comme si j’étais dans un train ou un bateau, je me laissais prendre et entraîner. Quand on prend conscience d’être « poussé » par l’inspiration, tout devient plus facile.
G.N : C’est un roman musical dont les chapitres sont des chants ; il est rythmé par des paroles de chansons (In the Death Car, Alors on danse…), ainsi que par des poèmes, qui introduisent chaque chant et qui les scandent parfois. Le livre est d’ailleurs suivi de la parution d’un album, Capri. Ballad of the Spirits (sortie fin août). Comment avez-vous pensé la complémentarité entre ces deux œuvres ? Les chansons doivent-elles accompagner la lecture ?
M.M : J’avais, en prévision du festival que j’ai évoqué, composé des poèmes et autres textes que Peter [von Poehl] et moi interprétions en italien sur les conseils du directeur artistique. Puis j’ai commencé à rédiger ce livre et, bien qu’il s’agisse de deux projets indépendants et parallèles, le roman et l’album ont de nombreux points communs : l’inspiration, l’atmosphère surréelle, les aspects mystérieux de Capri… Le roman cristallise beaucoup de choses personnelles, comme un aimant qui attirerait tous mes souvenirs. Ils peuvent se rencontrer et j’espère qu’ils le feront aussi dans le cadre de spectacles à venir. Mais ils vivront quand même indépendamment l’un de l’autre.
G.N : L’organisation en seize chants est-elle une façon d’établir un lien avec la mythologie (on pense à l’Iliade et l’Odyssée et l’Île intérieure est une sorte d’odyssée onirique à la recherche de soi-même) ? Certains éléments y font penser, comme la sirène que P aperçoit.
M.M : Bien sûr, des correspondances s’établissent de manière presque inévitable. Chacun d’entre nous, du moins en Occident, est habité par cette littérature fondatrice. Dans ces paysages méditerranéens, je retrouve forcément, même à mon corps défendant, quelque chose qui porte l’empreinte des récits et des chants de l’Odyssée et de cette quête qui est avant tout intérieure.
G.N : Capri serait presque un personnage du roman à part entière, marqué par la dualité : envoûtante et inquiétante, propice au rêve et mystère (« terre mystérieuse [où] les colonnes de marbre […] murmurent des secrets du temps passé ») et en même temps ancrée dans la réalité, avec des « rochers qui sont là pour l’éternité », idyllique (c’est un paradis dont on se tatoue le nom sur la peau) mais aussi infernal, peut-être un nouvel Hadès (« les esprits tournent en rond, prisonniers de Capri qui les a recueillis un jour »). Est-ce cet aspect ambivalent qui vous a attirée sur cette île et qui provoque justement ce brouillage entre rêve et réalité ?
M.M : C’est exactement cela, cette dualité des émotions et sentiments qu’on ressent sur cette île et en laquelle je me reconnaîtrais presque. Je suis quelqu’un d’assez solaire et sociable et, en même temps, je suis habitée par des sentiments plus sombres et violents. C’est comme si ces paysages envoûtants étaient une représentation physique de ce que nous sommes réellement. Je trouve intéressant qu’on puisse se reconnaître dans des paysages ou des ambiances qui suscitent des réminiscences.
G.N : Ce brouillage se retrouve dans la narration même, où la rêverie, « quand on [lui] laisse suffisamment de place, imprègne le quotidien, se déploie, s’étale et finit par prendre toute la place qu’on veut bien lui donner. » Le rêve aurait donc pris tout l’espace du roman, de l’île intérieure, « paysage sans fin de la mémoire ».
M.M : À partir d’un certain âge, et en creusant le plus possible, on peut vivre plusieurs vies rien que par les souvenirs et les émotions qui nous constituent. Plonger trop loin peut certes représenter un danger, celui de se détacher du présent et de la vie. Mais en même temps, il est important d’accepter ses paysages pour se connaître soi-même.
G.N : Le couple de musiciens se rend à Capri depuis Naples. Tout semble opposer les deux endroits : Naples est une métropole où « les gens parlent fort, crient, gesticulent », qui crache par navettes successives des hordes de touristes que les Capriotes qualifient de cafards, alors que l’île est calme, mystérieuse et magique, à la nature préservée et sauvage. Et surtout, chez les Napolitains transpire « la peur de disparaître, d’être engloutis par l’obscurité d’un temps passé ». N’est-ce pas cela qui caractérise Capri justement ? l’engloutissement dans un temps passé où les seuls habitants sont les esprits ?
M.M : Oui, quand les rues de Capri deviennent calmes, après le brouhaha des touristes, on perçoit une ambiance irréelle, qui plane. Tout ce qui a habité l’île depuis des siècles se ressent, même si l’on se trouve à un endroit vide de toute vie et de toute animation, hormis la nature. C’est assez fort pour la personne qui veut bien entendre tout cela et qui est dans une disposition d’esprit capable de lui faire accepter cette présence invisible et pourtant chargée d’histoire et de culture. Je pense que ce magnétisme a marqué de nombreux artistes, ce qui peut expliquer l’intérêt que Capri représente pour eux et qui serait la raison pour laquelle ils sont été si nombreux à s’y installer, même provisoirement.
G.N : Capri est en effet une terre d’exil qui a « recueilli » des personnages comme l’empereur Tibère ou l’écrivain Jacques d’Adelswärd-Fersen, qui apparaissent dans le livre sous forme de fantômes. Qui dit exil dit également introspection : quand on s’exile, on a le temps de penser à soi, son passé, ses éventuelles erreurs pour en tirer des leçons. C’est ce que fait aussi la narratrice qui serait, dans ce cas, elle aussi exilée (de la civilisation, de la vie…).
Tous ces personnages sont des oiseaux voletant dans une cage dont ils ne peuvent pas s’échapper.
M.M : En effet et un des chants du roman évoque le souhait de partir, de larguer les amarres. L’île est pour M un refuge et représente aussi quelque chose d’hostile, même si la fin relève plutôt de l’ordre du tragi-comique. Elle est happée et se retrouve dans une sorte de prison dont elle ne pourrait plus s’échapper. On retrouve une dualité liberté-prison et la tentation de la fuite et de l’exil pour se retrouver. Et tous ces fantômes habitant l’île (en général des artistes comme Ada Negri, Caruso, Malaparte, Edmonia Lewis…) se remémorent les siècles passés, comme s’ils étaient des échos de la propre vie de M. Tous ces personnages sont des oiseaux voletant dans une cage dont ils ne peuvent pas s’échapper. Et la narratrice est elle aussi prisonnière de ces bribes de souvenirs qui reviennent en boucle.
G.N : Cet exil est le résultat d’une fuite dans un songe : le couple n’a plus d’identité ni de bagages, comme s’ils étaient en transit perpétuel, ne s’établissant nulle part. Il fuit le temps tout en essayant de le capturer, de l’arrêter, « de conjurer le sort » par le processus de l’écriture : « [je couchais] sur le papier toutes mes heures et [espérais] ainsi les cadenasser. » Peut-on dire que l’écriture est le seul moyen d’avoir prise sur le temps en retranscrivant ses souvenirs et en permettant la connaissance de soi ?
M.M : J’ai souvent à l’esprit l’image d’une barque trouée qui prend l’eau ; l’écriture, pour moi, représente un moyen de sauvetage qui aide à ne pas se noyer et à vider cette eau, à se débarrasser du trop-plein de soi-même. En cadenassant les trop nombreux souvenirs, on évite qu’ils ne coulent la barque.
G.N : Tout exilé rêve de recouvrer la liberté. Or, pour Marie, elle est inatteignable, « porte le visage de l’incertitude », génère des « angoisses métaphysiques », n’est qu’une « promesse ». Elle est même dangereuse et « vous ligotera avec ses tentacules gigantesques » si l’on rêve trop à elle. Vous écrivez ainsi qu’entre M et la liberté, qu’elle ne peut saisir mais dans les bras de laquelle elle s’est retrouvée prisonnière, « il y aura toujours la vie ». Vie et liberté seraient incompatibles ?
M.M : M et P ont fui, ils sont libres mais ils sont comme prisonniers d’eux-mêmes, de leurs souvenirs. La vie comporte de nombreux freins à la liberté et j’ai voulu imaginer dans ce roman un couple qui aurait toute la liberté possible et qui se rendrait compte que cela ne signifie finalement rien. Ce sont ces freins-là justement qui constituent la vraie liberté, car nous ne serions rien si l’on était détachés de toute obligation, de toute contrainte, de tout être humain, et par conséquent de la vie elle-même. La liberté pure n’existe de toute façon pas et elle ne serait pas très enviable. On est forcément attachés à quelqu’un ou quelque chose et c’est cela qui forme les liens entre les êtres, les passions qui nous définissent. J’ai voulu décrire une liberté-prison.
G.N : Parmi les fantômes, il y en a un qui se singularise mais qui n’apparaît que dans une lettre que M lui adresse : c’est le premier amour qu’elle a connu à seize ans, un Américain rencontré à Paris, qui a mis fin à ses jours et que vous évoquiez déjà dans Lointain. Amour tourmenté par rapport à celui, paisible et lumineux, qu’elle vit avec P. L’Île intérieure est peut-être aussi la traduction de ce dialogue intérieur à sens unique où « pas un jour ne passe [depuis vingt-cinq ans] sans que M pense à [lui], sans [l’]apercevoir quelque part », de la recherche du disparu.
M.M : J’aime l’idée que tout est brouillé entre passé, fantômes, mort, vie… et c’est pour cela que je montre que le dialogue avec les morts et les disparus est encore possible. Il est traité sur un mode plutôt comique dans le livre avec le personnage de Malaparte ou plus poétique avec les poèmes qu’Ada Negri récite. Je suis séduite par cette idée d’un passé éternel qui communique avec le présent.
Pour élaborer ces personnages, je me suis fondée sur ce que je savais d’eux. Par exemple, je savais que Malaparte avait beaucoup d’humour et qu’il était très proche de son chien, je me suis servie de ces éléments historiquement vrais. Mais en tant que romancière, je me suis laissé aller à imaginer des situations tout à fait inventées et absurdes, sorties de mon esprit, ce que j’ai trouvé très agréable. C’était une récréation de l’imagination et il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un roman, donc je ne cherchais pas non plus l’exactitude historique.
G.N : Le roman engage aussi une réflexion sur le couple : « Il est étonnant de se dire qu’on peut passer toute une vie à marcher à côté de quelqu’un en parlant, en silence. […] La confiance que l’on place dans un autre personne comporte toujours une part de risque. »
M.M : C’est l’incertitude des choses qui est belle justement, que cela concerne l’amour, l’art, l’amitié. On n’a jamais de certitude ; même le plus grand des amours, en l’occurrence celui de ce couple qui s’aime, qui travaille ensemble, qui part en tournée, n’est sûr de rien et à raison ici, car tout s’écroule.
G.N : « Nos îles intérieures nous condamnent à la solitude » ; le roman est celui justement de la solitude, parmi les esprits à Capri ou parmi les hommes en Suède, où M se sent différente, presque exclue. C’est un thème romantique par excellence mais qui semble plus d’actualité que jamais de nos jours, où malgré la multitude des réseaux dits sociaux, les gens se sentent seuls. La solitude est-il un mal moderne ? Ou la recherche-t-on car elle est bénéfique ?
M.M : Je l’ai tout le temps recherchée, même enfant, car cela correspond à mon caractère. Mais elle n’est formidable que si on la choisit, quand on s’extrait de notre environnement pour lire, écrire, rêver etc. Une solitude imposée est beaucoup plus difficile à vivre. A une période de ma vie, je me suis retrouvée seule et j’ai vraiment senti et supporté ce poids sur mes épaules. Mais il est vrai que notre époque me surprend : je vois les gens, surtout les jeunes, sur leur téléphone, qui naviguent sur les réseaux sociaux, qui ne se voient plus car ils privilégient les messages, et je me demande où tout cela va nous mener. Ne plus avoir, semble-t-il, besoin de contacts humains est édifiant. Il faut être optimiste, il y aura des contrecoups car, malgré tout, on a toujours besoin les uns des autres. Mais en effet, les solitudes sont plus importantes et omniprésentes de nos jours.
G.N : Vous faites des références explicites à Shakespeare (le Songe d’une nuit d’été), à Schnitzler, à Maeterlinck ; ce dernier écrit d’ailleurs dans la Culture des songes : « Le cerveau libéré par le sommeil, au cours de ses pérégrinations dans l’éternel présent qui est le temps réel, y rencontre autant d’avenir que de passé. Il les confond. » Cela entre en résonnance avec l’Île intérieure et le brouillage des repères, tant temporels que géographiques, de M. Dans quelle mesure ces œuvres vous ont inspirée ?
M.M : Tous les livres qui ont compté pour moi et qui m’accompagnent font partie de mes paysages intérieurs. Je pense que la lecture rend plus vaste, elle permet de voyager dans le monde et de rencontrer qui on veut. Il faut avoir la force d’entrer en soi pour découvrir des choses insoupçonnées.
G.N : On peut penser à d’autres œuvres, par exemple Colline de Giono : « Nous serions un couple perdu sur une île mythique. Vagabonds ayant tout quitté, errant sous la pleine lune, à travers des collines mystérieuses » ; l’Ile fantôme de Washington Irving, récit d’un jeune homme qui se rend sur une île légendaire, où il semble attendu, et qui, après une fête donnée en son honneur, se retrouve seul et perdu en mer. Il est recueilli des décennies plus tard, alors qu’il lui semble que quelques jours seulement se sont écoulés. Ou enfin Œdipe sur la route d’Henry Bauchau, qui relate le voyage d’Œdipe à Colone, voyage intérieur à la recherche de la connaissance de soi et de son destin, en convoquant le rêve, la danse, le chant comme moyens pour lui de se libérer. Il finira par disparaître dans le chemin du soleil et c’est sur l’évocation du soleil justement que s’achève votre ouvrage : « les levers de soleil ont enfin un sens ».
M.M : Ce sont des références intéressantes, et en effet, on peut y retrouver des thèmes communs. Je convoque aussi la danse et le chant puisque le couple de musiciens est censé donner un spectacle aux fantômes, mais aura-t-il bien lieu ? Concernant ma conclusion, j’ai voulu finir sur cette note d’espoir : l’île intérieure n’est pas condamnée. On la construit, on la façonne comme on veut et il n’y a rien d’irréversible.
- Marie Modiano, L’Île intérieure, Robert Laffont, mai 2024.

















