
au poète du bord-dedans – année 0
Lentement mais sûrement – souhaitons-nous le du moins – l’oeuvre de Thierry Metz essaime, sort du bois, et trouve sa reconnaissance. Il y a, certes, le connu et sublime Journal d’un manœuvre, en poche, mais il y a aussi et surtout sa poésie, notamment publié chez Pierre Mainard. Zone Critique s’empare aujourd’hui de la dernière actualité, le beau recueil terre, paru à l’automne, avec les délicates peintures de Véronique Gentil. Et s’il est de plus en plus fréquent de trouver ces épiphanies du texte et de l’image, l’affaire est plus prégnante encore chez Metz, poète de la matière : texte à lire, à entendre, comme à voir.
Ce qui demeure
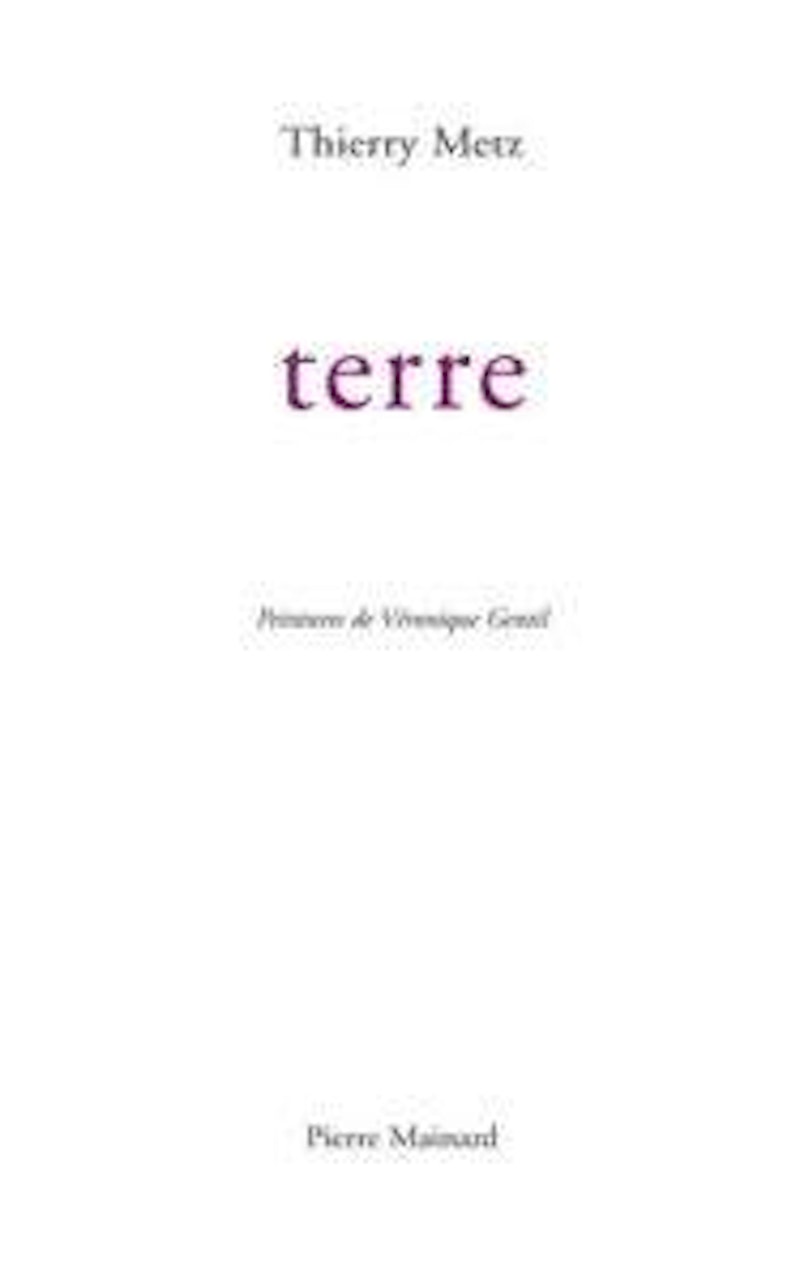
« Il n’y a que des pas. Des pas derrière moi.
En reste. »
Et plus loin :
« Je ne vis qu’en ce que j’ai à écrire. Ou, différé par mon silence : habiter. Là où je ne resterai pas.
Quelques pas hors de moi. »
L’écriture ne se fait jamais fuite mais issue. Issue au bord du mourir, d’un mourir qui s’assume et ne se détourne pas, c’est Orphée qui garde les yeux grands ouverts et retient les morts à l’intérieur de lui. Alors la parole poétique le dépasse, ouvre la voix.voie à une éthique de la perte de soi, d’un soi dépassé par l’écriture elle-même.
L’écriture ne se fait jamais fuite mais issue. Issue au bord du mourir, d’un mourir qui s’assume et ne se détourne pas, c’est Orphée qui garde les yeux grands ouverts et retient les morts à l’intérieur de lui
« J’entre dans la nuit enfin délivré. Dans la nuit, dans le recommencement.
Difficile de dire où l’on est.
Dans cette langue. Hors du feu.
Aussi je n’allume pas. Mais comme un potier, j’aperçois l’intérieur du four, son rougeoiement. Je m’endors comme du levain. »
D’ailleurs, le lent étiolement de la langue et de la typographie à mesure qu’avance le recueil vient en témoigner, dans une forme de renoncement : assumer la fatalité d’être vivant et se perdre dans le désir de faire matière, s’abandonner dans l’âtre de l’histoire, au seuil d’une mémoire palpable et d’un devenir-matière. Car si la poésie devient palpable, si la poésie prend forme comme vivant, comme chair, c’est qu’elle s’empare progressivement du poète, qu’elle agit comme une immanence en lui. L’écriture de Metz semble se situer sur cet instant d’une perte de soi, fondu dans la poésie elle-même.
« Le ciel est dur sous ma main. Je devrais me lever mais je reste encore un instant. La pluie ne m’a jamais courbé. » Une écriture de l’instant donc qui déleste lentement le poète de sa propre présence. « Et seul, me consumer », écrit Metz. Le poète fondu, excédé par la parole poétique – là où l’hypersubjectivité se dépasse pour ouvrir à la multitude. Et ne rien s’épargner :
« Vie que j’ai durcie dans le feu
dans mes mains
dans d’autres mains »
Aussi le recueil se dirige-t-il progressivement vers une poésie de l’évocation, de l’effleurement – où l’intuition d’une présence sert d’appui au développement d’une poésie immanente, comme si le poète se sacrifiait lui-même à l’écriture.
« Langage de qui passe
émondé
dessous
pour entrer dans l’eau
ou s’asseoir
pour me montrer de ses mains
à vif
un visage aimé.
Bâtir le toit
de cet instant
s’obstiner jusqu’au ciel »
Ce qui se perd
Écrire, c’est oeuvrer à un geste de l��’impersonnalisation, au point ultime d’une déroute de soi-même dans l’écriture sur quoi émerge l’issue – « il se peut qu’on s’évade en passant par le toit », écrit Genet – et creuser jusqu’à un ciel inversé.
« Confiant jusque là-haut
où j’aurais prise
entre mon silence
et mon cri
j’entraîne mes pas.
Dans une demeure que je n’attendais pas, si frêle
où ma voix
comme une torche
s’éteint.
Ne s’entend plus
que sur un bûcher. »
Écrire, c’est maintenir alerte la parole où s’époumone et s’épuise – sens fort du verbe – la langue pour une authenticité du langage poétique lui-même
Écrire, c’est maintenir alerte la parole où s’époumone et s’épuise – sens fort du verbe – la langue pour une authenticité du langage poétique lui-même. Garder jusqu’à l’image de soi dans le brasier, au seuil de se disperser tout à fait.
« Savoir allumer un feu qui ne néglige rien, qui nous laisse nus dans nos âmes.
Voix frottées
qui s’ouvrent à chaque porte
j’ai recours à ce geste qui n’est que gravité.
L’enclume entrouverte.
Qui saigne comme un oiseau.
L’enclume déplacée
par mes mains. »
Car le poète est bien celui qui déchire de ses mains la matière du silence et de l’invisible pour éclater de la parole renversée dans l’espace d’un devenir :
« Ici comme un seuil.
Mais dans ce ciel je suis pris de colère.
De n’avoir plus que des gestes
entre moi et l’instant. »
Alors toujours faire l’épreuve de son propre silence. Car le sacrifié – le poète ou le prophète d’Agamben – ne peut que constater son isolement, dans la mesure où s’il habite le monde ce n’est que pour mieux en éprouver l’entière solitude, s’y perdre d’une expérience de soi, quand bien même il serait entouré, quand bien même aimé :
« Et dès que je suis seul
comme ici
je m’étoile.
Je couve.
Je découvre une voix qui n’a pas dormi.
Est-ce une voix de pure perte ?
Un autre pas vers rien ?
Si le souci d’y tenir m’affolait je ne resterais pas. Je dormirais dans le foin. Je trouverais ma nuit dans le coquelicot. Ma litière.
Non.
J’écris pour recommencer. »
Ce qui marque
Car le paradoxe – ou l’éternelle dialectique de la poésie – serait toujours la nécessité d’une rencontre, d’une miscibilité de l’autre qui nous renvoie, dans la nudité de l’acmé, à notre propre présence-matière, la matière du palpable comme preuve exaspérante et de ma finitude et de ma solitude, là où la perte de soi dans une déchirure ne peuvent être que des épiphanies sans quoi il serait impossible de témoigner. Mais l’instant de la présence, photographie toujours rejouée, est celui qui m’appelle à l’autre, là où l’extrême preuve de la présence de soi trouve sa réponse dans un abandon à l’autre, comme le palpable n’est matière que dans l’instant même du choc, de la rencontre, du toucher :
« repu de séparation
le regard
ne s’éloignait plus »
Voilà bien qu’il faudrait lire et toujours lire à haute voix, ce repu de séparation, répétant lui-même sa propre solitude de banni du mot, exclu par la langue elle-même, re-pu de qui sait par où s’évader, où creuser la matière du mot-regard, d’un œil étourdissant de la rencontre, choc et punctum, geste encore dépassé de soi-même, du regard qui happe , du regard où s’étourdir encore d’un oubli de soi : l’issue n’est plus la fuite, n’est plus l’éloignement mais l’éternité d’une présence et d’une rencontre, l’imprésence continue qui demeure, la trace : être là où la trace nous demeure.
« Où n’être que solitaire ? Où se retrouver quand tout aura brûlé dans nos paroles ?
Non, je ne sors pas d’ici. D’être et d’écrire D’un silence dans les ronces. »
Car le poète est l’architecture, celui qui consolide et cimente le lieu de la présence, qui y revient et s’y enfouit, dans l’érection inconséquente de la poésie elle-même :
Car le poète est l’architecture, celui qui consolide et cimente le lieu de la présence, qui y revient et s’y enfouit, dans l’érection inconséquente de la poésie elle-même
« J’ai vécu en maçon dans ma langue.
Dans l’âpreté de l’instant, j’étais dans la tige. »
Et puis loin, où soi-même se déposséder à l’extrême limite :
« C’est la controverse de chaque geste : s’élever à hauteur de l’autre sans lâcher un mot. Ou plonger dans la hauteur, vers la nuit.
Mais c’est autre chose, entre moi et l’inachevé – c’est autre chose.
De m’être ainsi enfermé dans ma voix, d’en avoir fait une source d’appauvrissement. »
Écrire : toujours oeuvrer au lieu commun de la parole, un lieu où n’être plus rien, décimé par la poésie elle-même et jouir de la rencontre. C’est précisément dans cette trajectoire que l’écriture de Metz noue la matière à l’altérité d’une rencontre où se perdre, car la matière est offerte en partage là où cède le poète, là où le regard de s’éloigne plus de la rencontre :
« Je marche avec ça, suivant le sol et le ciel. Pris par le temps.
C’est presque ici qu’il faudrait mourir. Parmi la Cène. Entre donner et recevoir.
Du pain
de l’eau
un baiser
n’être plus porté que par cela
d’aimer
de lier son écriture ses restes
à cet autre
à ce passant »
Il faudra bien finir par se défaire de l’écriture alors, elle-même rencontre du poète avec son interminable solitude, témoignage de l’être-au-monde : « Écrire même n’est pas ce que je cherche. Même si je le fais. L’écriture ne m’a laissé que mes mains et je m’en sers pour autre chose : à me solder de tous comptes avec chacun de mes mots. Avec ce qu’il en reste. » Fatalité d’une boue qui ne se retire plus des ongles. C’est toujours se salir soi-même pour la beauté du moi-même, et ne pouvoir faire que cela, pour la rencontre, le geste et l’instant :
« Mais je sème.
Tout ce que je suis. Pour qu’il y ait un chemin au croisement de nos voix. »
Et à ta voix, abdiquer encore :
« Ce travail ici de se perdre, de n’être confié à rien en touchant à tout est considéré comme la seule retraite, comme le seul dénuement. Que reste-t-il de l’autre à ne partager que ce qu’il n’est plus possible d’espérer ? »
Là l’éternelle force de lire Metz, demeurer suspendu à une matière qui témoigne, à une tragédie qui n’en finit plus et tenir la preuve dans les pages d’une survie qui danse dans la terre, pose son pas, et nous laisse confus, une trace au ventre : « Je me suis pris les mains dans ce que je disais. »
Bibliographie :
Metz, Thierry, Terre, Pierre Mainard, 2021.

















