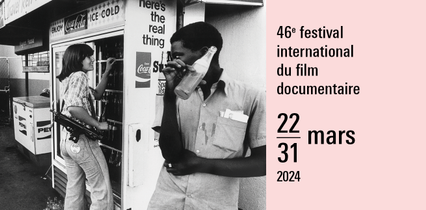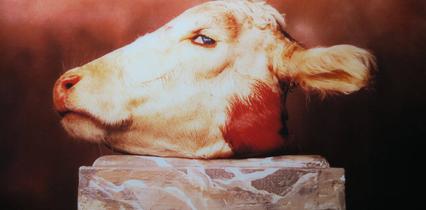Entretien littéraire avec Chouf
À l’occasion de la parution de son premier roman, Vie Mort Vie (éditions Tumulte, 2025), l’artiste pluridisciplinaire Chouf revient sur son parcours, sur la place qu’occupe la poésie dans son œuvre et sur la façon dont son travail fait naître des liens inattendus.
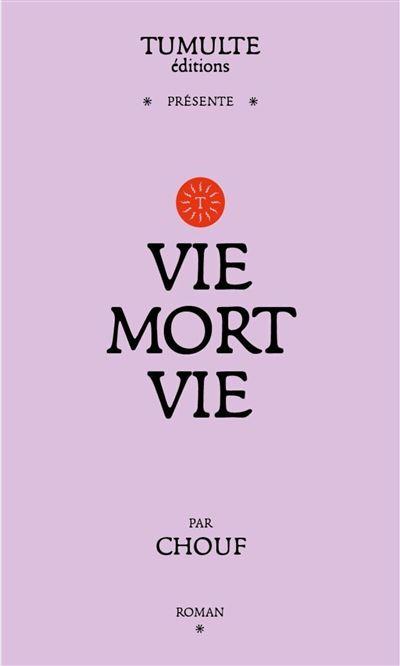
Comment es-tu passée de la poésie au roman ?
« La poésie, c’est mon centre, mon endroit. Je ne me voyais pas exister sans elle. »
Je ne voulais pas forcément aller dans cette direction. J’étais vraiment dans la poésie, parce que c’est mon écriture de pratique, celle que j’aime écrire. L’exercice du roman, je ne l’avais pas expérimenté. Ce sont mes éditeurs qui ont eu la vision avant moi. Ce sont eux qui m’ont dit : « Tu as tout pour écrire un roman, c’est là que tu dois aller. » Et ils m’ont aussi dit quelque chose de très juste : la poésie, on la voit peu. Elle ne se vend pas, elle ne se partage pas beaucoup. Donc j’ai écrit un roman. Et je les remercie infiniment, parce qu’en écrivant, j’ai fini par y prendre plaisir, alors qu’au départ j’avais beaucoup d’appréhension. Ce n’était pas du tout ce que je consommais en lecture. Peut-être que c’est le genre que j’ai le moins lu dans ma vie.
Tes poèmes sont pourtant assez narratifs, assez contextualisés. Quand on t’a proposé d’écrire un roman, y avait-il pour toi un défi, la nécessité de t’éloigner de tes poèmes ?
Je pense que mes éditeurs ont eu cette vision parce que je parle d’une manière très narrative. Ils m’ont dit : « Écris comme tu parles. » On m’a demandé de mettre la poésie de côté, mais j’y suis revenue, parce que j’y tenais tellement que j’ai voulu l’incorporer dans ce premier roman. Je ne me voyais pas exister sans elle, dans ce large paysage qu’est la littérature. Cela fait tellement longtemps que j’en écris, et que c’est mon centre, mon endroit. Je voulais que cela apparaisse d’une manière ou d’une autre.
Dans le livre, tu évoques tes premiers textes écrits sur ton Blackberry.
« Un SMS valait dix centimes : c’est ainsi que j’ai appris à mesurer le poids des phrases. »
Oui, dans la contrainte du texto payant, il fallait condenser ses idées, peser chaque mot. Cela t’apprend à aller à l’essentiel, à mesurer l’importance de chaque phrase. J’ai une écriture très téléphonique, nourrie par cette culture du message court, comme pour beaucoup de rappeurs d’ailleurs, qui écrivent leurs textes sur leur téléphone. J’ai nourri le même espace de créativité et de concentration. J’ai beaucoup écrit dans le métro, à l’époque du lycée, parfois en classe. J’ai beaucoup écrit dans des espaces qui n’étaient pas faits pour cela. Je n’ai jamais eu de vraie routine d’écriture. Je fonctionne à la fulgurance.
Pour le roman, c’était différent ?
Oui. Pour le roman, j’ai écrit entre huit et seize heures par jour, pendant plusieurs semaines. C’est comme ça que je l’ai terminé. C’était une forme d’hypnose. Je suis quelqu’un d’obsessionnel dans le travail, donc j’étais vraiment absorbée. Pendant plusieurs semaines, je n’étais plus disponible pour autre chose. C’était éprouvant, mais aussi magnifique.
Tu as travaillé neuf ans dans le travail social, notamment dans le secteur de la réduction des risques pour les usagers de drogues. Comment es-tu arrivée à ce métier ?
« Mon expertise, c’était la rencontre. »
J’ai grandi dans cet environnement. Mes deux parents sont dans le social. C’est mon héritage. Petite, je voulais être médecin. Ensuite, je me suis dit que mon niveau en sciences ne me permettrait pas d’aller jusque-là. Alors j’ai voulu être psychologue. J’ai fait une licence de psychologie, et c’est dans ce cadre-là que j’ai commencé à m’intéresser à la toxicomanie. J’ai écrit mon premier mémoire sur la parentalité et la toxicomanie. C’est, d’une certaine manière, mon premier vrai livre.
J’ai travaillé dans un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Ce sont des espaces où il n’y a pas de prévention au sens moral : on n’est pas là pour demander aux gens d’arrêter, mais pour les accompagner afin qu’ils ne se tuent pas, qu’ils ne tombent pas malades.
Dans ce cadre, j’ai rencontré des personnes qui avaient des enfants, ou qui avaient eu un rapport avec l’Aide sociale à l’enfance. J’ai conduit des entretiens pour parler de leur consommation dans le contexte de la parentalité, notamment dans les décisions judiciaires.
Je rencontrais environ neuf cents personnes par mois dans un petit local de trente mètres carrés. Je donnais du matériel stérile, des seringues, j’échangeais. C’était très concret. Cela m’a appris la rudesse, mais aussi la tendresse de ces mondes.
Une grande partie de ton roman est écrite à hauteur d’enfant. Comment t’y es-tu prise pour trouver ce ton ?
« Écrire à hauteur d’enfant, c’est dire la vérité sans brutalité. »
Oui, c’est l’un des exercices les plus délicats. Je me suis demandé comment je m’adresserais à un enfant de sept ans. Il faut lui parler sans l’infantiliser, trouver le ton juste, lui dire la vérité, mais sans brutalité. Trouver cette nuance, c’est tout le travail.
J’ai beaucoup réfléchi à la manière de restituer cette voix. Comment on s’adresse à un enfant pour qu’il comprenne, sans le traiter comme un enfant au sens condescendant du terme ? Comment lui raconter sans lui mentir ? C’est ce que j’ai essayé de faire. Le narrateur grandit au fil du livre : il s’enrichit de références, de nuances, comme un esprit qui se forme. C’est ce que j’ai voulu traduire.