
Passante du péril
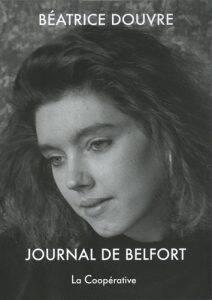
« Ma maladie féconde mon ventre neutre »
Les images viscérales teintent son écriture qui puise sa force dans la matière organique.
Si la santé réside dans le silence des organes, selon la formule de Canguilhem, c’est la souffrance qui donne forme à l’écriture de Béatrice Douvre et son corps devient le lieu de l’énonciation. Écartelée par le désir, la fièvre et la douleur, elle sculpte ses poèmes à partir de ses sensations : « Je creuse mon corps, y découvre des entrailles concrètes, un cœur incarné, je cherche dans la plaie le plaisir du sang. J’ai le sang grave des malheureux ». Les images viscérales teintent son écriture qui puise sa force dans la matière organique. Dès la première page de son journal, on y voit apparaître comment elle éprouve son corps par l’écriture : « Ruisseaux de sang labyrinthiques, j’éprouve mes veines malades en gonflant mes seins jumeaux, en exhibant ma solitude ». Dans une prose si dense qu’elle devient presque insoutenable, saturée d’adjectifs, elle s’emploie à parcourir son corps meurtri, présenté comme de la chair endolorie. Il y est question de fécondation, de copulations, de sécrétions. Les représentations de gestation qu’elle mobilise renvoient à une anatomie féminine malade, incapable d’être hospitalière et le spectre du corps gravide de Béatrice hante son écriture : �« Je meurs de mon corps mien, aux bras de l’Autre. Nous sommes au ventre doux boisé. Extrême proximité des chairs attentives. Nous sommes au placenta sanglant, à l’eau des mort-nés. Ventre bondé de fruit, d’eau, de sueur. » La chair, le sang et la sueur répandent leurs exhalaisons, éclaboussent chaque page de ce journal – à tel point que le lecteur, épouvanté ou écœuré, est en droit d’effectuer quelques haltes salutaires.
Ce travail sur le corps n’est pas sans rappeler celui entrepris par Vincent La Soudière dans un court texte – presque introuvable aujourd’hui – In memoriam Francis Bacon[1]. En effet, ce qui devait être à l’origine un hommage au peintre s’est transformé en une peinture fascinée de l’acte charnel : « On aurait dit deux ennemis au plus fort d’une bataille singulière de chairs emmêlés, dépouillés de leurs armes, suffoquant dans un corps à corps ultime… J’avais les coudes en sang ; tes convulsions laissent présager une fin prochaine. » Là encore, la représentation de la sexualité est perçue comme traumatique et mortifère. Si les images de Béatrice Douvre sont teintées d’un érotisme dont on ne trouve pas la moindre trace dans l’œuvre de La Soudière, la chair n’en reste pas moins triste et lasse.
La cathédrale ensevelie
« Mon corps est vain, je ne suis que parole »
Béatrice Douvre tourne sans cesse son corps martyrisé vers Dieu, et on y décèle la tentation mystique de la jeune poétesse : « Christ au calvaire me creuse. J’ai son visage dans mes mains d’oblation. La Cène est salvatrice. Parole commune et communion des corps. Je suis sauvée par la douleur. » Les nombreuses allitérations qui scandent ces paroles témoignent de l’importance des souffrances du Christ à laquelle elle s’assimile dans l’espoir de la Résurrection. Fascinée par la figure du Christ au Mont des Oliviers, elle y consacre un passage de son journal : « Christ seul, sait, et demeure à l’orée de l’arbre cassant et stérile. Autour de Lui, le silence indolent prend feu ; des flammes de bonté embraseront l’horizon rose. Des branches remuent la pénombre ambrée, le soir descend sur les tombes, Christ, seul, demeure. » Ici, on voit ce Christ solitaire en harmonie avec la nature, et une forme de beauté se dégage d’un moment de souffrance et de doute, comme si, pour elle, la douleur et la solitude pouvaient être salvatrice.
Dans une dimension sacrificielle, la poétesse accepte la souffrance si celle-ci peut permettre à son écriture d’être le prolongement de la Parole de Dieu
Sa relation à Dieu est inextricablement liée à l’écriture, à la parole qui doit surgir de son oblation. Dans une dimension sacrificielle, la poétesse accepte cette souffrance si celle-ci peut permettre à son écriture d’être le prolongement de la Parole de Dieu. Le journal permet de suivre ses oscillations entre affolement mystique et crise d’acédie. Parfois, on remarque une exaltation forte, proche du délire : « Feu vif des mots : j’éteindrai la parole, je la martèlerai comme ces rats rongeant les pages blanches. Je suis la servante du Verbe, feu liquide de Dieu-esprit tombant au sol pour marcher vers la ville promise. » Ici, l’usage du futur se veut programmatique, comme si la langue pouvait être à même de pouvoir dire Dieu. Parfois, au contraire, Béatrice Douvre exprime sa résignation : « Je suis pénitente aux paupières closes, un linceul sur le langage, et la parole muette ». Si Simone Weil a choisi une langue ascétique dans La pesanteur et la grâce pour rendre compte de la difficulté à habiter la présence divine, Béatrice Douvre emploie un style flamboyant, proche de l’exaltation et qui multiplie en vain les tentatives : « Aujourd’hui, je suis fille de rien, hors d’église, je hante les dalles sonores pour leur froideur et la fraîche peau des cires. Je vois les voûtes descendre, les tabernacles nus, l’hostie ne m’allaite pas. » Le désespoir qui la saisit est à la hauteur de sa foi. Le monde se dérobe à elle et se déploie à travers une grande sensorialité. On entend les dalles, touche les cierges et on voit l’église s’effondrer. La détresse spirituelle de Béatrice Douvre s’incarne à travers un cortège d’images sensorielles.
Æncrage difficile
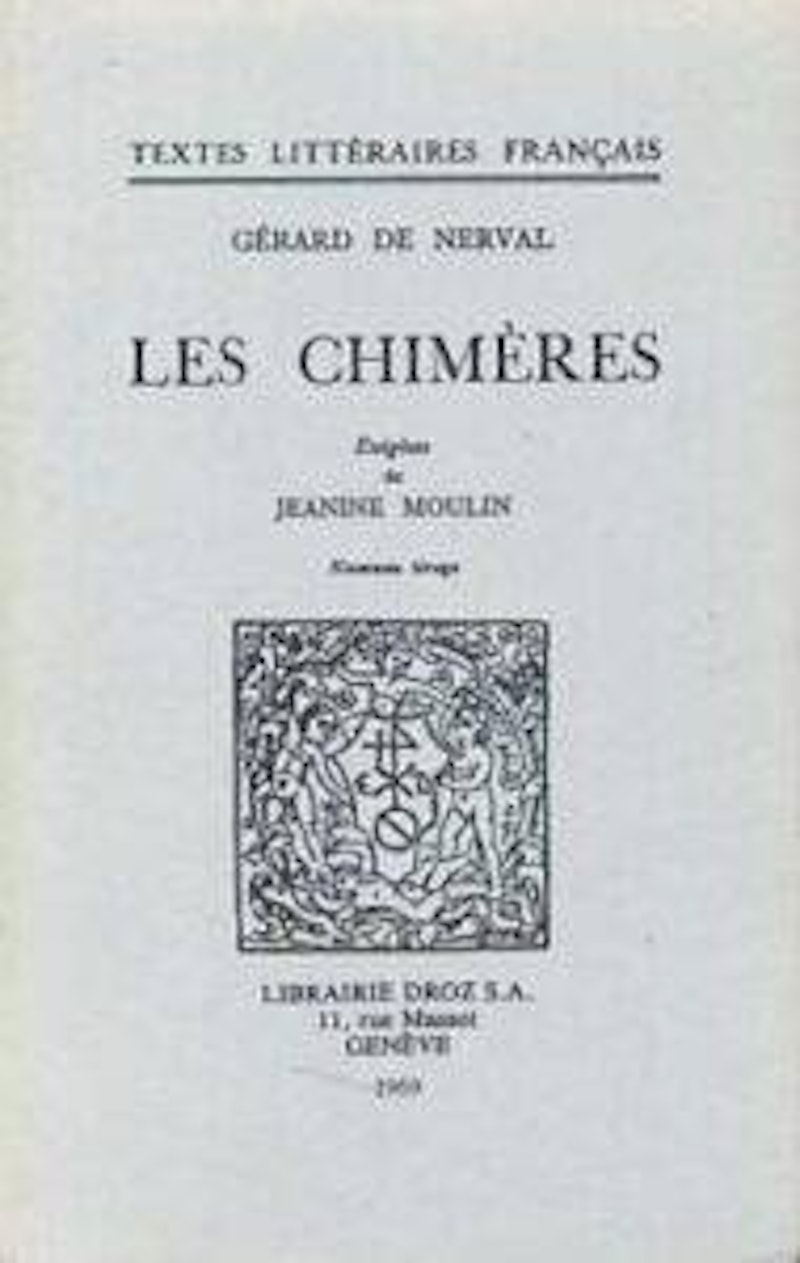
Ses poèmes sont des oboles où permanent des oasis de beauté.
Pourtant, même ce pharmakon a ses limites : « Ma plume ne glisse, elle s’étire en lambeaux d’encre noire, fleuve arrêté par mes souffles de neige, page blanche sans reflet qu’une eau morte de poésie naufragée ». Les images du lambeau et du naufrage mettent en place une poétique de la ruine. Béatrice Douvre investit l’écriture d’un pouvoir alchimique à travers un constant glaçant : « mon or se change en fer ». En travestissant le credo baudelairien : « Tu m’as donné ta boue, j’en ai fait de l’or », elle montre son impuissance à chanter son mal pour l’enchanter. Balayés par le vent de la folie, ses poèmes sont des oboles où permanent des oasis de beauté.
Le corps de Béatrice est avant tout littéraire. Elle peut le déformer, l’ausculter et le travailler dans ses textes sans être contrainte par la pesanteur de sa chair. Le Journal de Belfort rend compte de la crise à la fois charnelle et métaphysique que traverse l’éternellement jeune poétesse. C’est un texte d’une clarté aveuglante et d’une densité effroyable où Béatrice Douvre cherche sans trêve une manière d’exister. Et elle se prend même à rêver, dans l’annexe du Journal, d’un corps délesté de toute souffrance, léger et sans entrave.
[1] Pour en savoir plus, lire l’article de Juan Asensio à propos de ce court opuscule

















