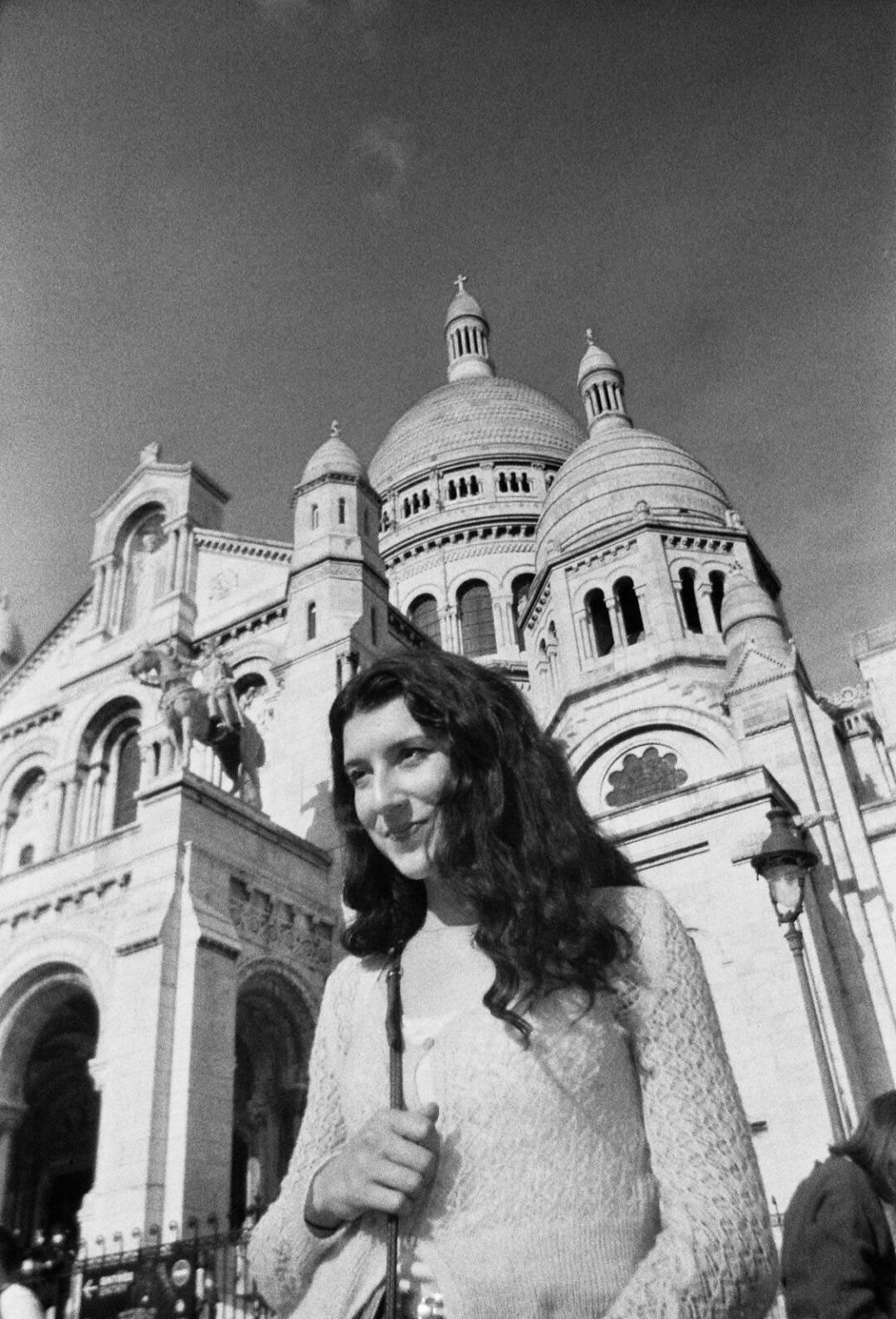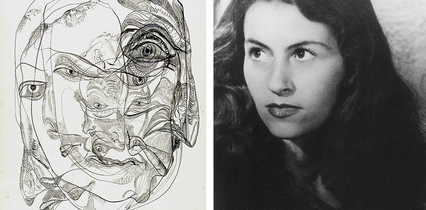Il y a dans chaque chose brisée la promesse d’une recomposition. Encore faut-il accepter de regarder la cassure. Avec La forme et la couleur des sons, l’écrivain américain Ben Shattuck livre un recueil de nouvelles d’une délicatesse rare, qui explore la manière dont l’art – dans ses formes les plus diverses–peut porter, sublimer ou accompagner la mémoire. Une mémoire intime, souvent douloureuse, traversée par l’absence, la perte, le manque.

Loin de toute idéalisation romantique de la création, Shattuck interroge le rôle de l’art comme geste de survie plus que de salut : non pas un exorcisme de la douleur, mais une manière de l’honorer. Son écriture se situe à la jonction du sensible et du réfléchi, de l’émotion et de la construction, comme un travail de kintsugi, cet art japonais qui consiste à réparer les céramiques brisées en soulignant les failles avec de la poudre d’or. Non pour les effacer, mais pour en révéler la beauté.
Le recueil, publié en France aux éditions Albin Michel, s’organise de façon subtile : chaque nouvelle semble trouver un écho dans une autre, comme si elles se répondaient dans une polyphonie souterraine. Certaines s’adossent à des liens thématiques ou géographiques (la Nouvelle-Angleterre, omniprésente), d’autres se croisent par la figure d’un tableau, d’un souvenir, d’une voix radiophonique.
La mémoire vive de l’instant
Dès la nouvelle éponyme, La forme et la couleur des sons, l’art se présente comme un lieu d’inscription de la mémoire. Deux jeunes hommes, dans un été qui semble suspendu, parcourent les campagnes du nord-est américain pour enregistrer des chants traditionnels. Ce projet devient bientôt le théâtre d’un amour naissant, à peine formulé, mais intensément vécu. Le magnétophone capte plus que des sons : « Le souffle du vent dans les pins sonnait comme une voix ancienne », note le narrateur. L’enregistrement devient alors une tentative de sauvegarde – non seulement du folklore menacé, mais aussi de l’instant vécu. L’acte artistique agit ici comme une arche fragile, une forme de résistance douce à l’oubli. Ce geste de captation, dans la nouvelle, permet de regarder la perte autrement – non comme un effacement, mais comme une trace. Cette première nouvelle donne ainsi la clef du recueil : l’art ne nie pas la fêlure, il l’accueille.