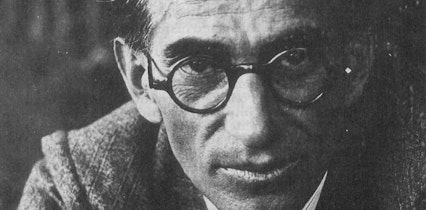À seulement 24 ans, De son sang est déjà le troisième roman de Capucine Delattre. Tandis que ses précédents ouvrages étaient directement inspirés de sa propre expérience de jeune femme dans la société française contemporaine, cette nouvelle parution est une fiction. Pourtant, la jeune responsable éditoriale y a conservé le propre de ses écrits : une critique sociale du monde dans lequel elle évolue. Elle nous emporte donc dans un roman qui traite aussi bien du mal-être psychologique que des normes patriarcales qui enferment les femmes dans un rôle de mère qu’elles finissent par accepter par dépit. Jusqu’où ces mères forcées d’entrer dans un moule préconçu peuvent-elles aller lorsqu’elles se rendent compte qu’il n’est pas fait pour elles ?

Cinq ans après la naissance de son fils, deux ans après son divorce, Sabine n’en peut plus. Elle ne voit son fils qu’un week-end sur deux et pourtant c’est déjà trop. Leur relation se dégrade à vue d’œil, le petit garçon ne mange plus, ne parle pas, évite autant qu’il peut la présence maternelle. Pour cause, il ressent un manque d’amour de la part de Sabine qui, depuis la naissance de Téo n’est qu’une coquille vide. « Nos Week-ends communs ont la température d’un musée désert. Téo ne m’est guère plus familier qu’un neveu, et me parle comme un élève à son professeur. »
La maternité, un devoir de femme
Sabine n’a jamais voulu avoir d’enfant. Aussi loin qu’elle se souvienne, cette idée la rendait indifférente. Pourtant, une fois mariée, son horloge biologique est devenue le centre de toutes les discussions. À force, elle s’est a fini par souhaiter cet enfant, non pas pour l’enfant, mais bien pour la position sociale que cela lui offrirait.
« Bientôt, personne ne brûlait autant que moi de voir la deuxième bande du test devenir bleue. Mais ce n’était pas un désir d’être mère qui m’animait. Je ne voulais pas d’un enfant, je voulais réussir.
Qu’on me félicite. »
En disant cela, l’autrice met en exergue l’importance sociale pour les femmes d’avoir des enfants, comme si elles n’étaient entièrement femmes, entièrement reconnues, qu’une fois devenues mères. La maternité apparaît donc comme un devoir à accomplir, une course au bout de laquelle elles reçoivent la validation de celles et ceux qui les entourent. Malheureusement, cette course ne se termine pas à la naissance de l’enfant, il faut ensuite répondre aux attentes inatteignables de la société.
À travers le regard de Sabine, l’autrice illustre le poids qui pèse sur les mères, contraintes d’être présentes sans surprotéger, de jongler entre travail et maternité, de préserver une vie en dehors de la famille, tout en la plaçant pourtant au centre de leurs priorités.
« Que je n’aime pas mon fils, soit. Mais que je refuse de m’en cacher, on ne me le pardonne pas.
– Je te jure, elle m’a même dit “vous savez, après tout, maintenant, je passe plus de temps avec lui que vous…!”
– On nage en plein délire là !
Le visage de Lydia palpite. Enfin, elle déborde. Ça me plaît.
– Moi, on m’a dit que j’étais trop présente dans la vie de Samuel, que je le surcouvais…
– On est perdantes dans tous les cas. »
La marginalité de Sabine agit comme une porte ouverte sur la parole pour les autres femmes qui, elles, ont réussi à se contorsionner pour entrer dans le moule créé par la société. Elles s’autorisent alors à partager leurs craintes, leurs difficultés, leur épuisement. Il n’est pas possible pour une femme d’être une « bonne mère », cela relève de l’impossibilité tant les attentes sont multiples et contradictoires.
Une anti-héroïne peut-être trop extrême
Face à ces obligations, le personnage de Sabine peut parfois paraître trop pessimiste, au point de rendre empathie ou sympathie envers elle impossibles. Jusqu’aux dernières lignes du livre, la protagoniste s’oppose à ce qui est attendu d’elle, mais également à ce qui est attendu d’un.e être humain doué.e de sentiments : tout semble l’excéder, tout semble la fatiguer. Tant de temps passé dans la solitude aux marges d’une société qui ne la comprend pas, l’a transformée en « monstre » et l’a persuadée ...