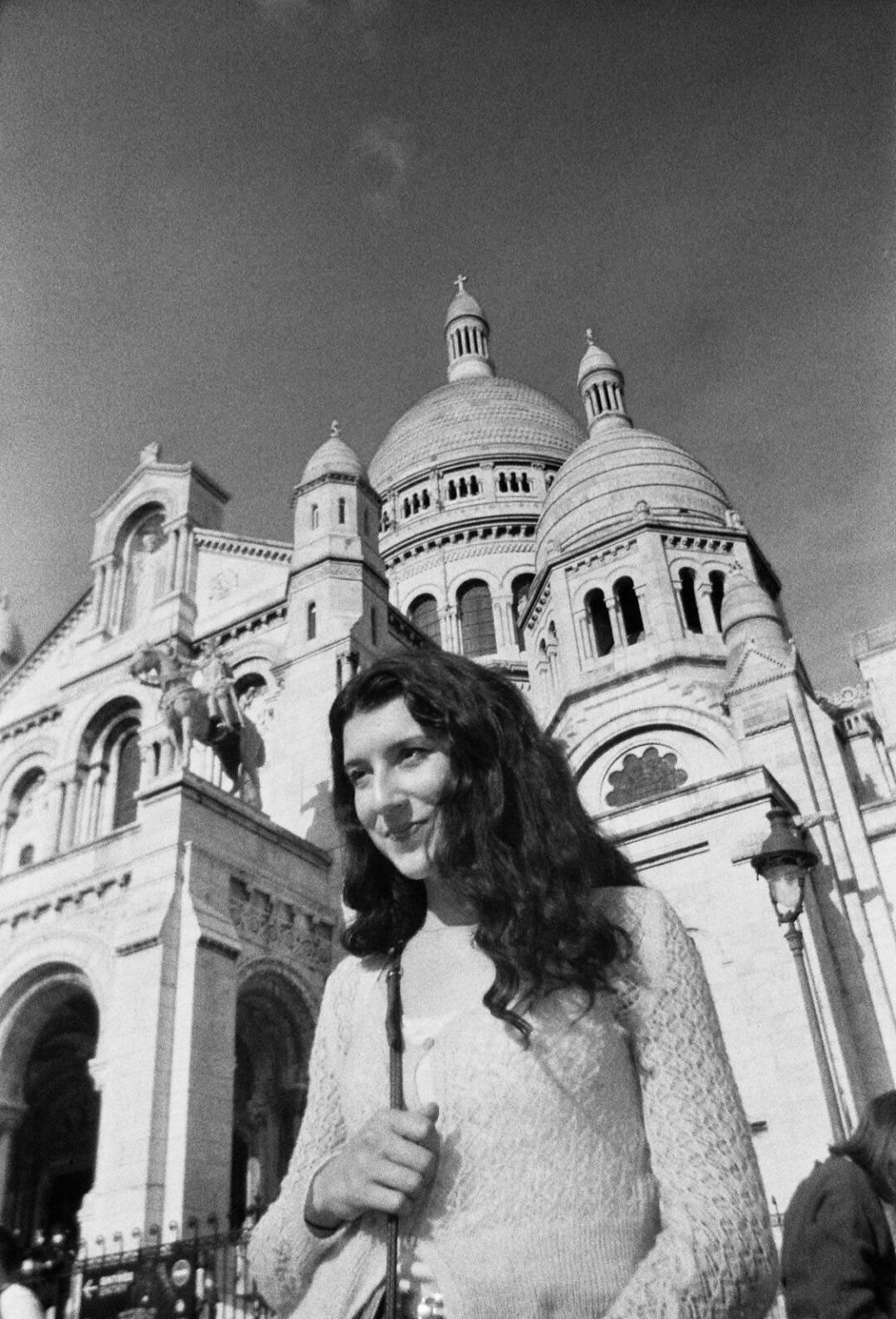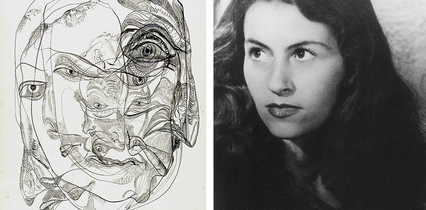Dans Le Rouge et Laure, Galien Sarde tente un pari stylistique ambitieux : composer un roman à l’esthétique résolument cinématographique, où le texte épouse le rythme du regard, découpe l’espace et joue sur une mise en scène particulièrement travaillée. À bien des égards, ce choix formel constitue l’un des aspects les plus séduisants de l’ouvrage, dont on regrette cependant que l’éclat se ternisse au fil des pages.
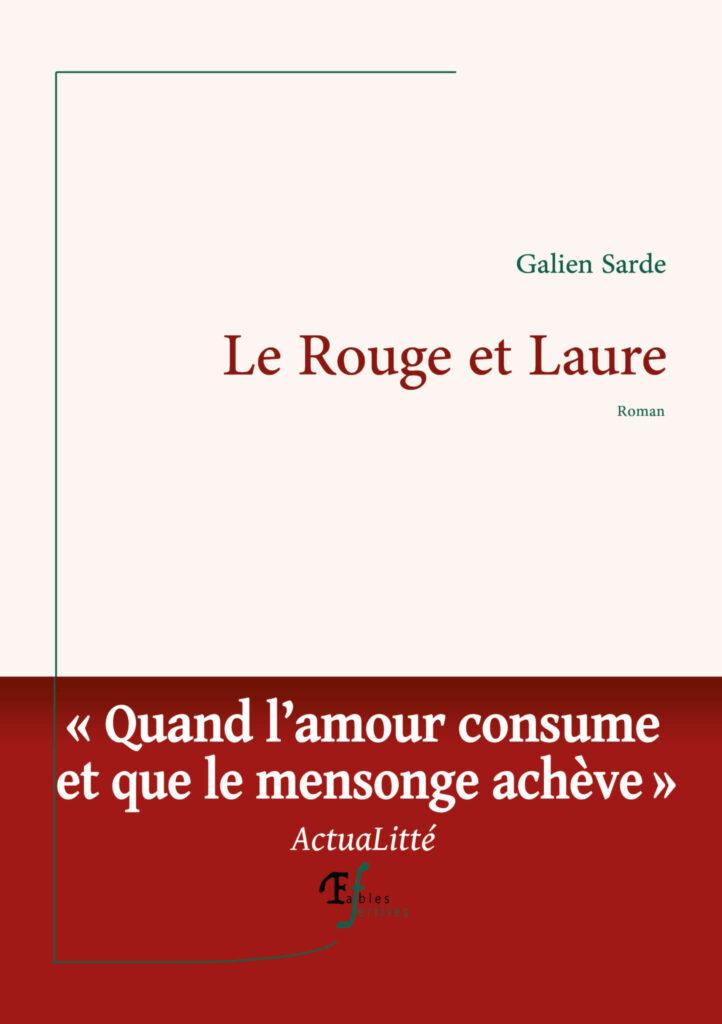
L’histoire elle-même s’articule autour d’un drame familial et d’une passion amoureuse prise dans un jeu d’ombres et de faux-semblants. L’histoire d’amour entre Laure, jeune femme fascinante et énigmatique et Gaspard Vance, le défunt est présentée sous un jour ambigu, entre véritable attachement et jeu de manipulation. Le voile d’ambiguïté qui recouvre cette histoire d’amour sert à définir le style du roman où les variations d’ombre et de clarté, les textures et les bruits ambiants sont décrits avec une précision qui confine parfois à l’hypnotique.
Dès les premières pages, la mise en place de l’espace et de la lumière constitue un langage qui frappe par son acuité sensorielle: « 5 juillet 2008, l’air est inerte. Un portail s’ouvre sur une allée qu’accusent les rayons du soleil. »
Cette attention extrême portée à l’agencement des images trouve son prolongement dans une syntaxe souvent syncopée, fragmentée, comme si chaque phrase cherchait à rendre le découpage du montage cinématographique. Ainsi, lorsque Laure guide l’enquêteur Bloom à travers la demeure de Gaspard Vance, la narration progresse à la manière d’un lent travelling intérieur : « Ils montent l’escalier sans contremarches, sous-tendu par des filins, et qu’une corde longe en guise de rampe. […] Il avise l’immense futon et ses alentours, comm...