Dans Les Cinquantièmes hurlants, Tom Buron livre une odyssée moderne où la carte se fracasse contre le territoire. Véritable épopée marine, nous suivons les péripéties d’un marin qui se rend au bout du monde et du langage. Nourri par Melville, Byron ou T.S Eliot, Tom Buron réactualise une tradition lyrique à travers le chant furieux de ce navigateur. L’écriture y devient terrain d’expérimentation formelle et quête de dépassement. Un poème magistral.
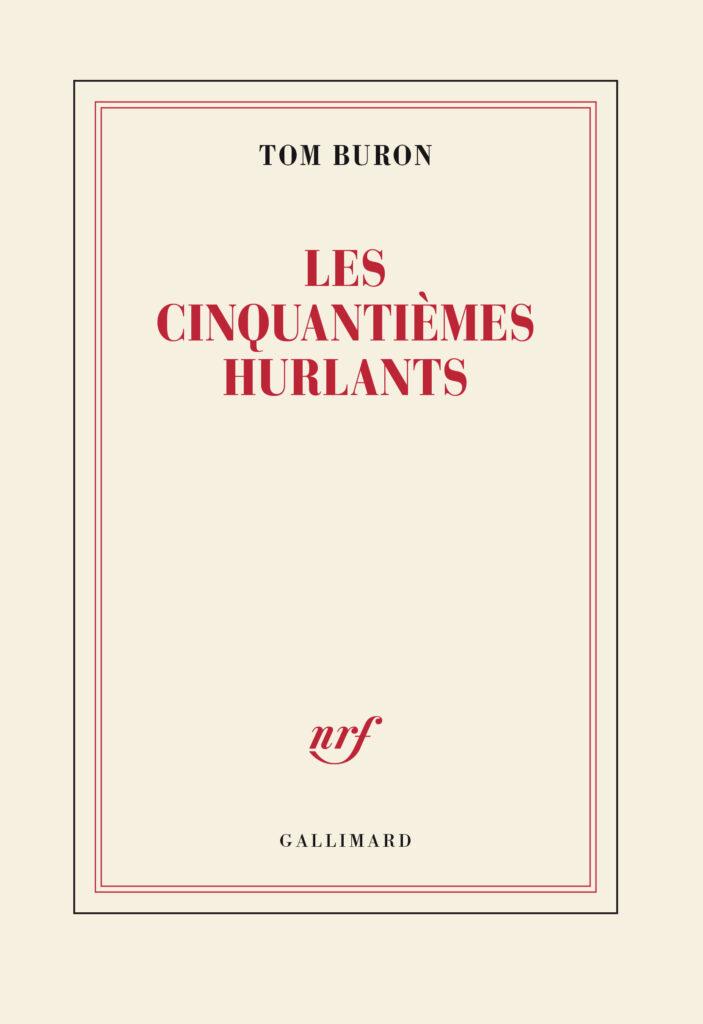
Les Cinquantièmes hurlants est un long poème aussi exaltant que fiévreux. C’est un hommage à la mer, à l’aventure mais aussi à l’écriture. Comment ce texte a-t-il surgi ?
Le long poème en vers libre est ma forme, c’est-à-dire le terrain qui m’intéresse et que je travaille avec acharnement depuis des années. C’est pour moi le terrain le plus complet. Jusqu’ici, mon travail revêtait une peau proprement urbaine, la ville ayant été ma zone de prédilection. S’il y a toujours eu le déplacement, le mouvement, le voyage, la ville demeurait tout de même le décor central de mon système poétique. Aussi, j’avais besoin d’un déplacement. J’avais cette fois envie d’une traversée, et de me servir de ce motif de la traversée pour déployer encore plus puissamment certains motifs, une direction qui est aussi un tournoiement. Il y a tout, et en même temps absolument rien, à bâtir sur l’eau. Cela en faisait le terrain parfait pour ce que je m’apprêtais à lancer : on ne domine pas la mer, c’est donc le lieu de tous les risques.
Avec ce long poème marin, j’arrivais à la fin de quelque-chose, je savais que je terminais ce « cycle du danger » commencé avec les trois livres précédents et je pensais, pour être honnête, arrêter complètement après ça. J’avais décidé depuis longtemps de finir cette aventure avec un poème épique à l’aube de mes trente ans et de passer à autre chose. Totalement autre chose. L’écriture de ce texte a donc d’abord été laborieuse, plus qu’à l’accoutumée, et je dois très certainement cela à cette décision. Et si l’idée est née il y a des années, avant même que je ne finisse Marquis Minuit (Le castor astral, 2021), il m’a fallu un peu plus de deux ans pour parvenir à l’achever. J’avais prévu de partir en mer, d’abord sur un cargo, puis sur un voilier, toute cette affaire a été repoussée avec la pandémie. J’ai commencé à travailler, j’ai amassé des centaines de pages, des blocs de vers, des notes mais après plus d’un an je ne parvenais toujours pas à débusquer la forme que je souhaitais, je ne trouvais pas la clé. J’ai fait comme je fais toujours, je me suis « escapadé », allé voir ailleurs si j’y suis. J’ai traîné dans les villes portuaires du continent. Puis quand la guerre a débuté à l’Est, j’ai filé, j’ai rejoint l’Arrière, et après avoir passé des mois en tant que volontaire là-bas, très loin de l’écriture et de mes préoccupations habituelles, ayant à peine le temps de vraiment lire, je m’y suis remis et la forme est arrivée. Une espèce d’urgence était née et à travers ces centaines de pages j’ai réussi en quelques mois à atteindre ce que je cherchais.
Une fois ce texte achevé, je suis reparti en Ukraine à de nombreuses reprises. La guerre a été aussi le déclencheur d’une traversée, celle de la Méditerranée, sur un voilier. Je n’avais aucune expérience de la chose marine et j’ai dû apprendre sur le tas, depuis les côtes françaises jusqu’à la Mer noire, en passant donc par la Ionienne, les Dardanelles, le Bosphore… L’aventure en somme, toujours.
Ton recueil frappe par sa fougue et son ampleur. C’est une forme d’épopée en miniature qui donne à entendre le fracas du vent sur les voiles, le bruit de la tempête sur les cordages. En un sens, tu ressuscites le goût de l’aventure. Ce poème est-il le signe que l’aventure est encore possible dans un monde balisé ?
Je n’irai évidemment pas contre ce rapprochement avec l’épopée que tu fais, je m’en réclame expressément. On pourrait carrément dire que Les cinquantièmes hurlants en est une. On pourrait dire que c’est un long poème bagarreur divisé en neuf stations, un poème marin de près de quatre-vingt pages qui mélange l’expérience individuelle et une mémoire qui va aussi chercher au-delà de ce seul personnage et puiser dans une collectivité anonyme. On pourrait dire qu’il s’agit de l’anti discours d’un capitaine fou qui se balade en son siècle tout en conversant en quelque sorte avec Prométhée, Dionysos, Faust, ou encore le Christ. Mais on pourrait aussi se contenter de dire qu’il s’agit d’un poème d’aventure et ça me conviendrait très bien, voilà.
Le poète représentait pour le jeune garçon que j’étais autant un être de l’écrit qu’un être de l’action
Est-elle encore possible, l’aventure ? Évidemment. Je n’ai jamais voulu croire le contraire, et ce depuis l’enfance. Le souci de l’écriture est arrivé chez moi en même temps que ce goût de l’aventure et du danger. Tout cela est, en ce qui me concerne, intimement lié. Le poète représentait pour le jeune garçon que j’étais autant un être de l’écrit qu’un être de l’action, un être de méthode et un voyou, un être de la bourlingue comme de l’ascèse : à cette époque, je lorgnais vers Byron, vers Rimbaud, et je les voyais comme des poètes « complets » en ce sens. Mais se questionne-t-on ici sur le genre d’aventures qui a bâti la légende de ces deux-là ? Sur l’aventure à la Hemingway, à la Kessel ? Ou bien sur celles des grands skippers de la deuxième moitié du vingtième siècle ? Un destin tel quel celui d’Alain Colas est effectivement moins probable aujourd’hui mais, cela étant dit, l’aventure est un goût, un courage, une imprudence et aussi une discipline : il ne tient qu’à l’homme de se débarrasser de ce qui fait entrave à tout ceci. Il faudrait rappeler à ce siècle de sécurité ce qu’est la fougue, ce qu’est le panache.
On m’a posé la même question que toi lors d’une rencontre en librairie à Rouen il y a quelques jours. A la fin de l’adolescence, j’entendais déjà ce « l’aventure est finie, ce n’est plus pareil » lorsque je partais sillonner l’Europe en autostop. Et pourtant, nous n’avions pas encore de smartphones, nous n’étions en possession que de cartes routières.
Ton texte ne se limite pas à la mer, et ne s’inscrit pas seulement dans la tradition de la littérature maritime mais évoque également les étoiles – mais aussi le numérique : “l’avatar toujours plus beau sur l’écran double les rites et fonce dans le métavers, image numérique ad vitam, m’est avis que la race entière a désormais fini la tournée”. Quel regard voulais-tu porter sur ces technologies qui façonnent un nouveau rapport au réel ?
Les technologies d’aujourd’hui, c’est vrai, peuvent nous empêcher en quelque-sorte de nous perdre, nous interdire quasiment le chemin de traverse mais, tout de même, je persiste et signe : l’aventure est non seulement possible, mais elle est nécessaire, c’est une affaire de libre arbitre. Le choix aussi de ne pas céder en permanence à la facilité, de ne pas se comporter en enfant dépendant face à ces espaces numériques que tu évoques et de tout simplement ne pas les laisser prendre le contrôle. Mais mon texte, s’il regarde notre décennie, n’est pas pour autant une critique du progrès technologique ou technique… Je crois que, pour le meilleur et pour le pire, c’est un début de siècle fascinant. Ce texte, en fait, s’il pouvait redonner ce goût, puisque c’est de cela dont tu parles ici, ce goût, celui de l’aventure, du panache, du risque, je te le dis, j’en serais absolument ravi.
Le voyage de ce navigateur prend parfois des proportions métaphysiques, notamment à la fin du récit puisqu’il est question d’aller au-delà des limites du monde connu. Tout le texte oscille d’ailleurs entre la raison et la folie, et l’espace de l’imaginaire se heurte à l’espace du réel. Cette collusion entre ces deux mondes était-elle voulue ?
Cette zone de friction, ce point de tremblement, est effectivement quelque chose que je travaille ici et que je travaillais déjà dans les précédents, et peut-être en particulier dans Marquis Minuit (Le castor astral). C’est un des enjeux du texte, tu as raison. Un pari à la fois du fond et de la forme. Je ne vais pas rentrer dans le commentaire de mon propre livre, faire le coup du type qui propose à la fois la composition et l’herméneutique, mais d’un point de vue formel, ce tiraillement entre ce qui est sain, raisonnable, et ce qui est de l’ordre de la démence est quelque chose que j’ai travaillé dans mon vers et qui marque, je dirais, l’ « allure » du poème, sa sauvagerie, comme une horde qui cavale et qu’il faut pouvoir savoir diriger. Un écrivain doit malgré tout tenir les rênes, n’est-ce pas ? Le désir de ce personnage d’aller au-delà des limites, au-delà des rapides, a quelque chose de l’ordre de la quête mystique et aussi peut-être de la maladie. Mais je me range de son côté, je me range entièrement de son côté. Le monde, ou disons plutôt l’être humain, a, il me semble, besoin de mythes et c’est un espace qui se trouve plutôt dépeuplé aujourd’hui. Cette époque a besoin de mythes.
Les mots s’entrechoquent et se heurtent comme des vagues sur un récif. Ton texte est parfois troué de mots grecs, latins, russes ou anglais. Tu emploies aussi des mots rares, et ta syntaxe possède un souffle certain. Ton ambition est-elle de construire un texte fait pour être déclamé ?
Mon ambition est d’abord de développer un vers libre pris dans une espèce de lyrisme de combat, de lyrisme violent. J’entends bien que lyrisme est un mot qui fait peur en 2025, puisque la mode est soit au poème du quotidien et à la poésie revendicative, soit à l’anti poésie, c’est-à-dire la poésie qui « n’a pas l’air d’en être », soit à la poésie complètement oralisée, performée. Ce lyrisme dont je parle n’est et ne doit pas être celui de nos aînés, des poètes qui nous ont guidé, s’il s’en nourrit, il doit être renouvelé, modernisé, il doit être neuf. Pour ma part, il s’agirait d’un lyrisme qui boxe, un lyrisme électrique, biberonné aux avant-gardes du siècle dernier autant qu’au rock et au free jazz, qui serait allé puiser à la fois dans le modernisme français et le modernisme étranger. Si l’oralité a une influence importante, que le souci du rythme et de la musique est grand, ce texte reste fait pour le livre et je n’écris pas pour la scène ou pour la performance.
Concernant les choix dans la langue que tu évoques, je souhaitais que le personnage du navigateur, ce Nocher dément et balafré qui nous guide dans ce texte et qui envoie son monologue, soit un personnage en quelque sorte supranational ou en tout cas au-delà du francophone. Il est évidemment fondamentalement de son siècle, le vingt et unième, le nôtre, mais il charrie tout un tas d’autres imaginaires et je souhaitais qu’il représente le continent entier. C’est pourquoi il y a (peu, mais il y en a) quelques incursions de différentes langues, toutes d’Europe, ici et là. Je crois de toute façon qu’un poète qui réussit son affaire vous fait toujours parler une autre langue.
Mon ambition est d’abord de développer un vers libre pris dans une espèce de lyrisme de combat
Quelles sont tes inspirations littéraires ?
Peut-être est-ce un truisme mais on ne peut pas se séparer de l’Odyssée, de l’Iliade, de Dante, de Shakespeare, de Rimbaud. À cela j’ajoute Blake et Nietzsche. Il faudrait les rappeler à chaque fois. J’aime retourner à Villon aussi, aux symbolistes, puis au Grand Jeu, à Saint John Perse, à Cendrars, à Roger Gilbert-Lecomte… J’ai souvent évoqué le Childe Harold de Byron après Marquis Minuit. Je reviens toujours à T.S. Eliot, Ezra Pound, Hart Crane, Dylan Thomas, Conrad Aiken, mais aussi à Malcolm Lowry, Joyce, Conrad, Faulkner, McCarthy et son Méridien de sang, véritable chef d’œuvre moderne dont on fête les quarante ans… Des poètes tels que John Ashbery, Basil Bunting, Derek Walcott… Mais il y a aussi les Russes, ceux de l’âge d’argent, les futuristes, Khlebnikov, Maïakovski, Tsvetaïeva, etc. Des paroliers du vingtième siècle, en langue française, en langue anglaise. Lou Reed, Dylan, Gainsbourg… Plus contemporain, chez les prosateurs, le hongrois Laszlo Krasznahorkai. Mais puisque l’on échange autour de mes Cinquantièmes hurlants, il ne faudrait surtout pas que j’omette Herman Melville ou que j’oublie de mentionner Kazantzaki et son Odyssée, poème épique de plus de trente-trois mille vers, qui faisait partie du catalogue de Plon et qui est désormais épuisé. J’ai la chance de détenir un exemplaire de cet objet rare, un cadeau que m’avait fait il y a quelques années mon ami qui dirige l’excellente Librairie Nijinski, à Bruxelles, qui fut ma ville d’adoption pendant des années. Il y aurait tant, encore, d’hommages à faire, de l’épopée ancienne à l’opera rock, mais voilà pour le lâcher de noms.
- Tom Buron, Les Cinquantièmes Hurlants, Gallimard, 2025.
- Photo © Éditions Gallimard, Francesca Mantovani

















